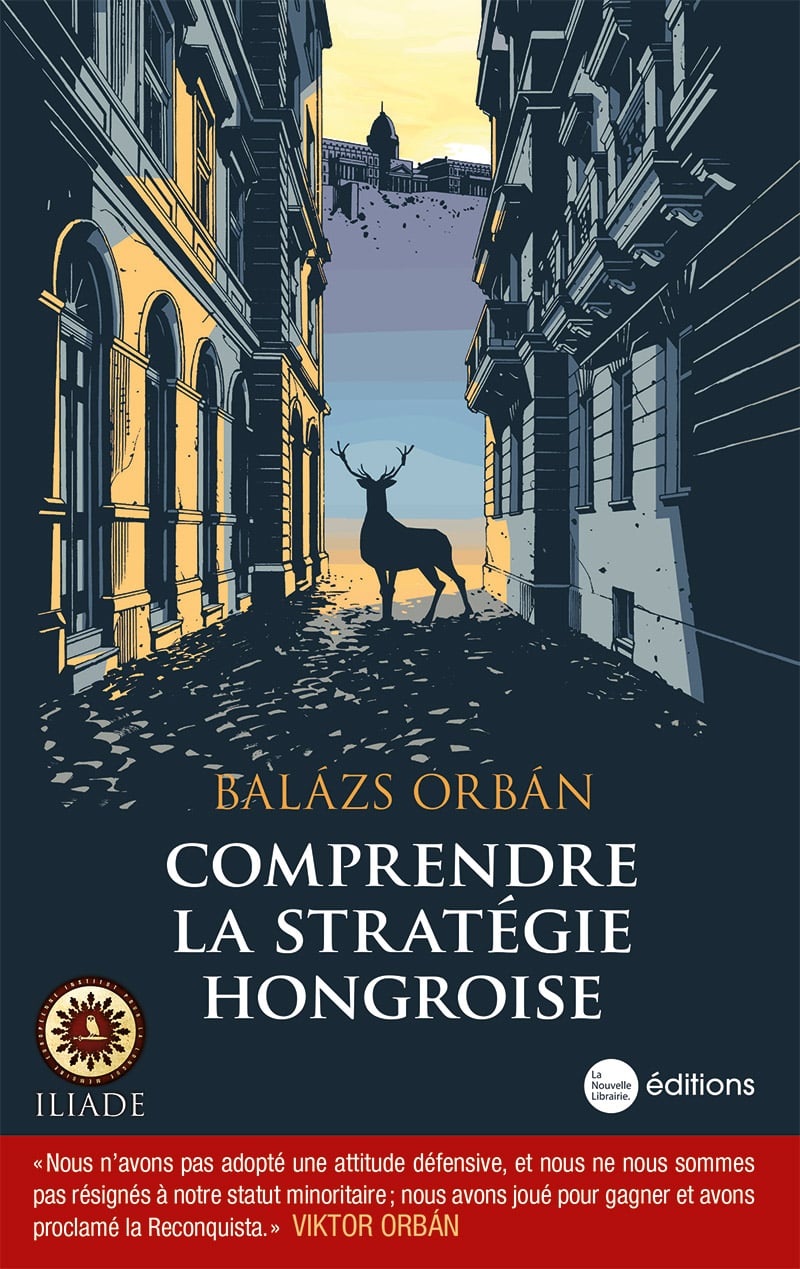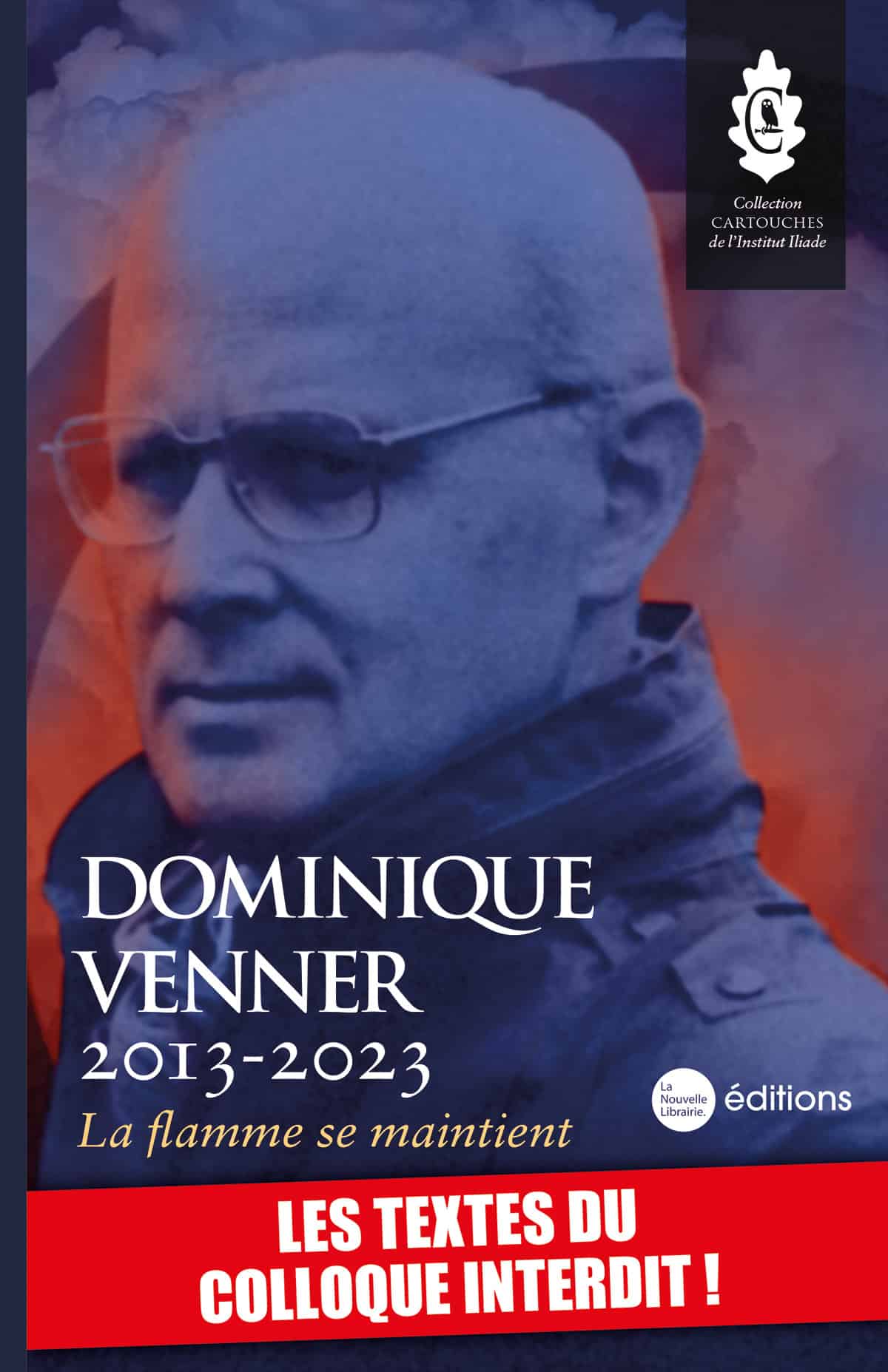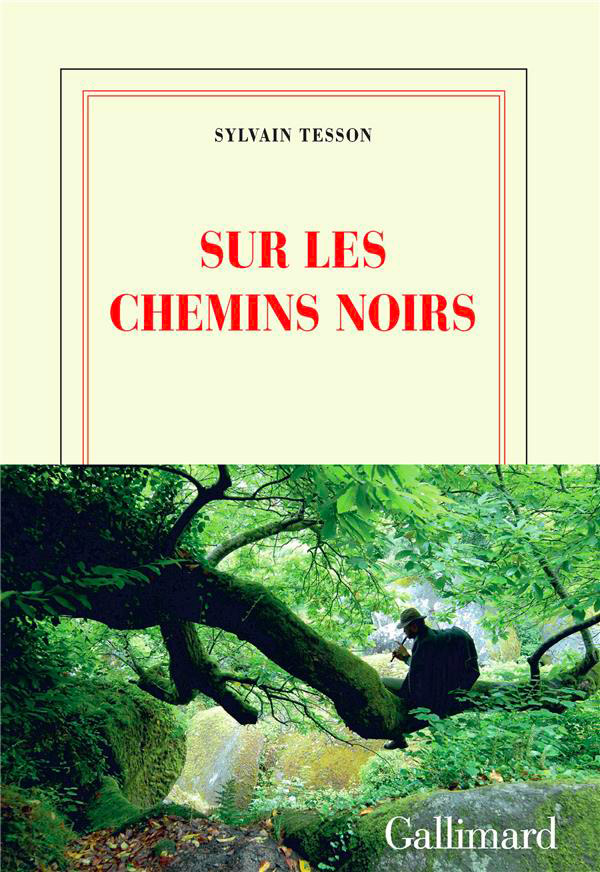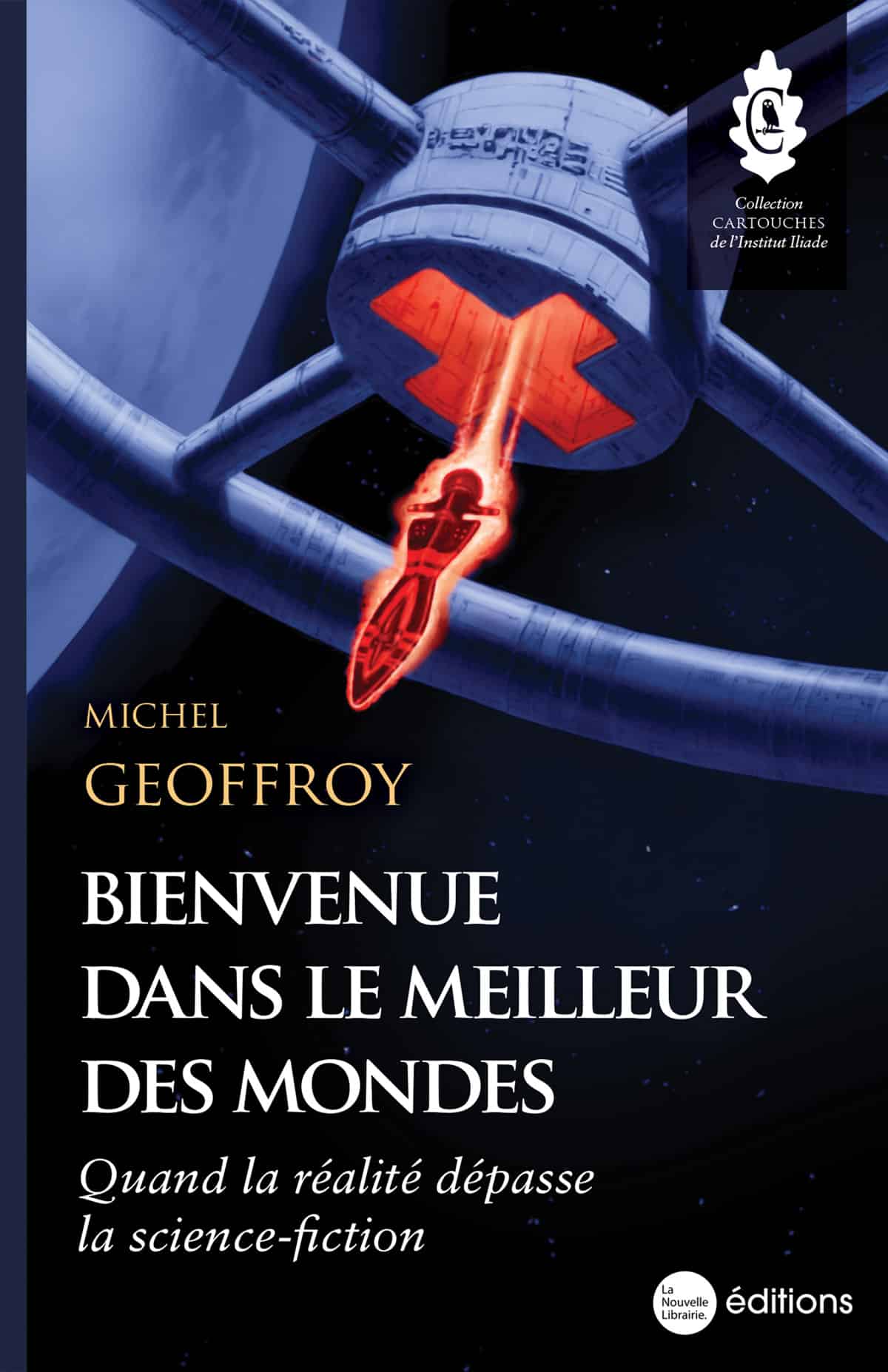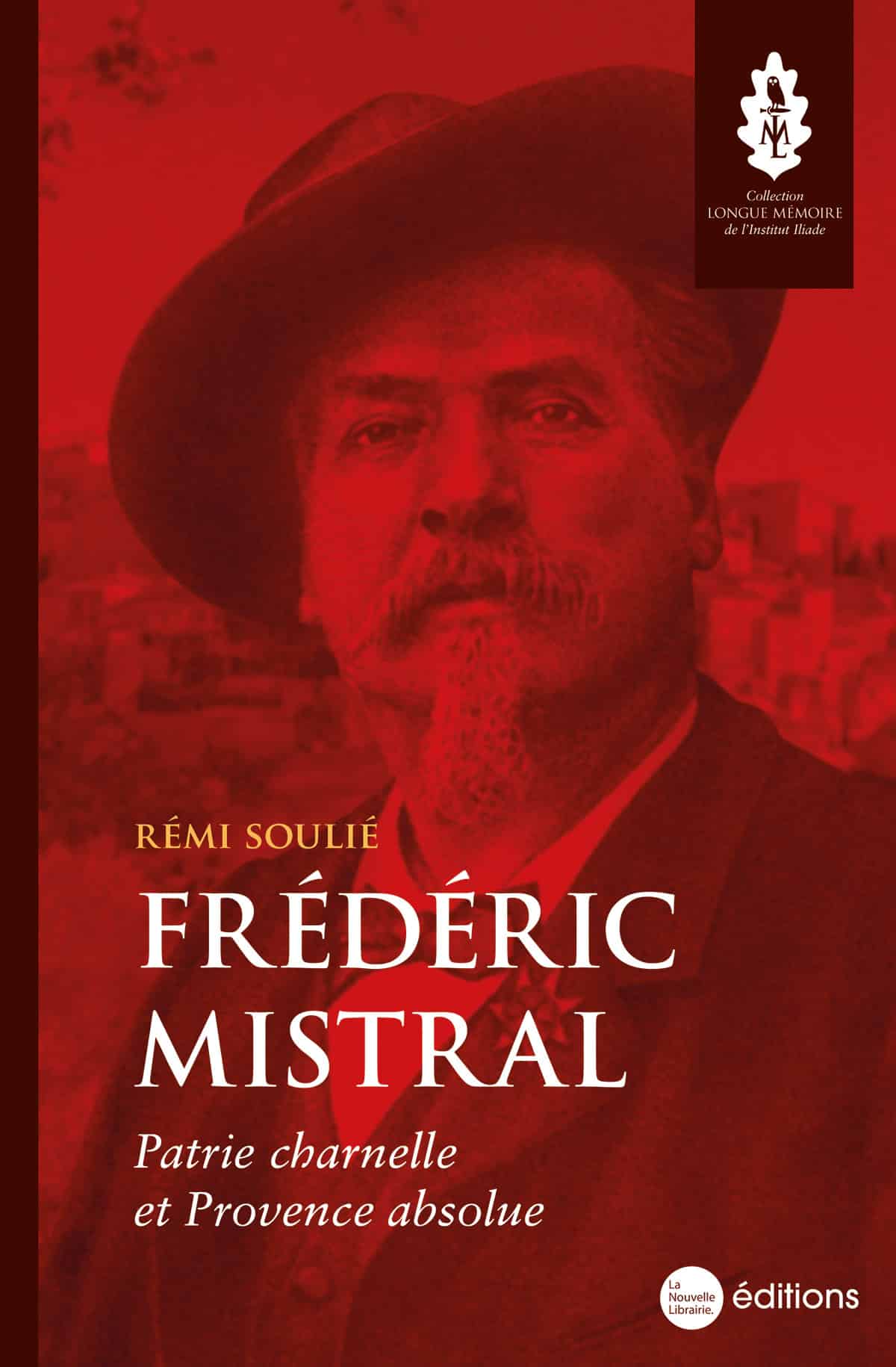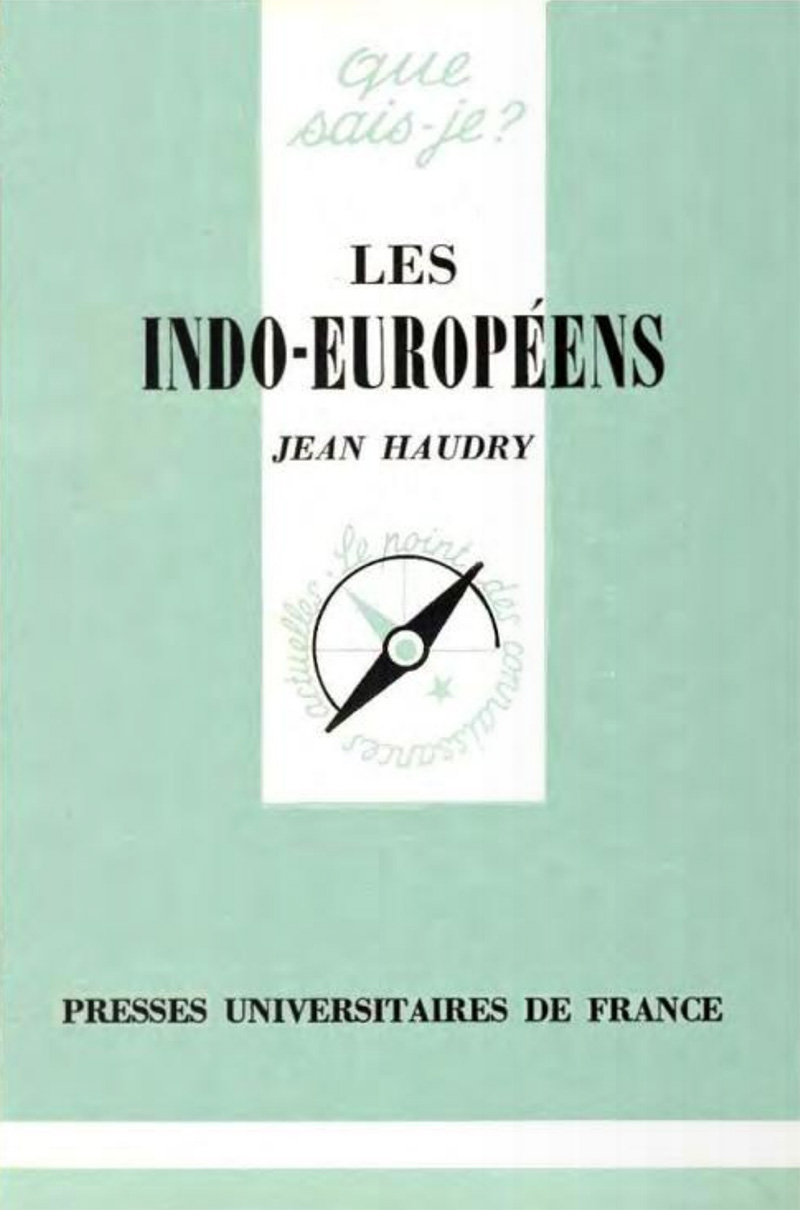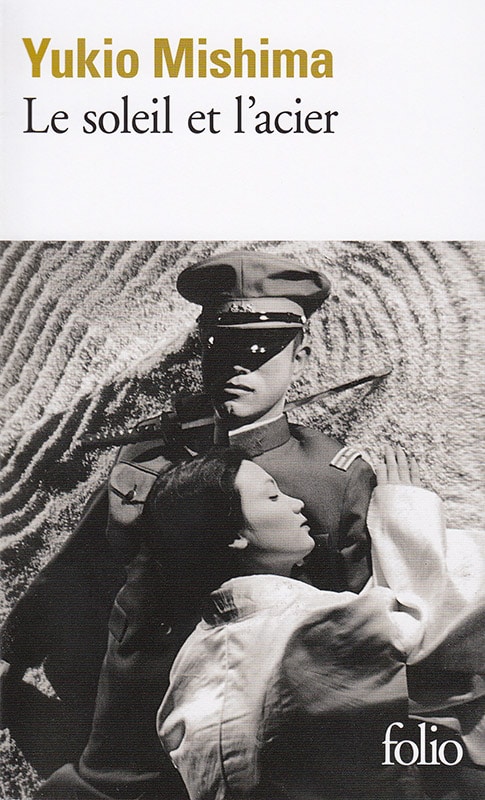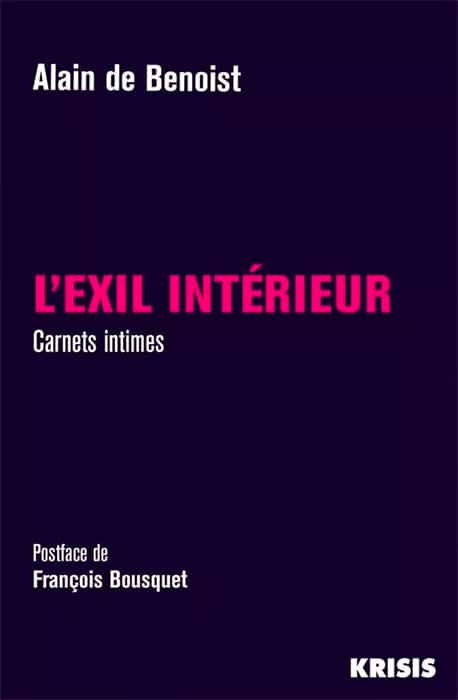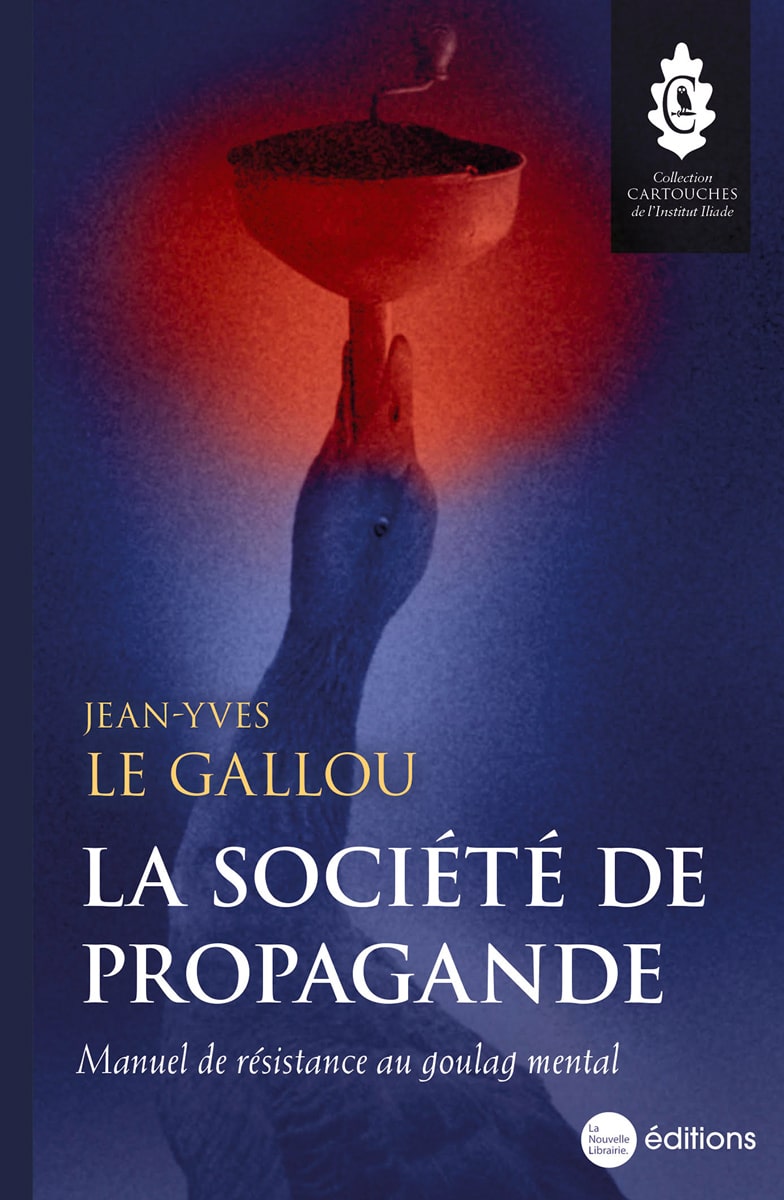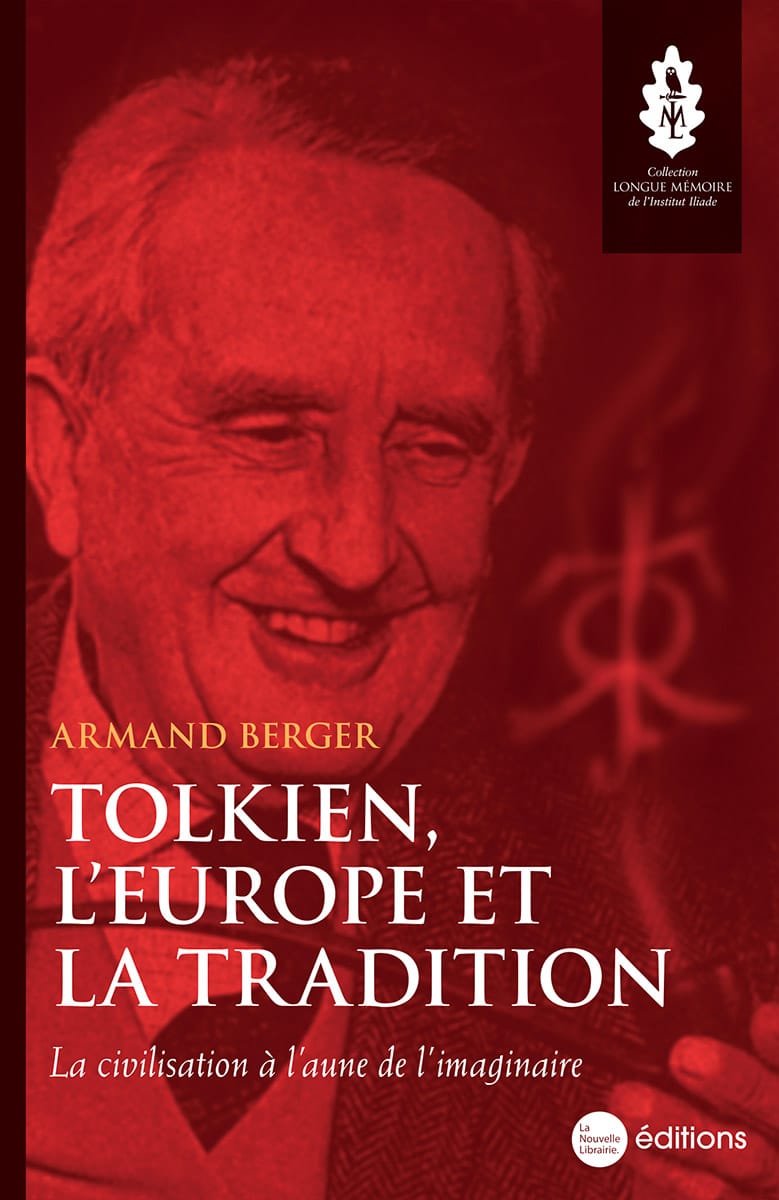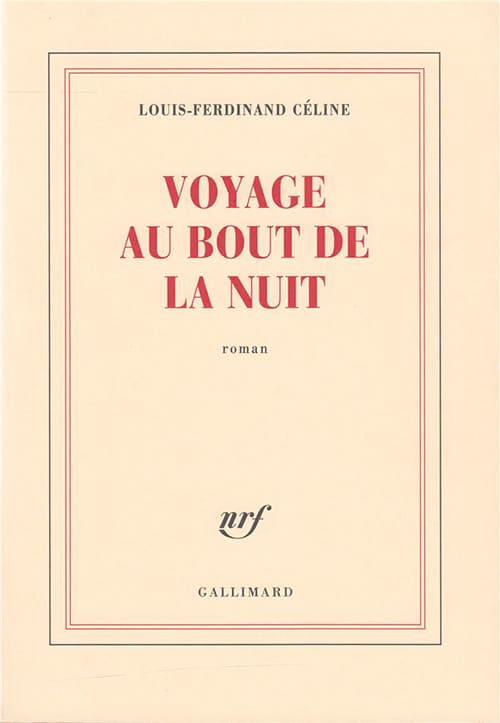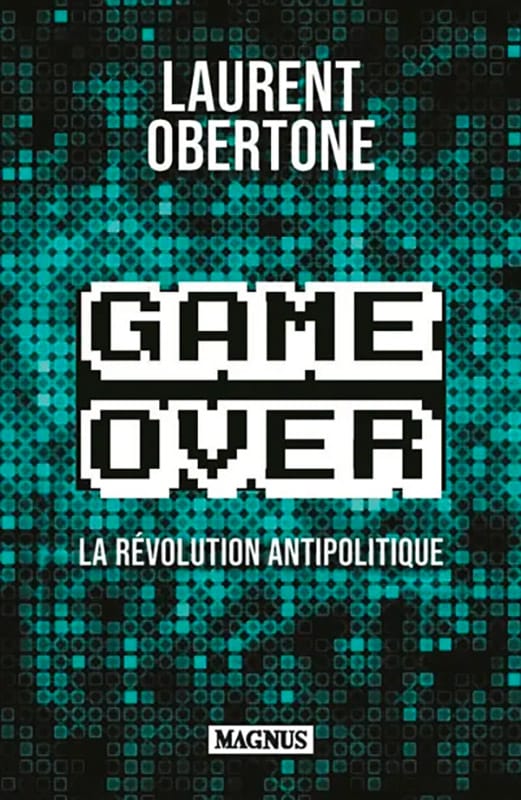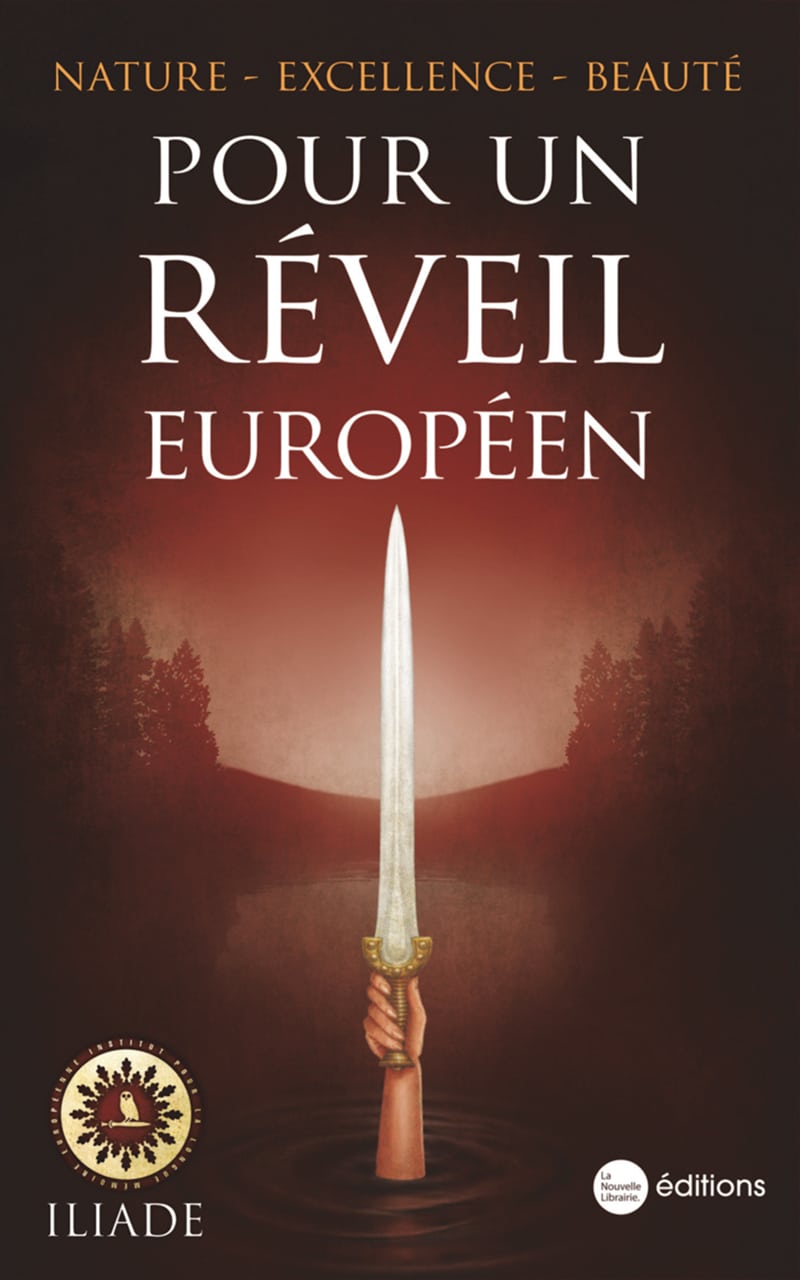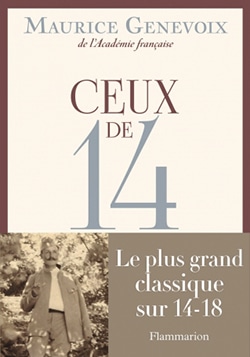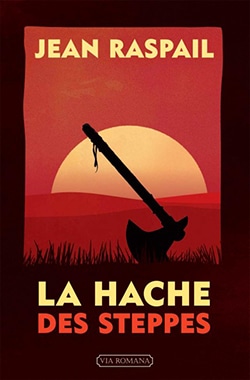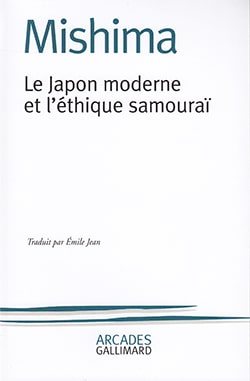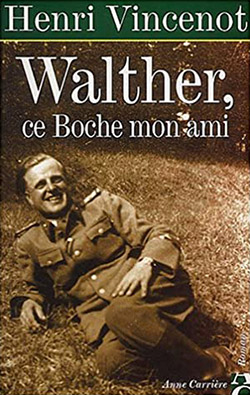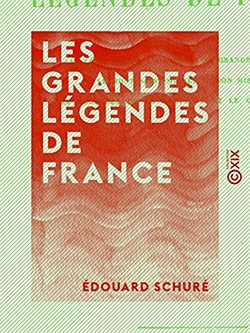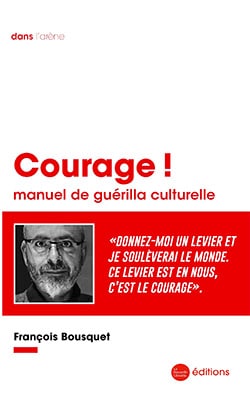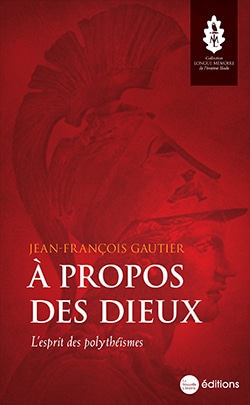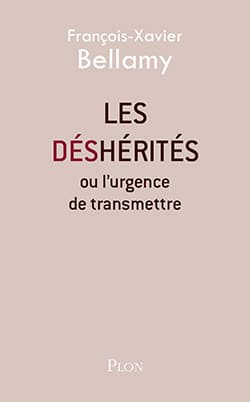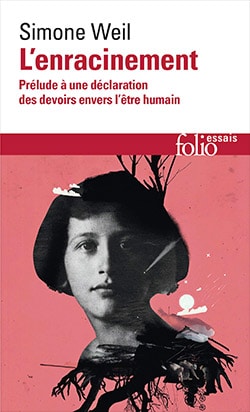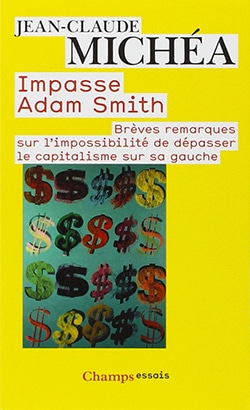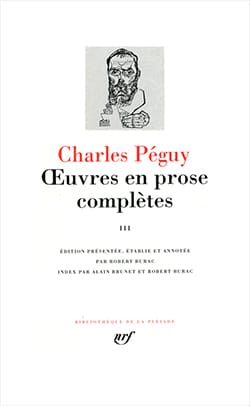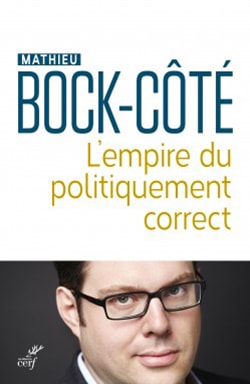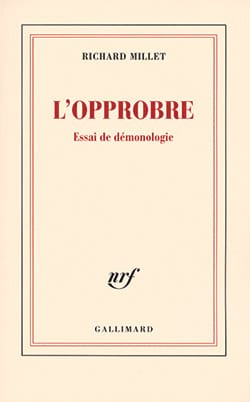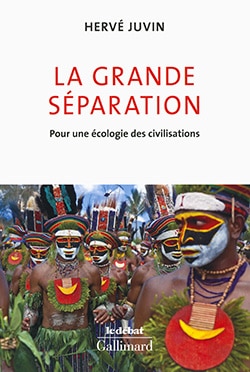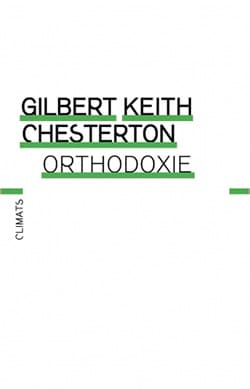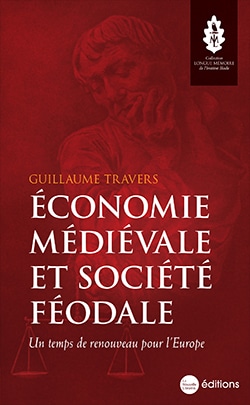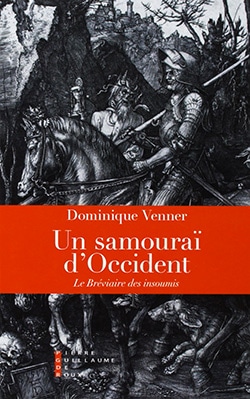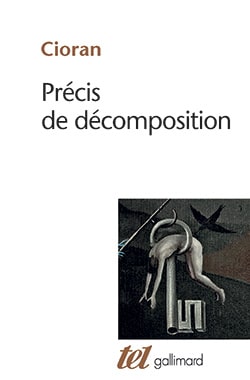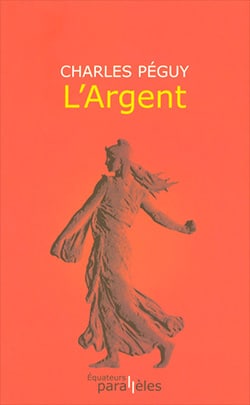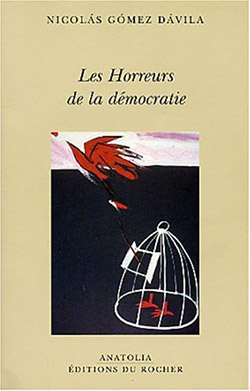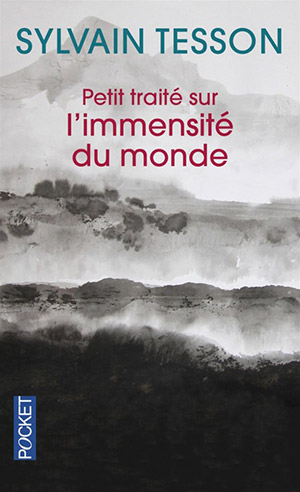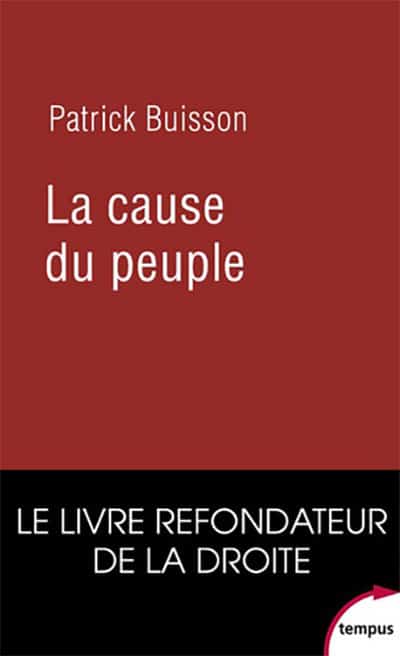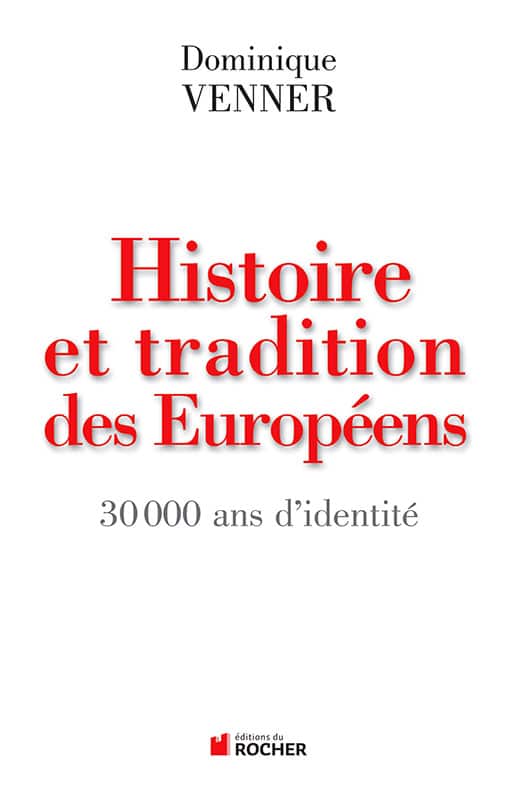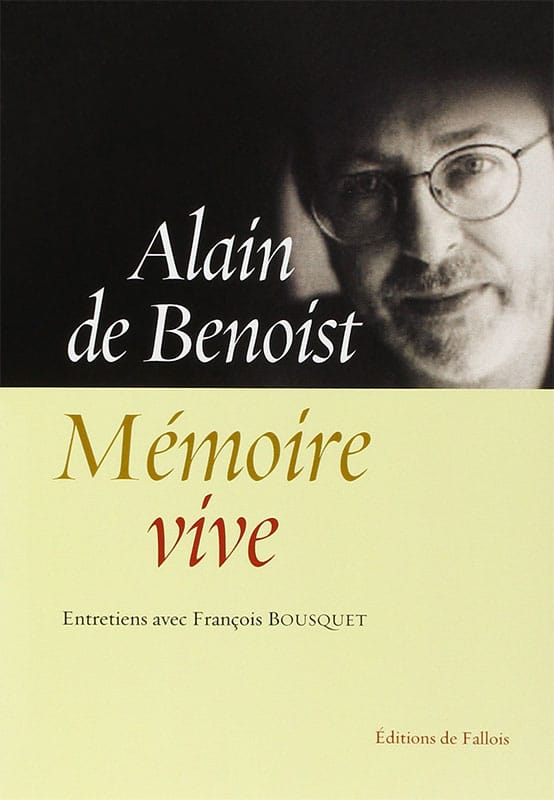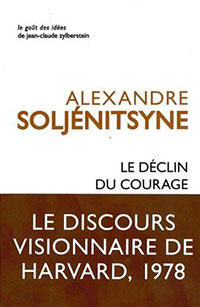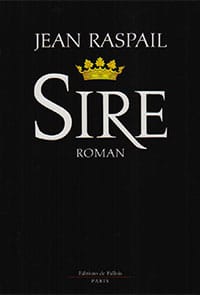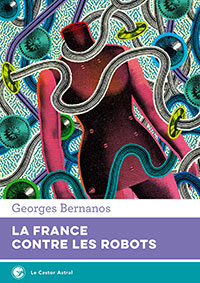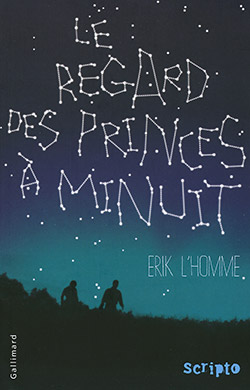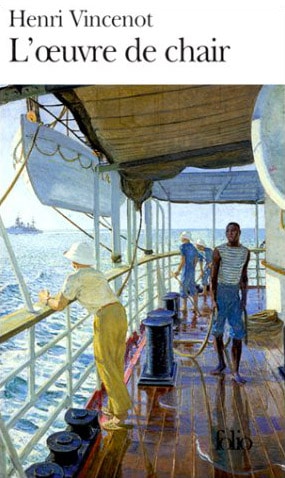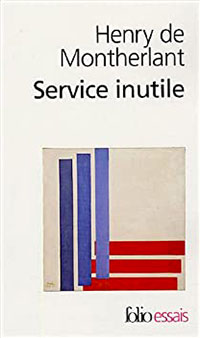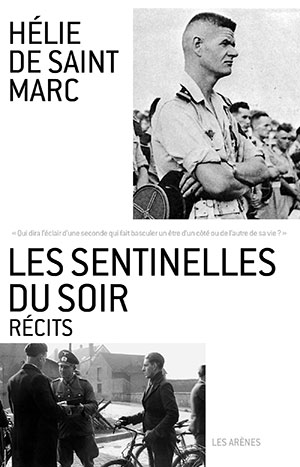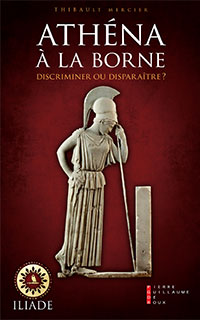Auteurs
Auteurs récemment ajoutés
Thèmes
Thèmes au hasard
Citations
Dernières citations mises en ligne
Un jour viendra où, vieux et las, je saurai trouver la paix parmi les animaux et les fleurs…
« Si vraiment aucune pierre, aucun sérac, aucune crevasse ne m’attend quelque part dans le monde pour arrêter ma course, un jour viendra où, vieux et las, je saurai trouver la paix parmi les animaux et les fleurs. Le cercle sera fermé, enfin je serai le simple pâtre qu’enfant je rêvais de devenir… »
Lionel Terray
Les Conquérants de l’inutile. Des Alpes à l’Annapurna, éditions Gallimard, coll. Hors série Connaissance, 1961
Le paganisme est tolérant par nature…
« Le paganisme est tolérant par nature, non seulement parce qu’il est (éventuellement) polythéiste, et que le polythéisme est déjà une forme, sublimée, de pluralisme, mais également parce qu’il n’est pas dualiste, parce qu’à la discontinuité fondamentale de Dieu et du monde il oppose la continuité dialectique de tout ce qui ─ hommes, dieux et “nature” ─ constitue et incarne le seul être qu’est le monde, parce qu’il pose en postulat qu’un dieu qui ne serait pas de ce monde ne saurait, précisément, être un dieu. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
Des sociétés telles que les nôtres, dépourvues de religion…
« En résumé, des sociétés telles que les nôtres, dépourvues de religion officielle, ne sont pas pour autant indemnes de croyances proprement théologiques fortement mâtinées d’idéologies. La modernité, contrairement à ce que prétendent les modernes, n’est pas athée. Je la vois plutôt traversée, de part en part, par une religiosité de l’universel, nantie de points d’applications résumés dans le catéchisme des Droits de l’Homme, lesquels relèvent de croyances désincarnées. »
Jean-François Gautier
La Polyphonie du monde (conversations avec Maxime Reynel), Éditions Krisis, 2022
Les spécialistes consacrent tant d’énergie…
« Les spécialistes consacrent tant d’énergie à enquêter sur la plausibilité des choses qu’ils finissent par en négliger la substance ! »
Sylvain Tesson
Un été avec Homère, éditions des Équateurs, 2018
C’est dans la commune que réside la force des peuples libres…
« C’est […] dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. »
Alexis de Tocqueville
De la démocratie en Amérique, 1835
Pour les créateurs à venir, de grands défis à relever
« Il y a là, pour les créateurs à venir, de grands défis à relever. Ils devront trouver des mots pour s’en sortir, des formes pour renouveler les termes d’un contrat tacite entre leurs arts et les sociétés qui les environnent. Elles attendront d’eux des représentations non pas fermées sur elles-mêmes, ni grandes ouvertes sur le vide, mais disponibles encore pour des méditations partagées, pour un agir dont les modalités spatiales restent à construire. Les paganismes antiques peuvent être pour eux de puissants inspirateurs. »
Jean-François Gautier
La Polyphonie du monde (conversations avec Maxime Reynel), éditions Krisis, 2022
Si donc nous-mêmes, nous n’avons pas la sagesse…
Le visage de cette contrée était sombre et fantastique…
« Le visage de cette contrée était sombre et fantastique : la guerre en avait balayé la grâce et y avait imprimé ses traits d’airain, pour l’effroi du contemplateur solitaire. »
Ernst Jünger
Orages d’acier (In Stahlgewittern), 1920, trad. Henri Plard, éditions Le Livre de Poche, 1989
Le matin, quand tu as de la peine à te réveiller…
« Le matin, quand tu as de la peine à te réveiller, dis-toi : je me réveille pour accomplir mon travail d’homme. Se peut-il que je sois de mauvaise humeur alors que je vais accomplir la tâche pour laquelle je suis né ? Suis-je constitué pour rester couché bien au chaud sous les couvertures ? »
Marc Aurèle
Pensées pour moi-même, trad. Frédérique Vervliet, éditions Arléa, 2004
La vérité… La vérité…
« La vérité… La vérité… Il y a quelque euphorie à la voir s’approcher… »
Jean Raspail
Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, éditions Albin Michel, 1981
Une fois de plus, la monarchie se révèle être…
« Une fois de plus, la monarchie se révèle être, en creux, d’une modernité criante face aux problèmes actuels. De fait, le roi n’est l’homme d’aucun parti, d’aucun lobby, notamment financier, puisqu’il ne doit son trône à personne si ce n’est à sa naissance et à la providence. »
Louis-Alphonse de Bourbon
« Que Pâques soit un moment d’espérance individuelle et de renouveau social », Marianne, 7 avril 2023
Je commençai, dès ce temps-là, à m’intéresser à l’histoire…
« Je commençai, dès ce temps-là, à m’intéresser à l’histoire (…). Parmi ses personnages, Caton d’Utique me toucha, à qui plaisait, non la cause victorieuse, mais la cause vaincue. Comme d’autres, je trouvais dans la fresque de l’Univers les ombres plus frappantes que les lumières, et plus profondes, et dans la tristesse le recueillement propice à la méditation – Hector et Hannibal, les Indiens et les Boers, Montezuma et Maximilien, empereur du Mexique. »
Ernst Jünger
Abeilles de verre (Gläserne Bienen), 1957, trad. Henri Plard, éditions Christian Bourgois, 1971
C’est par l’épreuve du feu qu’on reconnaît l’or pur…
« C’est par l’épreuve du feu qu’on reconnaît l’or pur. C’est par les épreuves qu’on reconnaît l’homme de cœur. Vois à quelle hauteur doit s’élever la vertu et tu concevras qu’on ne puisse monter si haut sans péril. »
Sénèque
La Providence, éditions Arléa, trad. François Rosso, 1996
L’intelligence est spontanément aristocratique…
« L’intelligence est spontanément aristocratique, car c’est la faculté de distinguer les différences et de fixer les rangs. »
Nicolás Gómez Dávila
Les Horreurs de la démocratie (tiré de Escolios a un texto implícito), 1977, trad. Michel Bibard, Éditions du Rocher/Anatolia, 2003
Pour mériter la paix, il ne suffit pas de ne pas désirer la guerre…
« Pour mériter la paix, il ne suffit pas de ne pas désirer la guerre. La véritable paix suppose un courage qui dépasse celui de la guerre : elle est activement créatrice, énergie spirituelle. On la conquiert en maîtrisant d’abord son démon intérieur, en bannissant de sa vie personnelle la haine, source de discorde. »
Ernst Jünger
La paix, 1943, trad. Banine et Armand Petitjean, éditions La Table Ronde, coll. La Petite Vermillon, 1992
Il ne s’agirait pas de mépriser le monde…
« Il ne s’agirait pas de mépriser le monde, ni de manifester l’outrecuidance de le changer. Non ! Il suffirait de ne rien avoir en commun avec lui. L’évitement me paraissait le mariage de la force avec l’élégance. Orchestrer le repli me semblait une urgence. »
Sylvain Tesson
Sur les chemins noirs, 2016, éditions Gallimard, coll. Folio, 2019
Actuellement, le rapport entre les métropoles et les anciennes colonies s’est inversé…
« Actuellement, le rapport entre les métropoles et les anciennes colonies s’est inversé et souvent le monde occidental, passant à l’autre extrême, fait preuve d’une complaisance servile. »
Alexandre Soljénitsyne
Le déclin du courage, discours à l’université de Harvard du 8 juin 1978, trad. Geneviève et José Johannet, éditions Les Belles Lettres, 2014
Anarchie féodale…
« “Anarchie féodale” : C’est ainsi que le terrorisme démocratique baptise, pour la dénigrer, la seule période de liberté concrète qu’ait connue l’histoire. »
Nicolás Gómez Dávila
Les Horreurs de la démocratie (tiré de Escolios a un texto implícito), 1977, trad. Michel Bibard, Éditions du Rocher/Anatolia, 2003
L’épreuve est nécessaire à la connaissance de soi…
« L’épreuve est nécessaire à la connaissance de soi. C’est l’expérience qui nous fait prendre la mesure de nos propres forces. »
Sénèque
La Providence, éditions Arléa, trad. François Rosso, 1996
Tu es un grand homme ? Peut-être…
« Tu es un grand homme ? Peut-être, mais comment en aurai-je la preuve si la Fortune ne te donne jamais l’occasion de manifester ton courage ? Si tu descends dans l’arène olympique sans qu’aucun concurrent ne t’y suive, tu auras les lauriers, sans doute, mais pas la victoire ! »
Sénèque
La Providence, éditions Arléa, trad. François Rosso, 1996
Tout ce qui dépasse la mesure est nuisible…
« Tout ce qui dépasse la mesure est nuisible. Et ce qu’il y a de plus dangereux, c’est le manque de tempérance dans la quête du bonheur : le cerveau se trouble, l’esprit est envahi d’inutiles fantasmes, une épaisse couche de brouillard rend floue la limite entre vrai et faux. Ne vaut-il pas mieux supporter, grâce à la vertu, une succession de maux plutôt que de se laisser écraser par un bien-être infini et démesuré, en mourant doucement d’inanition, en étouffant d’indigestion ? »
Sénèque
La Providence, éditions Arléa, trad. François Rosso, 1996
Ce qui n’échappa pas…
« L’expression verbale, ou lèthé, “ce qui n’échappa pas”, est très importante. Sa forme nominale tardive alèthéïa a été traduite en français par “vérité”. Mais il faut être prudent ; dans le contexte homérique, cette vérité (le mot n’apparaît que deux fois dans l’Iliade) n’est pas une essence abstraite, un absolu situé hors du monde et permettant de distinguer le vrai du faux ; il s’agit plutôt d’une occasion vécue, liée à la sagacité, à la perspicacité, au discernement, à l’effort de contourner ce que la perception “oublie” de voir. »
Jean-François Gautier
La Polyphonie du monde (conversations avec Maxime Reynel), éditions Krisis, 2022
Si le sacré a semblé un temps disparaître…
« Si le sacré a semblé un temps disparaître, c’est qu’il était ailleurs que là où on l’a cherché. Il n’était plus dans les religions traditionnelles qui perdaient toutes des fidèles. Mais les questions autour desquelles tourne le sacré, quant à elles, demeuraient intactes. Il est certain qu’elles frappaient à d’autres portes et s’orientaient moins vers celles des Églises instituées que vers celles des sciences et des laboratoires. Elles quêtaient là quelques vérités sur ce qu’il en est de la Vie, de l’Univers, de l’avenir des hommes et du monde. Mais les sciences n’étant pas compétentes sur ces sujets, elles n’avaient rien à répondre sur le fond. Leur absence de réponse, loin d’être un échec interne, est un simple constat de dessaisie des dossiers. »
Jean-François Gautier
L’univers existe-t-il ?, éditions Actes Sud, coll. Le génie du philosophe, 1994
Dans la perspective de la Bible…
« Dans la perspective de la Bible, la survenue de la fin des temps est liée à l’avènement d’un statut de l’humanité plus foncièrement égalitaire, plus homogène et plus “pacifique”. L’histoire reposant sur le conflit, il n’y aura plus de conflits ─ donc plus de diversité susceptible de “dégénérer” en affrontements. La maîtrise n’aura plus de raison d’être ; toutes les formes d’ “aliénation” auront disparu. Le monde sera transfiguré ; ce sera le contraire du monde. L’homme sera libéré de la civilisation. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
La “grammaire” du monothéisme judéo-chrétien…
« La “grammaire” du monothéisme judéo-chrétien n’est pas d’abord religieuse, elle est morale. La bible est avant tout un livre moral, en même temps qu’un livre où s’exprime une certaine morale ; un livre que caractérise l’hyper-moralisme dénoncé par Arnold Gehlen. Le judéo-christianisme moralise tout ; toute sphère d’activité humaine s’y trouve ramenée en dernière instance à la morale ; l’esthétique ou la politique, pour ne citer qu’elles, perdent entièrement leur autonomie ; dans l’ordre des affaires humaines, la Bible installe les conditions d’apparition de la nomocratie. Ce primat de la morale fait que Iahvé est d’abord un juge, un distributeur de sanctions. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
À l’origine du monothéisme…
« À l’origine du monothéisme, Nietzsche pensait pouvoir identifier la trace d’une ancienne “altération de la personnalité” : la marque d’une impuissance compensée. Pour ne pas perdre la face, celui qui ne peut pas prétend qu’il ne veut pas ─ ou que ce serait mal de vouloir. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
Dans le paganisme, on ne saurait séparer le bien du beau…
« Dans le paganisme, on ne saurait séparer le bien du beau ; et c’est assez normal, puisque ce qui est bien, ce sont d’abord les formes les plus achevées de ce monde. Par la suite, l’art ne peut lui-même être dissocié de la religion. L’art est sacré. Non seulement les dieux peuvent être représentés, mais c’est en tant qu’ils peuvent être représentés, en tant que les hommes en assurent perpétuellement la re-présentation, qu’ils ont un plein statut d’existence. Toute la spiritualité européenne repose sur la représentation comme médiation entre le visible et l’invisible, sur la représentation au moyen de figures imagées et de signes qui s’échangent contre un sens intimement lié au réel, caution même de cette incessante et mutuelle conversion du signe et du sens. La beauté est signe visible de ce qui est bon ; la laideur, signe visible de ce qui est non seulement difforme ou raté mais mauvais. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
Le monde, selon la Bible, doit être désacralisé…
« Le monde, selon la Bible, doit être désacralisé. La nature doit ne plus être “animée” : les dieux doivent cesser d’y habiter et d’y donner à l’homme une image transfigurée de lui-même. Ce qui est le plus opposé au monothéisme judéo-chrétien, c’est la sourde religiosité cosmique, la sourde religiosité de l’univers. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
Iahvé est le dieu qui refuse l’Autre…
« Iahvé est le dieu qui refuse l’Autre, le dieu qui, dans un premier temps, se pose lui-même comme supérieur aux autres dieux, puis, dans un deuxième temps, qui déclare les tenir pour inexistants. Car l’autre dieu n’existe pas. Il est représenté comme un dieu, mais il n’est qu’une “idole”, apparence de dieu, dieu sans valeur de dieu. Transposé sur le plan séculier, ce raisonnement paraîtra légitimer toutes les formes d’altérophobie, tous les racismes, toutes les exclusions. De la notion de dieu sans valeur de dieu, on passera à celle d’homme sans valeur d’homme, de vie sans valeur de vie. L’homme agira avec les autres hommes à la façon dont Iahvé agit avec les autres dieux. Dans le monothéisme de la Bible, l’enfer, au sens propre, ce sont les autres. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
Chacun doit traverser un cercle de feu…
« Chacun doit traverser un cercle de feu, une épreuve par laquelle il éprouve qu’il n’y a pas de Vérité, de tracé obligatoire, mais seulement des actes à accomplir. Admettre qu’il n’y a pas de Vérité abstraite, hors sol, voilà une épreuve. Ne pas accepter de la franchir condamne ce que vous appelez les “figurations du devenir” à se réfugier dans les idéologies préparées à l’avance, et préparées par d’autres, dont les intentions ne sont pas nécessairement enviables. »
Jean-François Gautier
La Polyphonie du monde (conversations avec Maxime Reynel), éditions Krisis, 2022
Construire le kosmos de l’expérience du monde…
« Le verbe kosmein signifiait “mettre en bon ordre” mais aussi “célébrer” et “orner”. Construire le kosmos de l’expérience du monde, c’était en trouver le régulateur, en formuler une certaine bienséance qui n’est pas sans rapport avec la beauté. Ce travail-là était cosmétique, il dessinait une parure sur le visage stellaire de la nuit qui, sans un peu d’ornement l’apprivoisant aux yeux des hommes, aurait ouvert sur d’insondables épouvantes et détruit l’ordre fragile de la Cité. »
Jean-François Gautier
L’univers existe-t-il ?, éditions Actes Sud, coll. Le génie du philosophe, 1994
Chez Pyrrhon, il n’y a que de l’apparaître…
« Chez Pyrrhon, il n’y a que de l’apparaître ; chez Kant, il y a une différenciation entre l’apparaître et l’être, entre le visible et la vérité. Entre les deux attitudes, il est toujours possible d’en glisser une troisième, celle de Montaigne. Je l’actualise ainsi : derrière ce qui apparaît, dirait Montaigne, il n’y a apparemment pas d’être. »
Jean-François Gautier
La Polyphonie du monde (conversations avec Maxime Reynel), éditions Krisis, 2022
L’échec des sciences nourrit-il vraiment le terreau du sacré…
« L’échec des sciences nourrit-il vraiment le terreau du sacré ? Il faut se méfier des fausses correspondances et des vases mal communicants. L’objet des métaphysiques et des religions n’est pas un immense vide que viendrait remplir le savoir rationnel. Ces activités de l’esprit ne portent pas sur le mesurable ni sur l’expérimental ; ce qui fait qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les sciences sur une sorte de marché des certitudes inaliénables. »
Jean-François Gautier
L’univers existe-t-il ?, éditions Actes Sud, coll. Le génie du philosophe, 1994
J’en veux plus aussi de cette vie…
« J’en veux plus aussi de cette vie capable de vous hisser jusqu’à la majesté auguste et gracile de La Victoire de Samothrace, la déesse qui, du haut de son escalier, depuis le Louvre, guide les navigateurs de la vie et de la mort que nous sommes tous : hommes et femmes secoués par le déferlement des vagues de l’amour et de la passion, là où, en étreignant la chair nous atteignons l’âme, là où, en nous enfonçant au plus profond de notre condition animale, nous nous élevons au plus haut de notre condition spirituelle. »
Javier Portella
N’y a‑t‑il qu’un dieu pour nous sauver ?, éditions La Nouvelle Librairie, coll. Dans l’arène, 2021
Aligner les pierres…
« Aligner les pierres : la plus ostensible preuve que l’homme pouvait ré-agencer le monde. Le menhir était la représentation de sa volonté. La géologie avait couché les strates. L’homme les relevait et couvrait la terre des preuves de son pouvoir. Le menhir devenait le coup d’envoi de l’âge technique, pierre inaugurale de la transformation du réel. On imaginait le raccourci, façon Stanley Kubrick : un mégalithe puis la fission de l’atome. »
Sylvain Tesson
Avec les fées, Éditions des Équateurs, coll. Littérature, 2024
Il y a donc dans la perception…
« Il y a donc dans la perception un paradoxe de l’immanence et de la transcendance. Immanence, puisque le perçu ne saurait être étranger à celui qui perçoit ; transcendance, puisqu’il comporte toujours un au-delà de ce qui est actuellement donné. »
Maurice Merleau-Ponty
Le primat de la perception, Éditions Verdier, coll. Poche, 2014 (réédité en 2023)
La perception est donc un paradoxe…
« La perception est donc un paradoxe, et la chose perçue elle-même est paradoxale. Elle n’existe qu’en tant que quelqu’un peut l’apercevoir. »
Maurice Merleau-Ponty
Le primat de la perception, Éditions Verdier, coll. Poche, 2014 (réédité en 2023)
Pour nous, modernes, la colère est une révolte contre le sort…
Politique signifiait pour nous : destin…
« Politique signifiait pour nous : destin. En dehors de notre sphère la politique était gouvernée par les intérêts. Certes, étant décidés à ne nous soustraire à aucun fardeau, à ne nous écarter d’aucune nécessité, à attaquer les choses comme elles se présentaient sur le chemin qui devait nous conduire à l’accomplissement de nous-mêmes, nous nous aventurions aussi dans le monde des affaires et des trafics, un monde plein de secrets où la vie apparaît sous la lumière la plus vive ; pourtant nous reconnaissions qu’une entente était impossible entre ce monde et le nôtre. Et pour cette raison nous ne la cherchions même pas. »
Ernst von Salomon
Les Réprouvés (Die Geächteten), 1930, trad. Andhrée Vaillant et Jean Kuckenberg, éditions Plon, coll. Feux croisés, 1931, éditions Bartillat, coll. Omnia Poche, 2011
L’acceptation de la souffrance en tant que preuve…
« L’acceptation de la souffrance en tant que preuve de courage était le thème des rites primitifs d’initiation dans le lointain passé, et tous ces rites étaient en même temps des cérémonies de la mort et de la résurrection. »
Yukio Mishima
Le soleil et l’acier, 1968, trad. Tanguy Kenec’hdu, éditions Gallimard, coll. Du monde entier, 1973, éditions Gallimard, coll. Folio, 1993
Pourquoi les hommes de bien endurent-ils tant d’infortunes…
« Pourquoi les hommes de bien endurent-ils tant d’infortunes alors que rien de mal ne peut leur arriver ? En effet, les contraires sont inconciliables ! De même que les fleuves, les pluies torrentielles et les sources médicinales ne peuvent changer la saveur de la mer, ne peuvent pas l’adoucir, de même, les élans de l’adversité ne peuvent troubler une âme courageuse : bien au contraire, ils consolident sa forte nature et c’est celle-ci qui s’impose aux évènements car elle est plus forte que tout ce qui vient de l’extérieur. »
Sénèque
La Providence, éditions Arléa, trad. François Rosso, 1996
Sans adversité, le courage s’amoindrit…
« Sans adversité, le courage s’amoindrit. Il n’éclate dans toute sa puissance, dans toute sa valeur, que lorsque les événements le sollicitent. »
Sénèque
La Providence, éditions Arléa, trad. François Rosso, 1996
Le véritable courage est avide du danger…
« Le véritable courage est avide du danger. Il songe au but qu’il poursuit, non aux souffrances qu’il rencontrera en chemin, conscient que ces souffrances font partie de sa gloire. »
Sénèque
La Providence, éditions Arléa, trad. François Rosso, 1996
Les fruits de la guerre…
« Les fruits de la guerre doivent être universels. »
Ernst Jünger
La paix, 1943, trad. Banine et Armand Petitjean, éditions La Table Ronde, coll. La Petite Vermillon, 1992
La pensée païenne, fondamentalement attachée à l’enracinement…
« La pensée païenne, fondamentalement attachée à l’enracinement et au lieu, comme centre privilégié de cristallisation de l’identité, ne peut que rejeter toutes les formes religieuses et philosophiques d’universalisme. Celui-ci trouve au contraire son fondement dans le monothéisme judéo-chrétien. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
C’est seulement dans la souffrance qu’on fait la preuve de sa vertu…
« C’est seulement dans la souffrance qu’on fait la preuve de sa vertu. La Fortune nous frappe-t-elle, nous meurtrit-elle ? Supportons ses blessures : ce ne sont pas des sévices qu’elle nous impose mais un combat qu’elle nous propose, et ce combat, plus souvent nous le livrerons, plus nous sentirons nos forces grandir. »
Sénèque
La Providence, éditions Arléa, trad. François Rosso, 1996
Au travers d’une série de représentations légendaires ou symboliques…
« Au travers d’une série de représentations légendaires ou symboliques, le mythe indo-européen ne cesse de célébrer le pouvoir créateur illimité de l’homme. Quand il décrit les dieux comme les auteurs de leur propre existence, ce n’est pas pour les opposer aux créatures humaines, mais pour proposer à celles-ci un modèle idéal auquel il leur faut tenter de s’égaler. »
Alain de Benoist
Comment peut-on être païen ?, éditions Albin Michel, 1981
C’est peut-être le mensonge le plus éclatant…
« C’est peut-être le mensonge le plus éclatant et le moins aperçu du monde moderne que d’avoir dénommé justice sociale le cadavre de la justice. Ce que nos contemporains entendent par justice sociale est de rendre à chacun, pris individuellement, ce qui lui est dû, sur un pied d’égalité avec tous les autres membres du groupe dont il fait partie. »
Marcel De Corte
De la force, 1980, éditions Dominique Martin Morin, 2019
Qu’importe ma vie ! …
« Qu’importe ma vie ! je veux seulement qu’elle reste jusqu’au bout fidèle à l’enfant que je fus. »
Georges Bernanos
Les grands cimetières sous la lune, Librairie Plon, 1938, coll. Le Livre de Poche, 1977
Le dégoût me serre la gorge…
« Le dégoût me serre la gorge. L’ordre bourgeois. J’ai manqué à cet ordre. Ainsi disent-ils. Ils sont dans le droit. Je vomis leur droit. »
Ernst von Salomon
Les Réprouvés (Die Geächteten), 1930, trad. Andhrée Vaillant et Jean Kuckenberg, éditions Plon, coll. Feux croisés, 1931, éditions Bartillat, coll. Omnia Poche, 2011