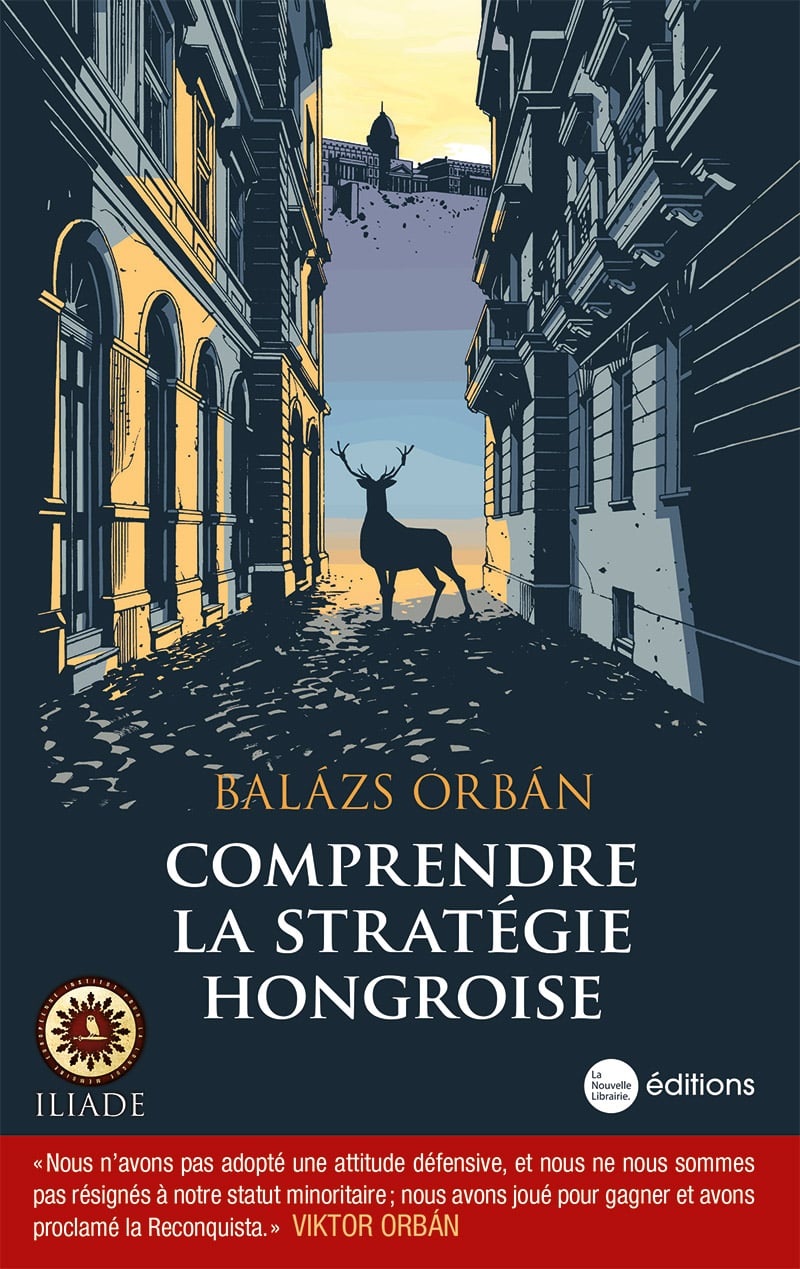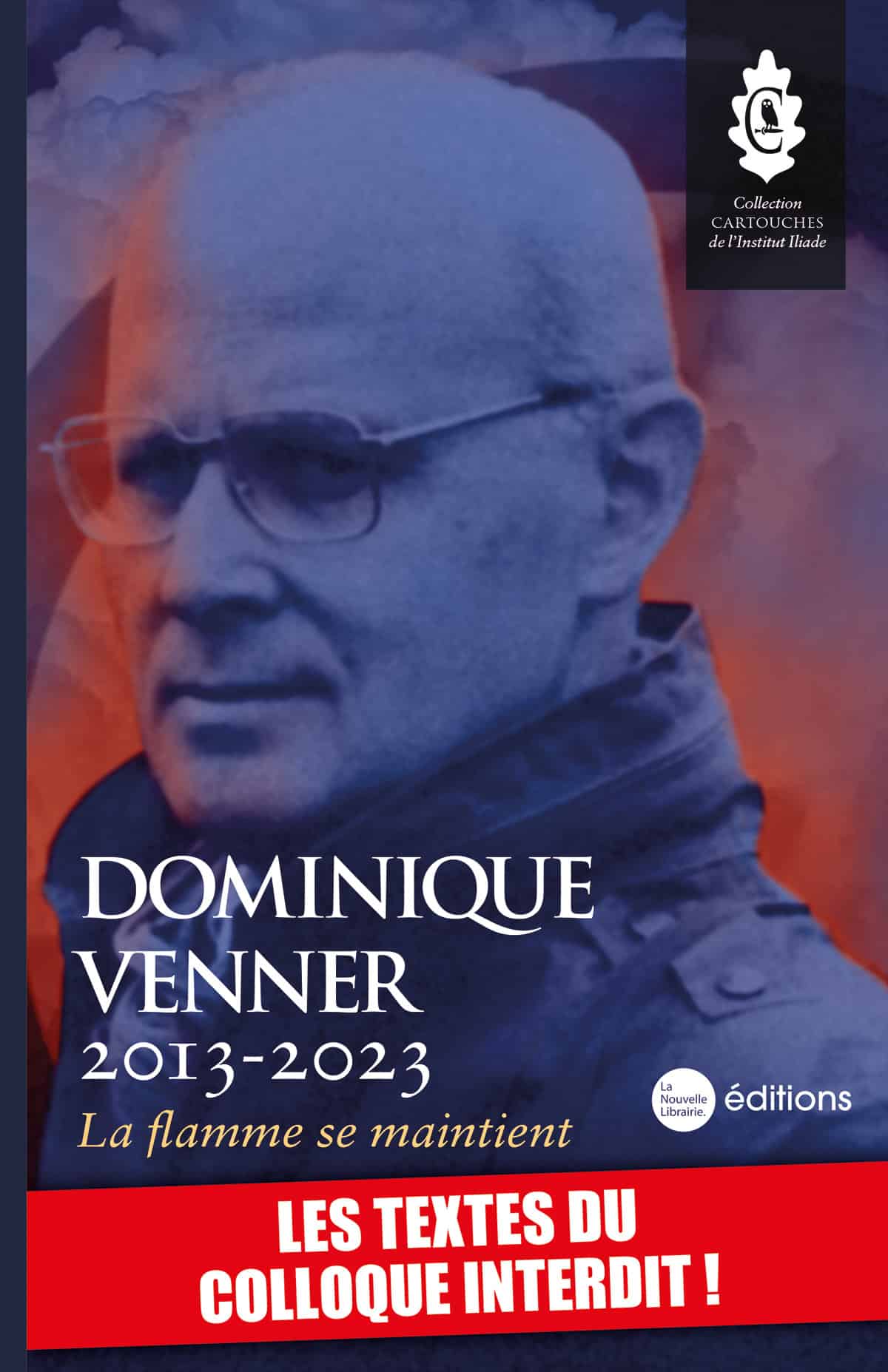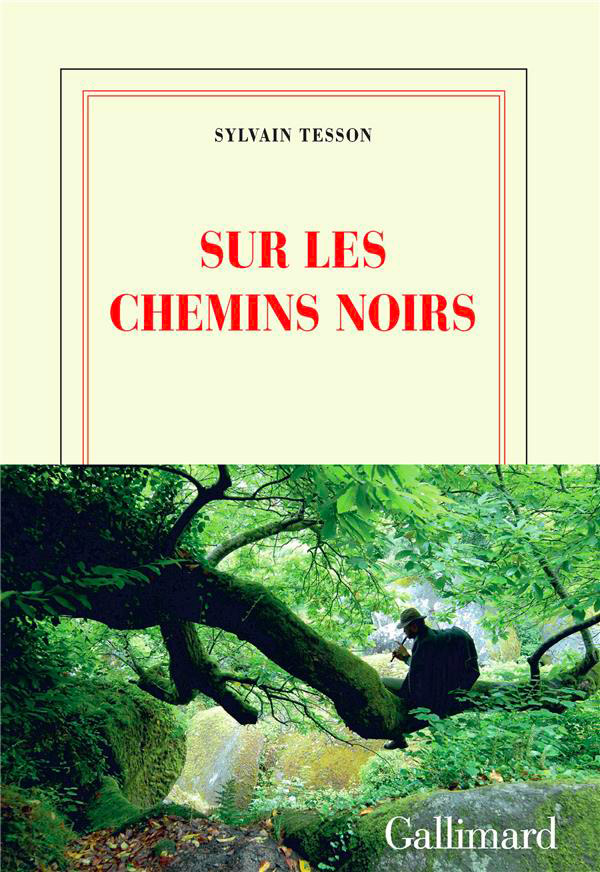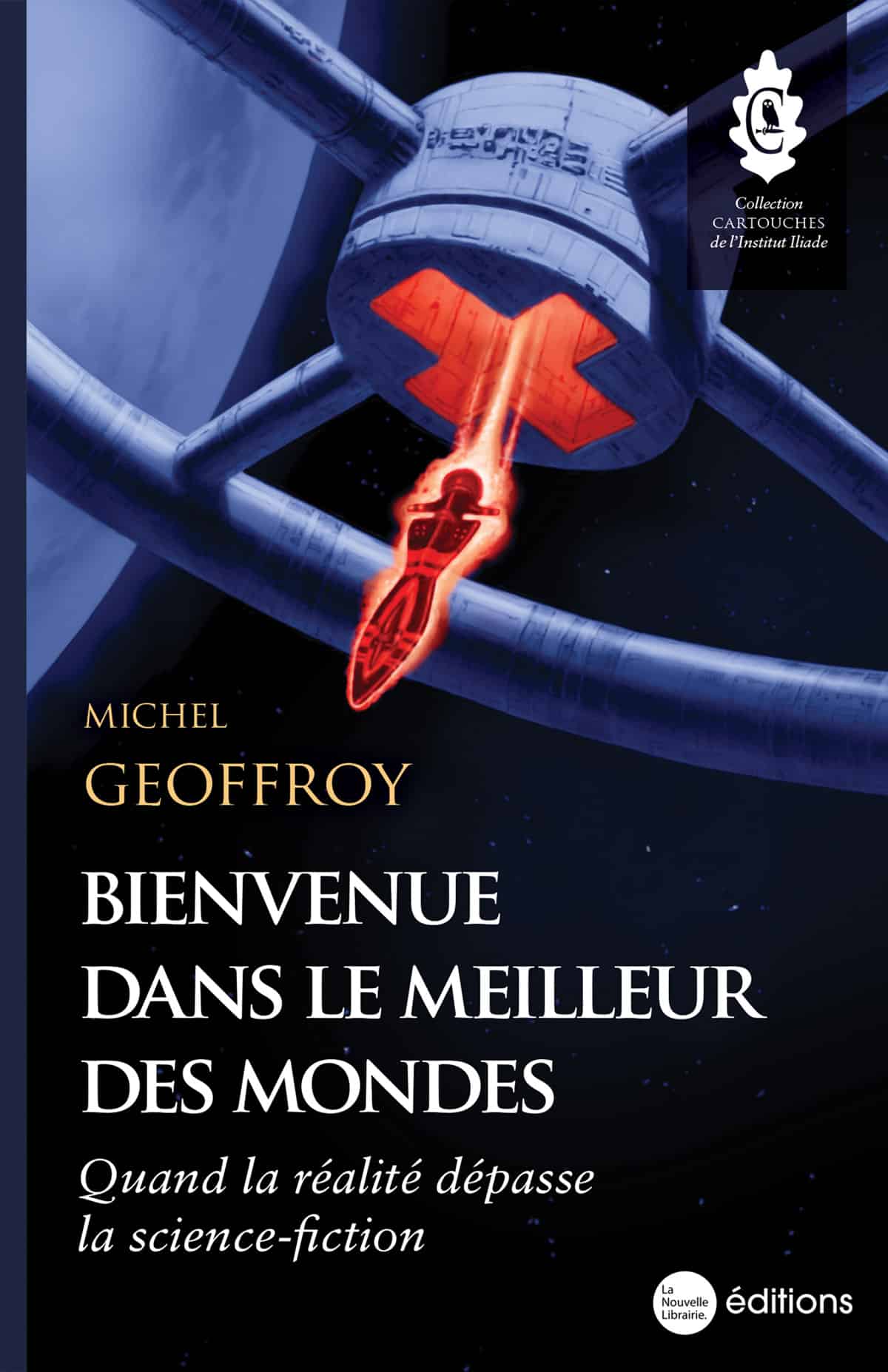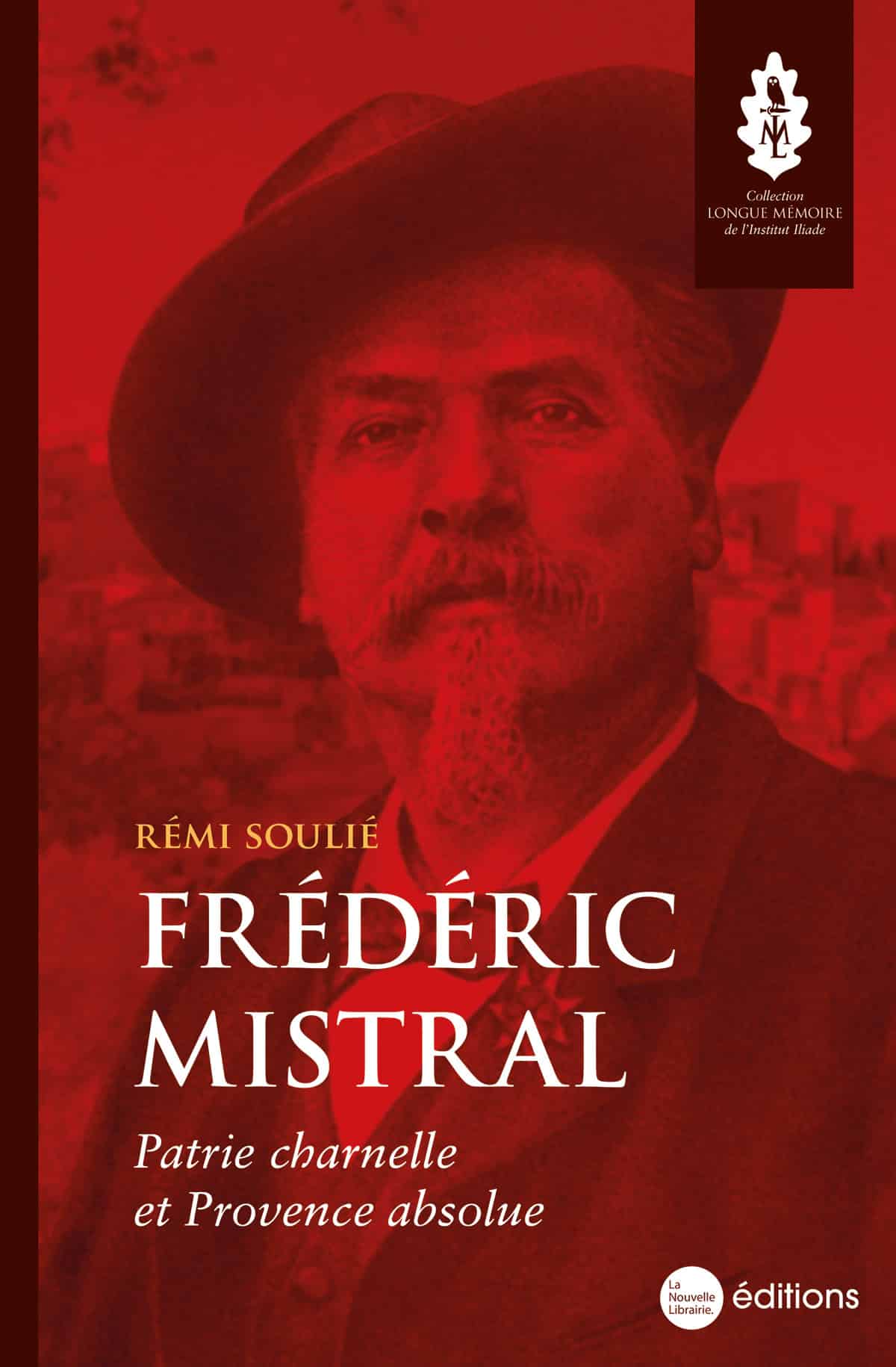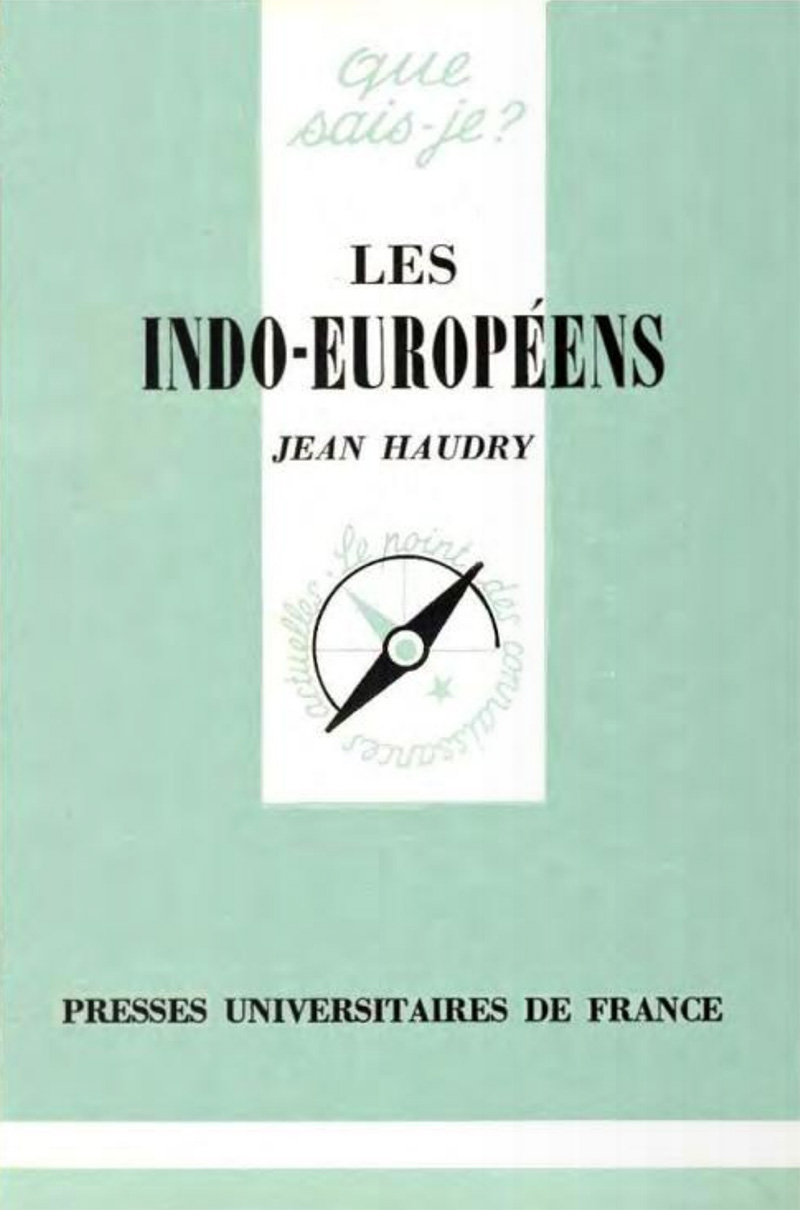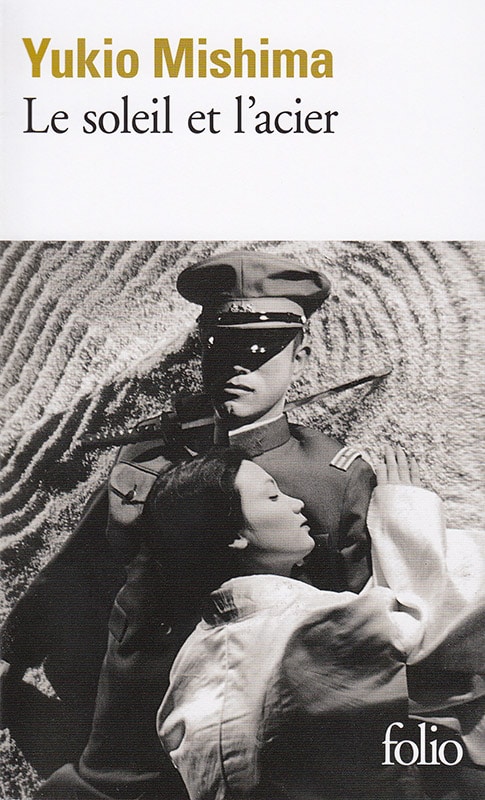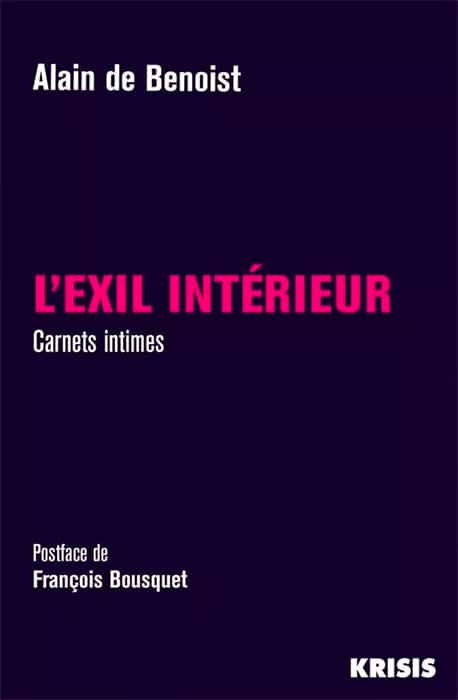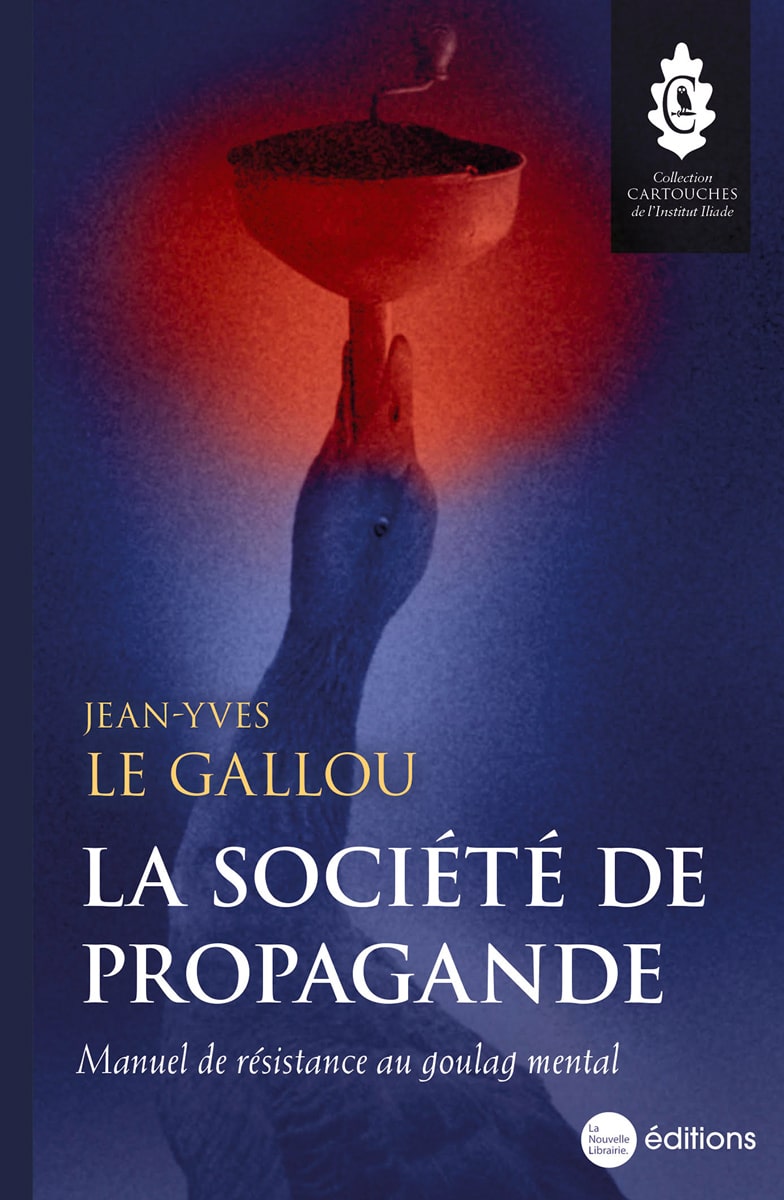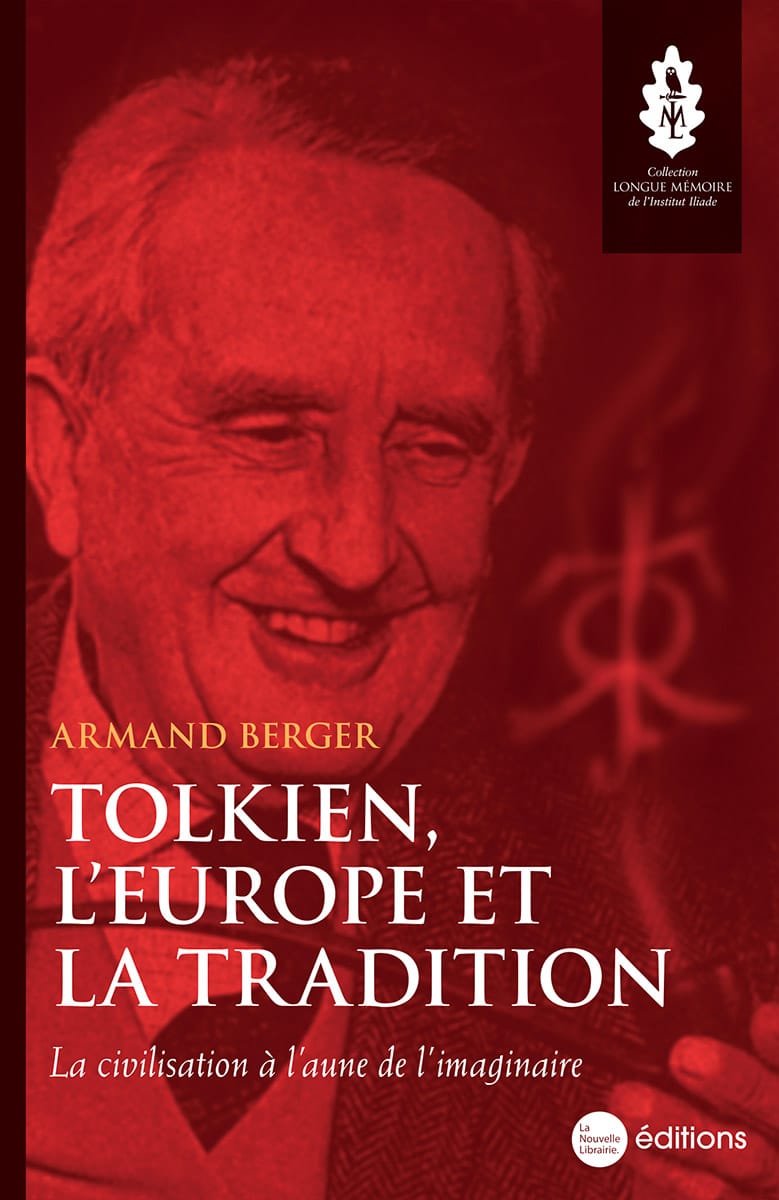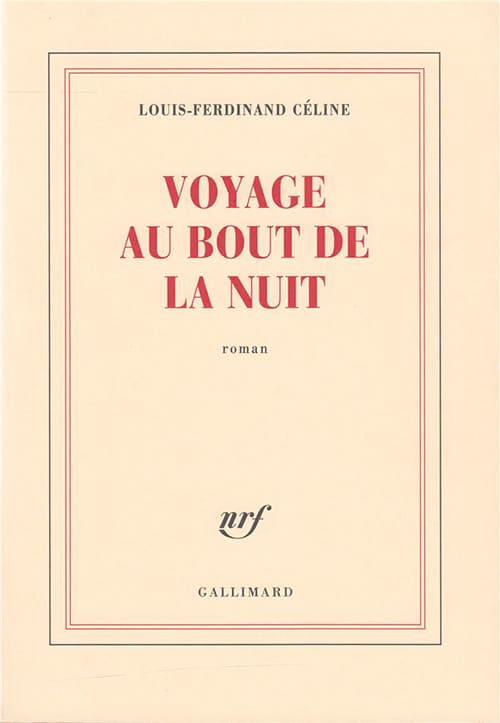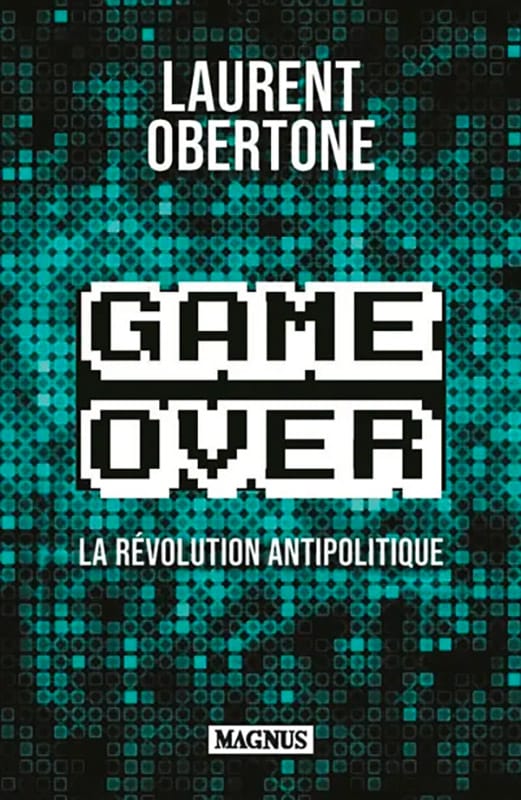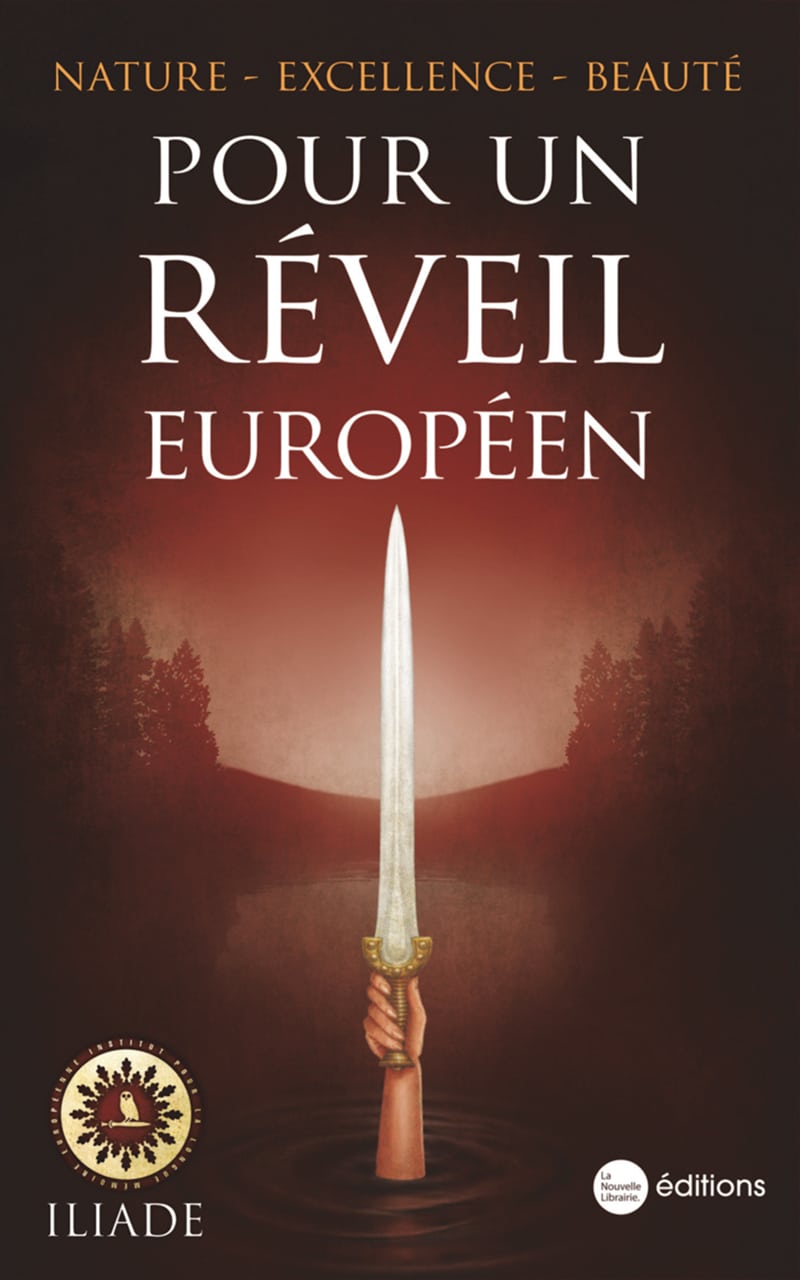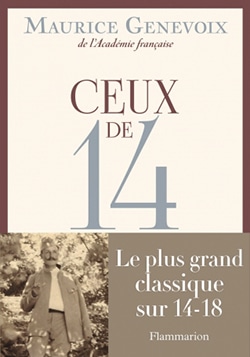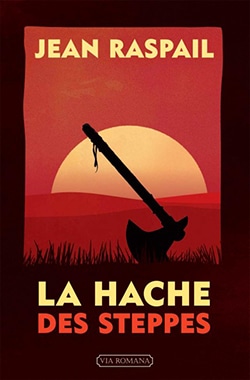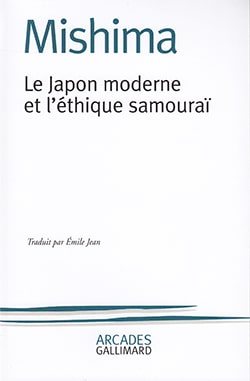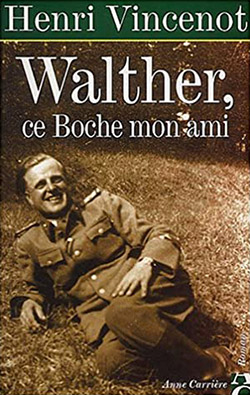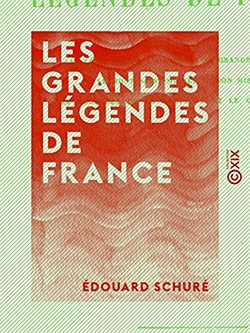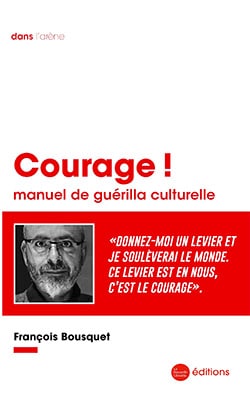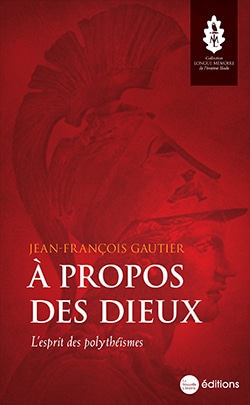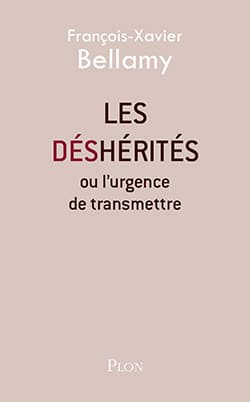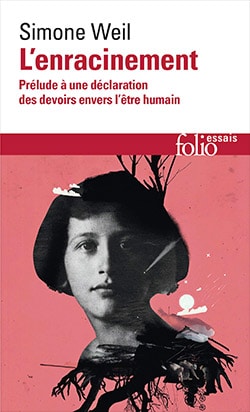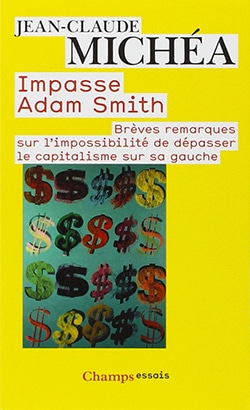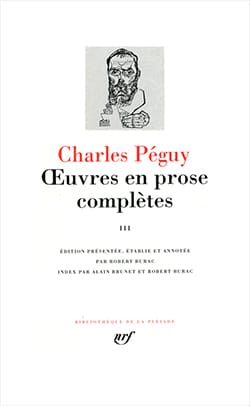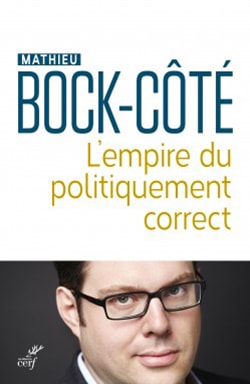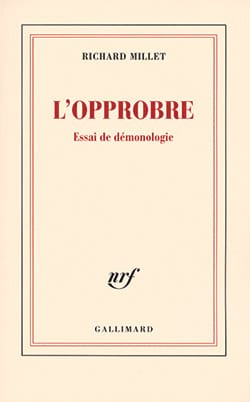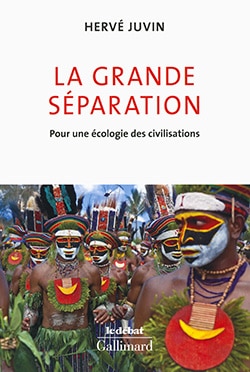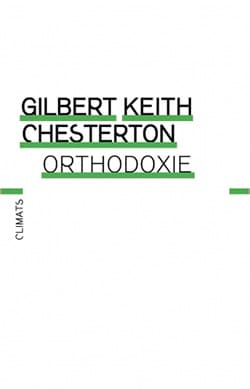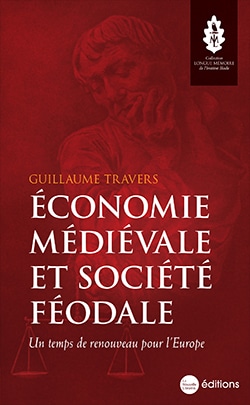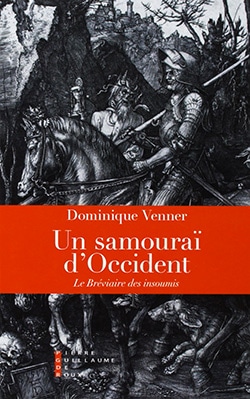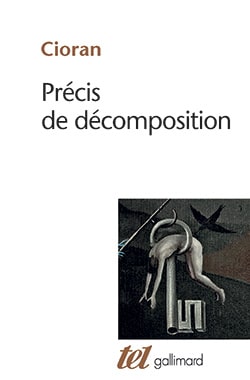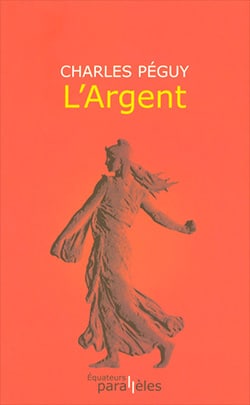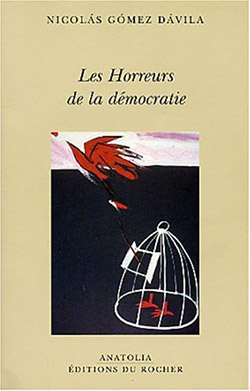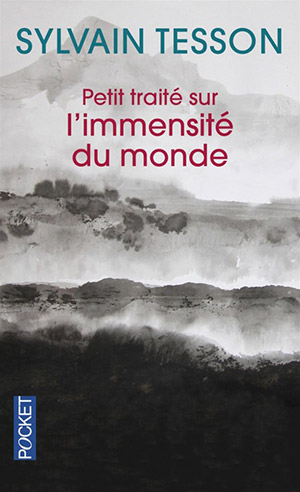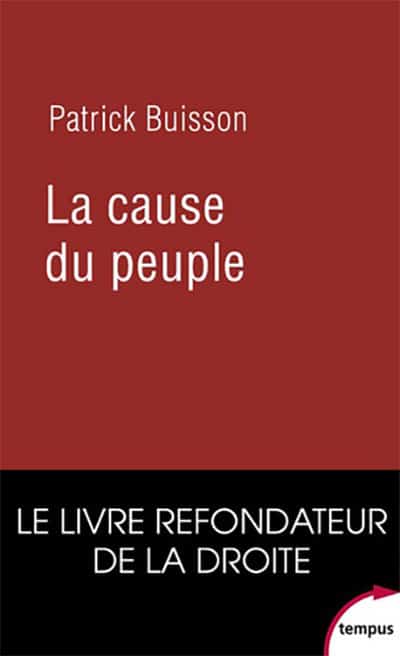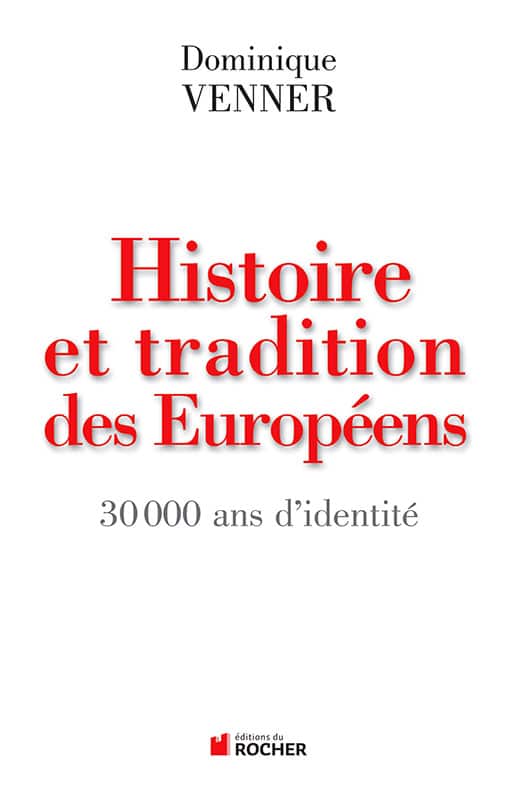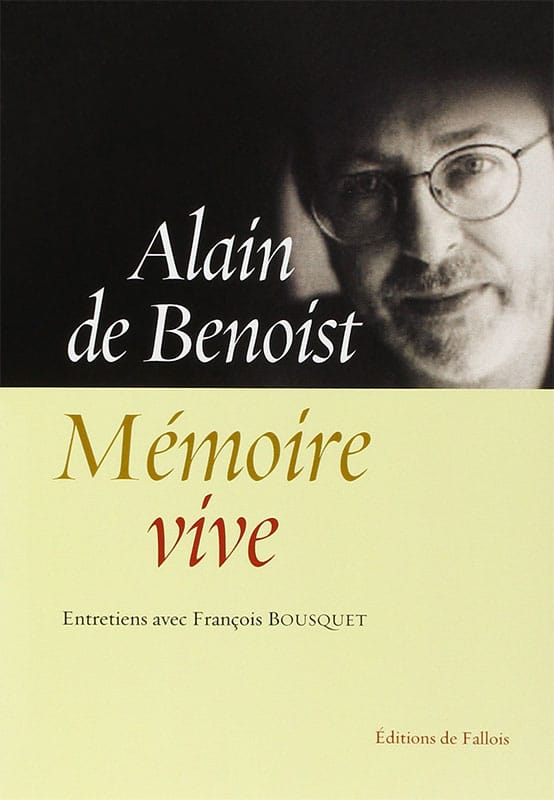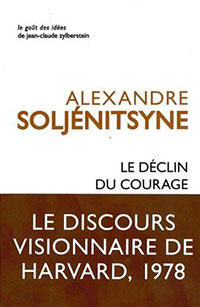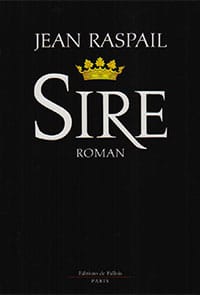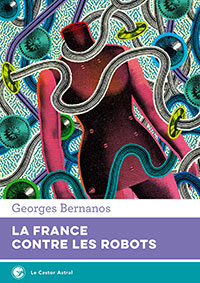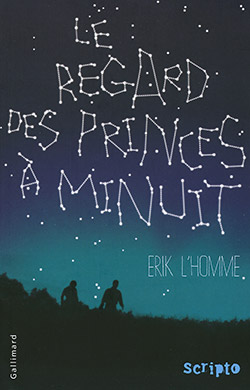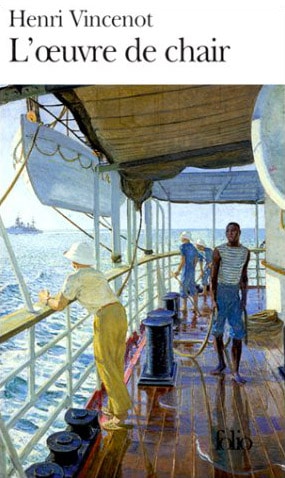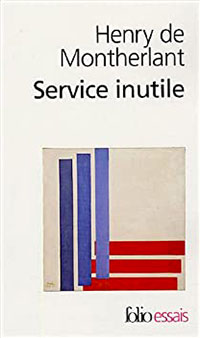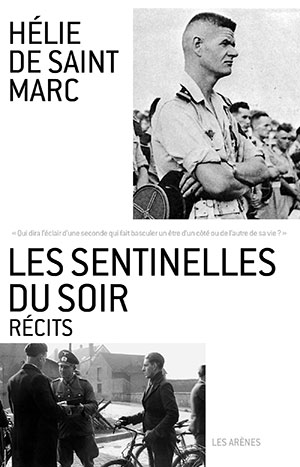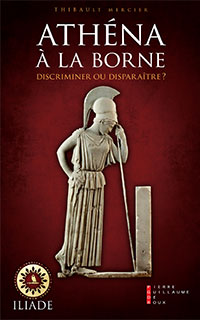Thème
Citations sur l'héroïsme
J’ai proposé, dans d’autres livres, une morale tragique…
« J’ai proposé, dans d’autres livres, une morale tragique. Une morale des sommets d’où descendent, vers le champ des hommes, les maîtres et les héros. Si j’ai fortifié mes lecteurs, je n’ai pas perdu mon temps. Si je leur ai arraché les écailles des yeux, nous serons alors au moins quelques-uns à nous regarder sans obscénité, dans la foule, et quelle que soit notre race – celle des héros admirables qui vont, ou celle de ceux qui, plus infirmes, les suivent, ou encore celle de ceux qui regardent passer la colonne avec, dans les yeux, l’admiration qui révère – oui, quelle que soit notre race, nous saurons qu’elle est bonne. J’ai célébré le chevalier de Dürer qui va, accompagné de la Mort et guetté par le Diable. Derrière lui, je vois des soudards qui le suivent et auxquels il trace la route, dans la sombre forêt. Sur son passage, les paysans saluent et se taisent. Chevalier et soudards vont vers un lointain où il y a la guerre. Ils ne demandent rien. Ils vont mourir pour toi, paysan, pour ta forêt, tes cochons noirs, tes trois poules étiques, ta masure de chaume et tes enfants qui reniflent. Regarde-les passer. Si tu les salues et si tu ne vas pas, courant par traverses et raccourcis, prévenir l’ennemi qui les attend, tu es digne d’eux. Cette dignité, c’est tout ce qu’on te demande. »
Jean Cau
Pourquoi la France, éditions de La Table Ronde, 1975
L’essentiel d’un destin que résuma aux Thermopyles…
« L’essentiel d’un destin que résuma aux Thermopyles l’épitaphe de Simonide : obéir à une loi. Il est admis en Grèce que Lacédémone représente par excellence cette chose toute grecque, ignorée du reste du monde oriental et qui fonde non seulement la cité, mais la science et la philosophie : le règne de la loi, et, plus encore, l’héroïsation de la loi. La loi oppose un être abstrait, rationnel et fixe à la domination personnelle et arbitraire d’un homme. C’est ce que dans Hérodote Démarate apprend à Xerxès : « La loi est pour eux un maître absolu ; ils la redoutent beaucoup plus que tes sujets ne te craignent. Ils obéissent à ses ordres, et ses ordres, toujours les mêmes, leur défendent la fuite. » Cette figure vivante de la loi qu’on aperçoit au pied du Taygète donne à Sparte, dans l’hellénisme religieux et calme du temps des guerres médiques, une prestige, une autorité, un primat analogues à ceux que reçoivent Delphes de la Pythie, et Olympie de l’Altis. Être soumis à la loi c’est durer par elle, selon elle, et Sparte c’est la chose qui dure.
Thucydide attribue le secret de sa puissance à ce fait que depuis quatre cent ans elle est régie par la même constitution. Représentants de la loi les Spartiates sont pourtant les ennemis de la tyrannie, et c’est en intervenant dans les villes contre les tyrans qu’ils s’habituent à intervenir dans les affaires des cités. Seuls d’ailleurs parmi les Grecs ils ont conservé l’ancienne royauté homérique, en la divisant pour lui enlever sa force d’agression intérieure et de tyrannie. Toutes les magistratures, héréditaires ou collectives restant collégiales, l’un réside vraiment dans la loi, et dans la loi seule. »
Albert Thibaudet
La campagne avec Thucydide, 1922
En 1808, au cours de son voyage dans l’Ouest, Napoléon…
« En 1808, au cours de son voyage dans l’Ouest, Napoléon rencontra aux Quatre-Chemins-de‑l’Oie une héroïne de la grande révolte vendéenne. À vingt ans, elle avait combattu les Bleus pistolet au poing. On la présenta à l’Empereur qui l’embrassa et la fit embrasser par l’Impératrice. À ce moment, un homme s’avança. Napoléon l’interrogea :
— Et vous, monsieur qui saluez si bas, qui êtes-vous ?
— Mais, répondit l’autre, je suis le maire de Saint-Florent, le frère de mademoiselle Regrenil.
— Que faisiez-vous, interrogea l’Empereur, pendant que votre sœur se battait si bien ?
Et le maire, se croyant habile, répondit :
— Sire, moi, j’étais neutre.
— Neutre ! éclata Napoléon, alors vous n’êtes qu’un lâche, un jean-foutre.
Et il le chassa de sa vue. »
Dominique Venner
Le Cœur rebelle, Les Belles Lettres, 1994, réédition Pierre-Guillaume de Roux, 2014
Que faire quand la fortune se dérobe…
« Que faire quand la « fortune » se dérobe, quand le facteur « porteur » est absent ? On peut, bien entendu, de façon très européenne, se jeter quand même dans une action inutile mais héroïque. En fait, il y a des moments où il faut savoir se retirer en soi en attendant que la situation change. Et elle change toujours [car] l’Histoire est plus riche d’enseignements que tous les concepts que nous fabriquons pour la saisir. »
Dominique Venner
L’Imprévu dans l’Histoire, éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2012
L’Iliade n’est pas seulement le poème de la guerre de Troie…
« L’Iliade n’est pas seulement le poème de la guerre de Troie, c’est celui de la destinée telle que la percevaient nos ancêtres boréens, qu’ils soient grecs, celtes, germains, slaves ou latins. Le Poète y dit la noblesse face au fléau de la guerre. Il dit le courage des héros qui tuent et meurent. Il dit le sacrifice des défenseurs de leur patrie, la douleur des femmes, l’adieu du père à son fils qui le continuera, l’accablement des vieillards. Il dit bien d’autres choses encore, l’ambition des chefs, leur vanité, leurs querelles. Il dit encore la bravoure et la lâcheté, l’amitié, l’amour et la tendresse. Il dit le goût de la gloire qui tire les hommes à la hauteur des dieux. Ce poème où règne la mort dit l’amour de la vie et aussi l’honneur placé plus haut que la vie, et qui rend plus fort que les dieux. »
Dominique Venner
Le Choc de l’histoire, Via Romana, 2011
Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l’Iliade, c’est la force…
« Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l’Iliade, c’est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L’âme humaine ne cesse pas d’y apparaître modifiée par ses rapports avec la force ; entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposer, courbée sous la contrainte de la force qu’elle subit.
Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document ; ceux qui savent discerner la force, aujourd’hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau, le plus pur des miroirs. »
Simone Weil
L’Iliade ou le poème de la force, 1941, éditions de l’éclat, coll. Éclats, 2014
Nous avons perdu notre âme parce que nous…
« Nous avons perdu notre âme parce que nous avons perdu le sens des valeurs communes qui formaient l’antique “sagesse” de nos peuples. Il nous faut faire revivre l’âme des Hyperboréens et “redéfinir” Dieu. Car le sacré ne se trouve pas hors de nous, mais en nous. Car Dieu n’est pas du Ciel, mais de la Terre. Car il ne nous attend pas après la mort, mais nous offre la création de la vie. Dieu n’est pas surnaturel et il n’est pas transcendant. Il est au contraire la Nature et la Vie. Il est dans le soleil et dans les étoiles, dans le jour et dans la nuit, dans les arbres et dans les flots. Dieu naît avec les fleurs et meurt avec les feuilles. Dieu respire avec le vent et nous parle dans le silence de la nuit. Il est l’aurore et le crépuscule. Et la brume. Et l’orage.
Dieu s’incarne dans la Nature. La Nature s’épanouit sur la Terre. La terre se perpétue dans le Sang.
Nous savons, depuis Héraclite, que la vie est un combat et que la paix n’est que la mort. Notre religion se veut d’abord culte des héros, des guerriers et des athlètes. Nous célébrons, depuis les Grecs, les hommes différents et inégaux. Notre monde est celui du combat et du choix, non celui de l’égalité. L’univers n’est pas une fin mais un ordre. La nature diversifie, sépare, hiérarchise. L’individu, libre et volontaire devient le centre du monde. Sa plus grande vertu reste l’orgueil – péché suprême pour la religion étrangère. Dans notre conception tragique de la vie, la lutte devient la loi suprême. Est un homme véritable celui qui s’attaque à des entreprises démesurées. Une même ligne de crêtes unit Prométhée à Siegfried. »
Jean Mabire
Thulé : le soleil retrouvé des Hyperboréens, éditions Robert Laffont, 1978, éditions Pardès, 2002
Dans le monde germanique le héros est un idéal moral…
« Dans le monde germanique le héros est un idéal moral. Le chant qui lui est consacré n’est pas seulement un agréable passe-temps pour les heures de loisirs, il a en outre une signification bien plus haute. Le chant héroïque devait offrir à l’antrustionnat du prince germanique à la cour duquel il était déclamé, dans une grande salle, un magnifique exemple de vertus viriles que chaque guerrier devait tenter d’égaler. C’est précisément cela qui donne à l’épopée héroïque sa valeur d’éternité : un type d’humanité qui s’y est en effet élevé au rang d’un modèle universel de prouesse guerrière aux dimensions presque surhumaines. »
Jan de Vries
L’univers mental des Germains, éditions du Porte-glaive, 1988
La jeunesse est faite pour l’héroïsme…
« La jeunesse est faite pour l’héroïsme. C’est vrai, il faut de l’héroïsme à un jeune homme pour résister aux tentations qui l’entourent, pour croire tout seul à une doctrine méprisée, pour oser faire face sans reculer, pour résister à sa famille et à ses amis, pour être fidèle contre tous. Ne croyez pas que vous serez diminué, vous serez au contraire merveilleusement augmenté. C’est par la vertu que l’on est un homme. La vie vous paraîtra alors pleine de saveur. »
Paul Claudel
Lettre à Jacques Rivière, in Correspondance de Jacques Rivière et Paul Claudel (1907 – 1914), éditions Plon, 1926
Il n’existe pas une Histoire, entité mystérieuse…
L’héroïsme : cette sauvage création de soi par soi…
« L’héroïsme : cette sauvage création de soi par soi et de l’homme par l’homme. Et les femmes exclues de cette terrible fête, soudain stériles lorsque les hommes n’ont plus besoin d’un ventre femelle pour enfanter des dieux. L’héroïsme : ce chant égoïste qui éclate. Me voici ! Unique ! Écartez-vous ! Je n’ai plus de mère ou d’amante ; je n’ai plus de passé ; je vais me mettre au monde. « Tu vas mourir ! » Oui, mais je serais né et j’aurais connu l’enivrement fou lorsque, dans mon corps et dans mon âme, j’ai éprouvé la naissance véhémente d’un dieu. « Il ne se connaît plus ! » C’est vrai puisqu’il s’invente. »
Jean Cau
Le Chevalier, la mort et le diable, éditions de La Table ronde, 1977
Auteurs
Auteurs récemment ajoutés