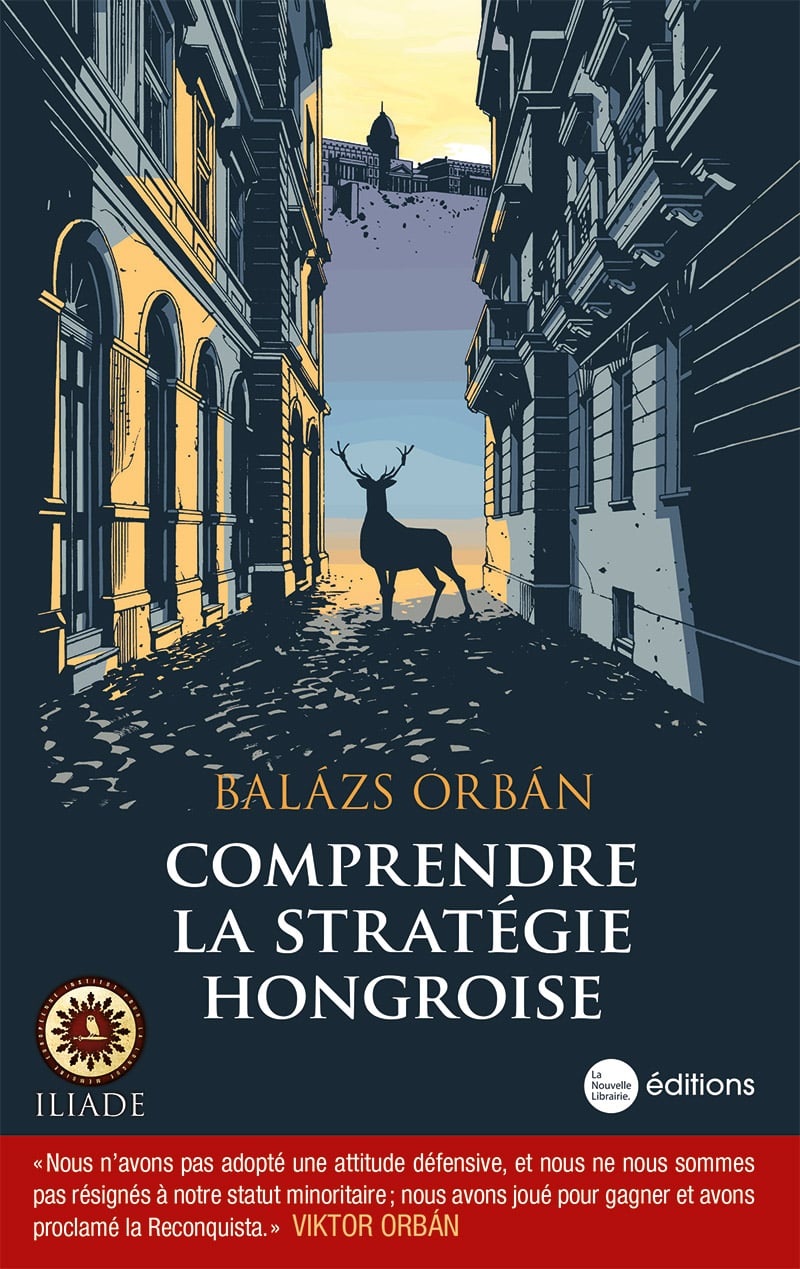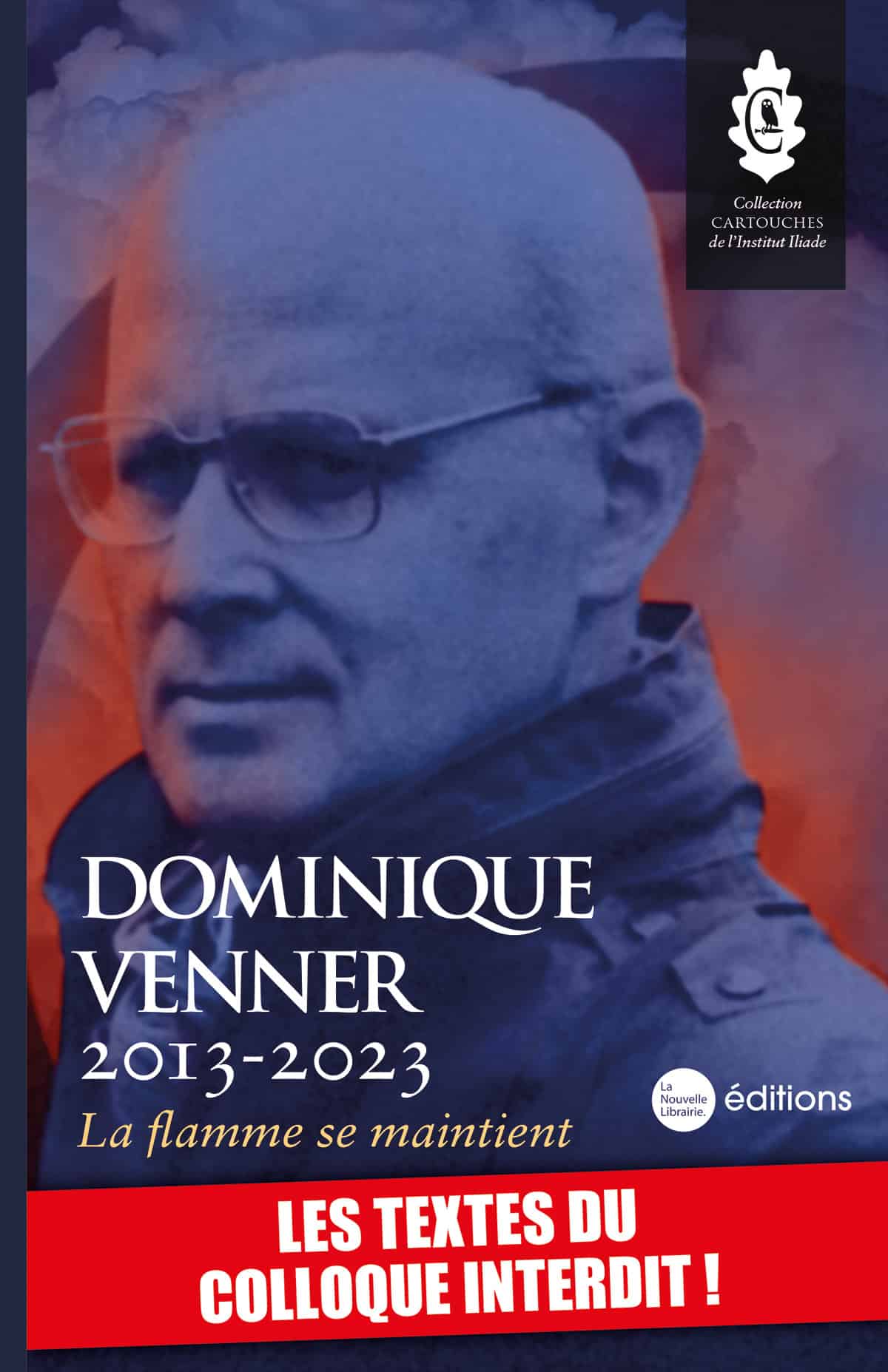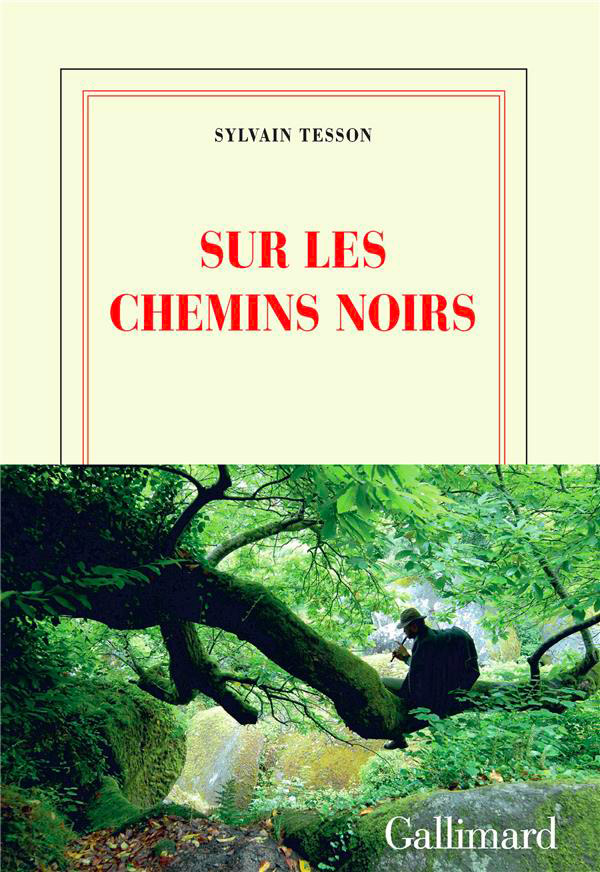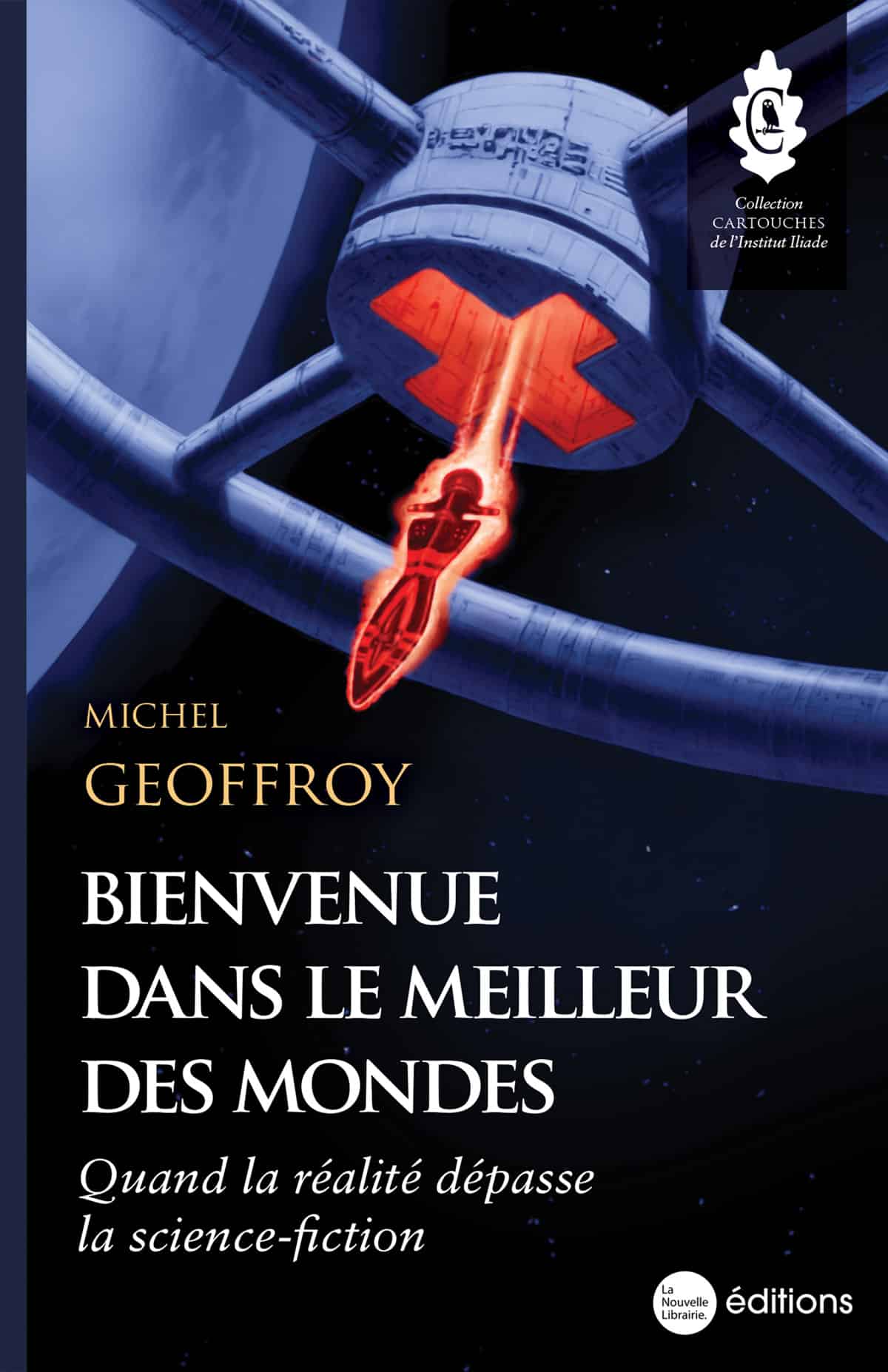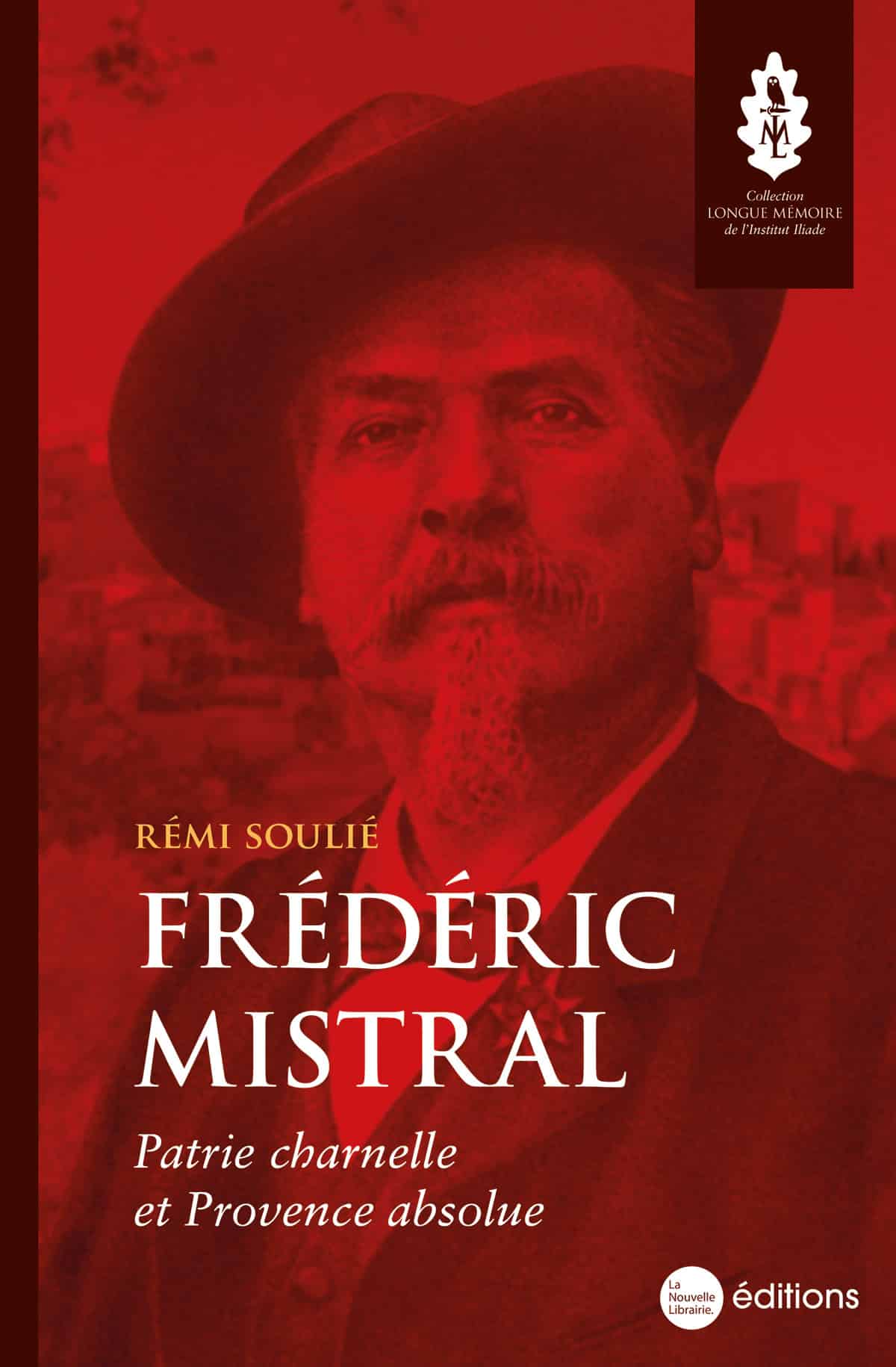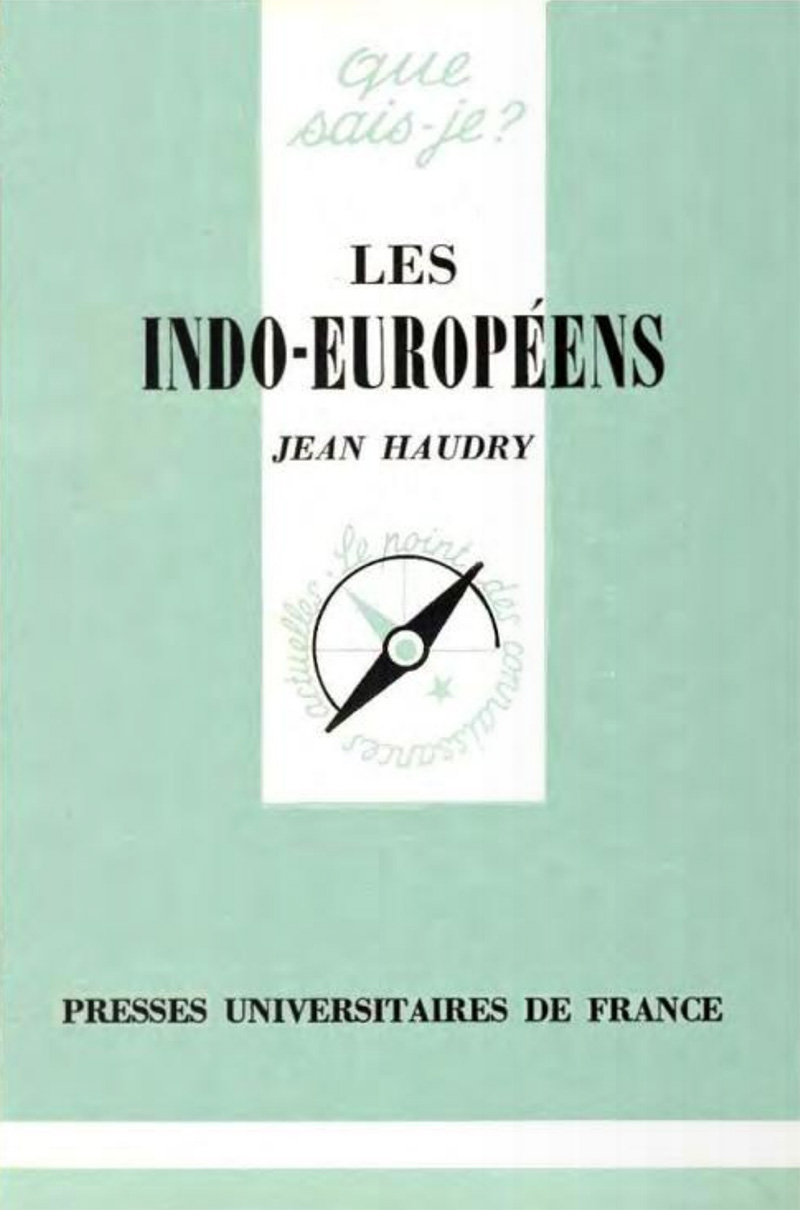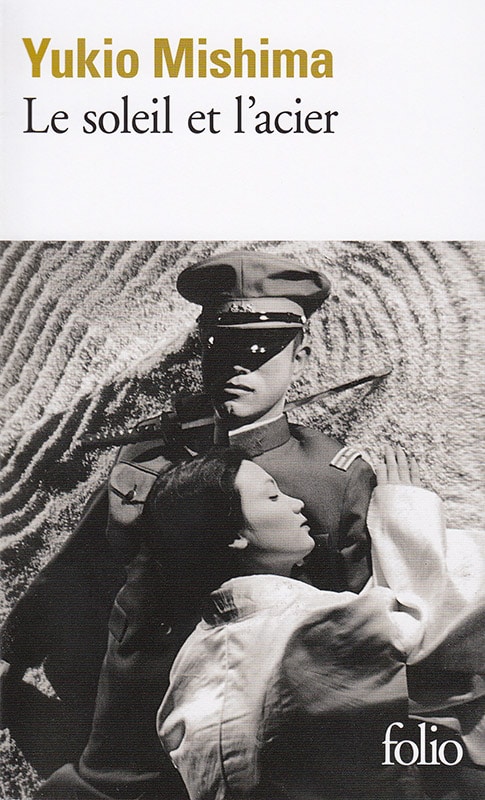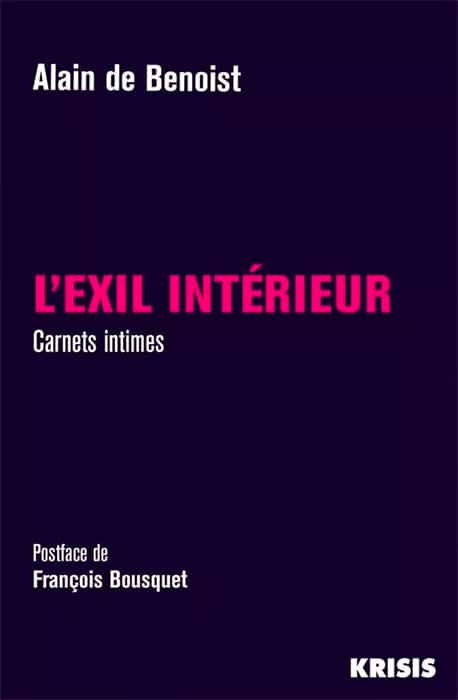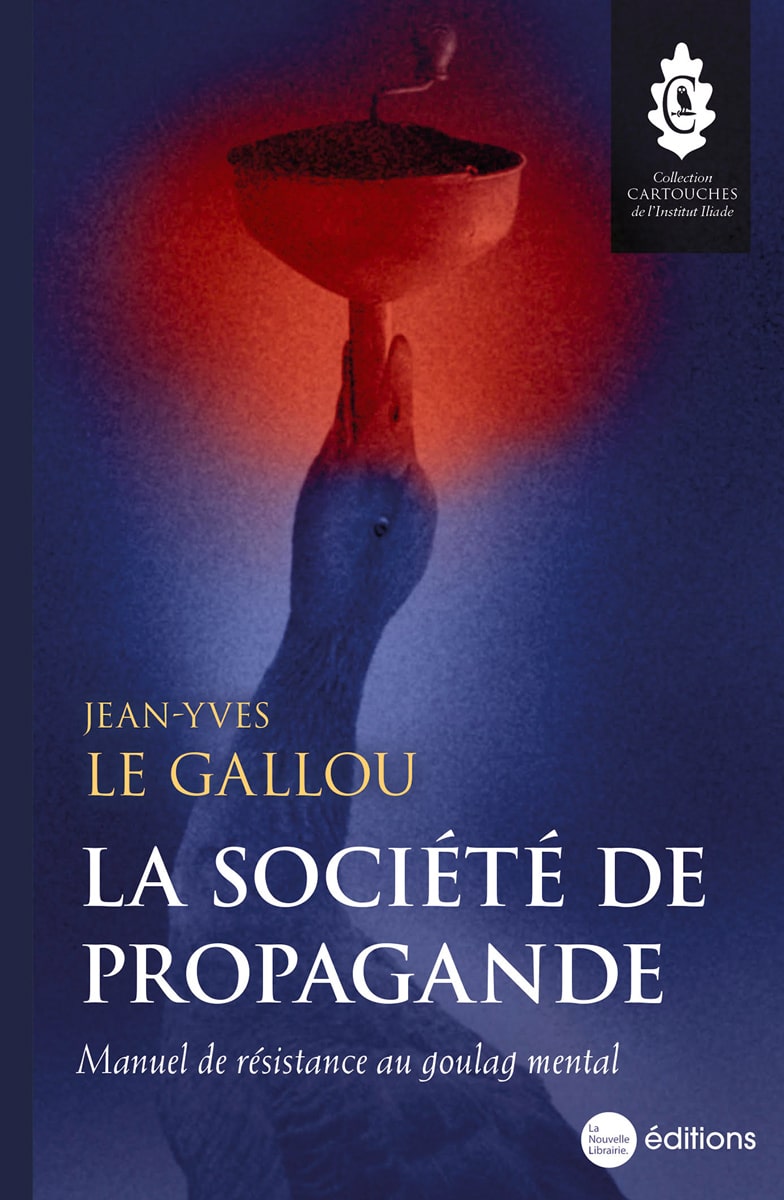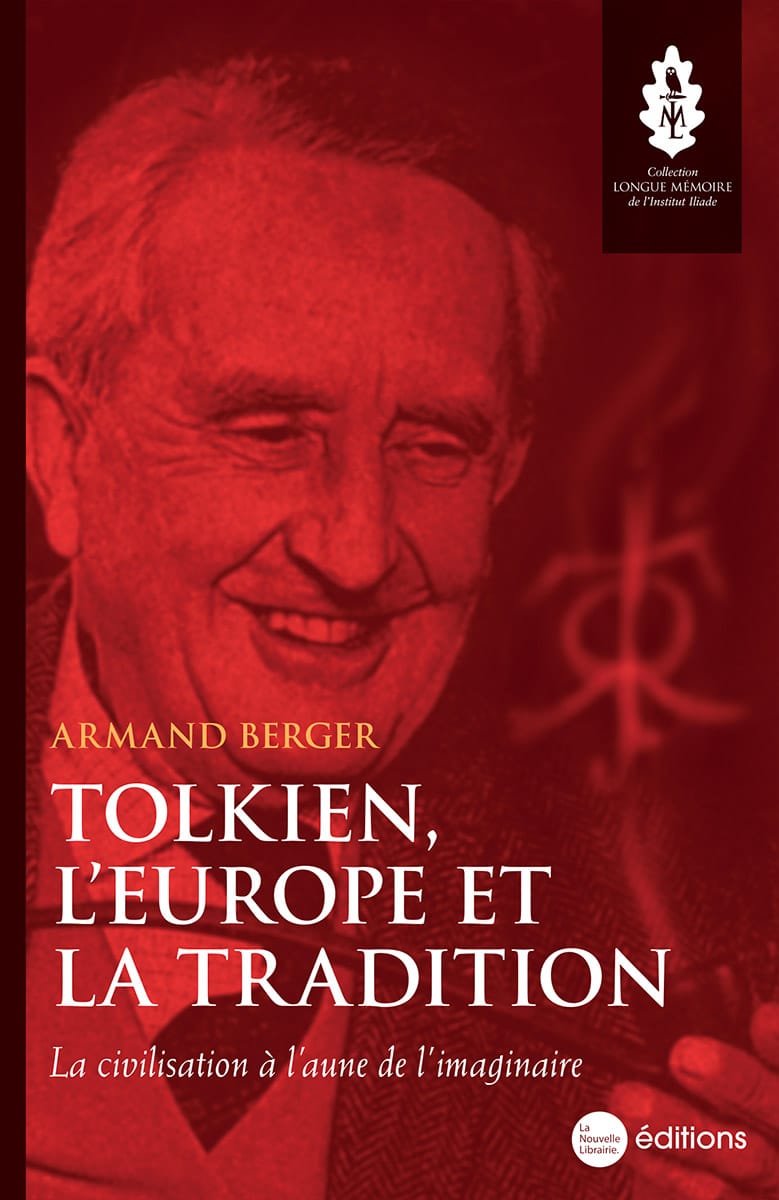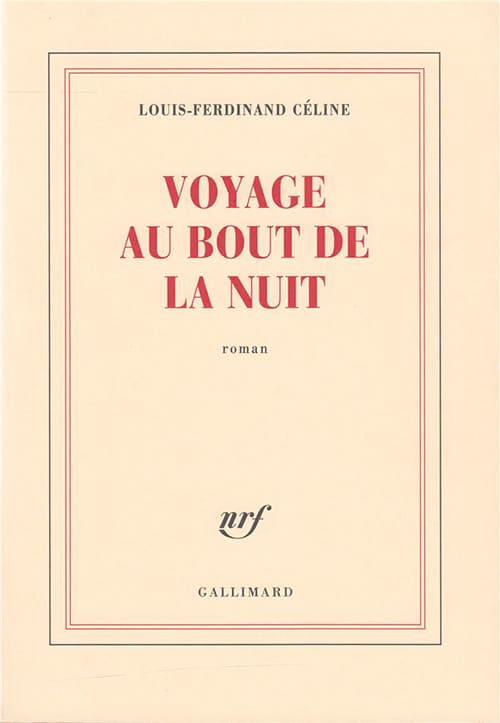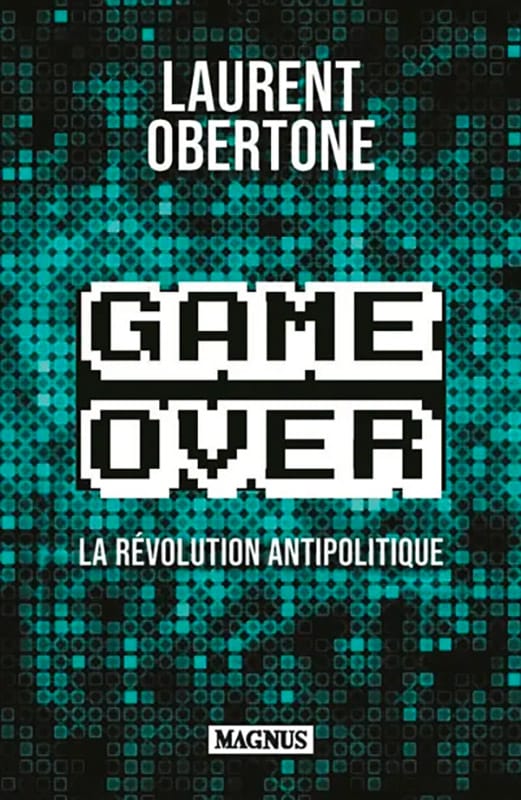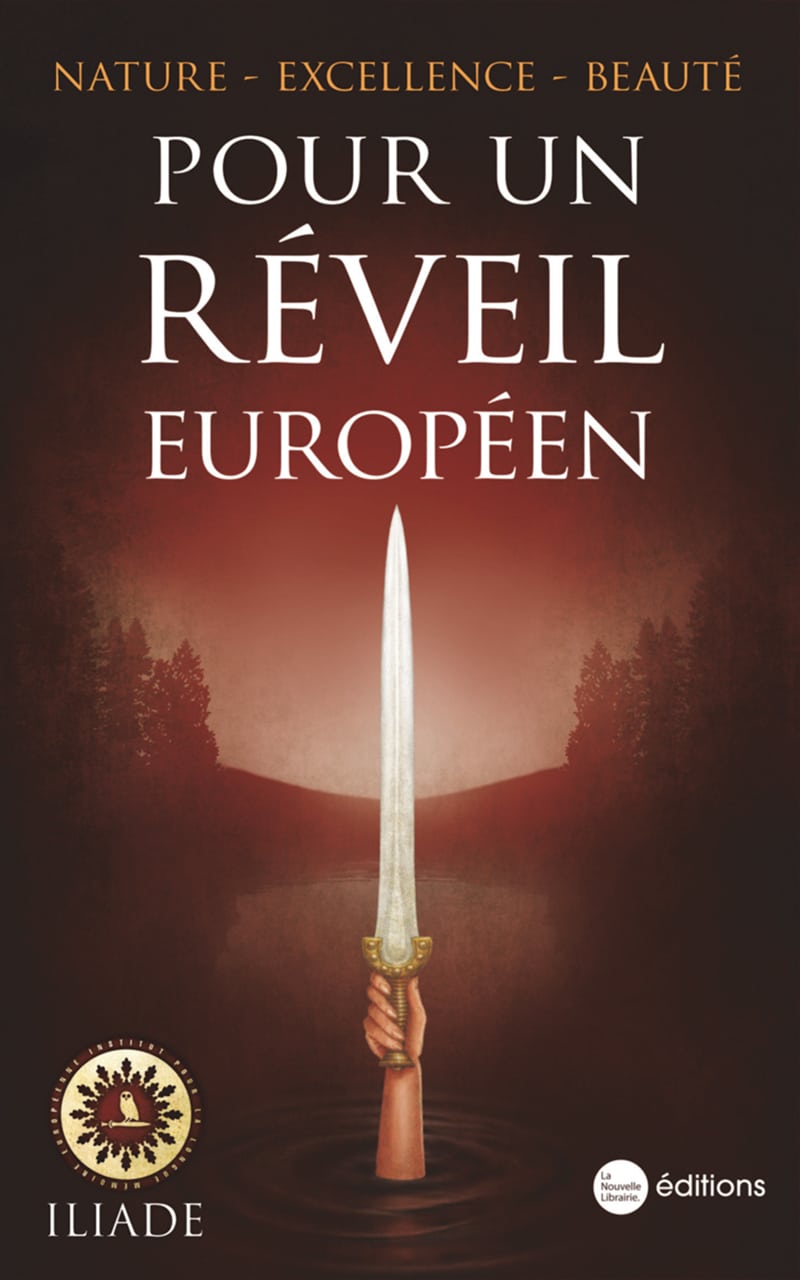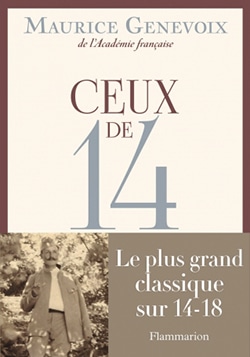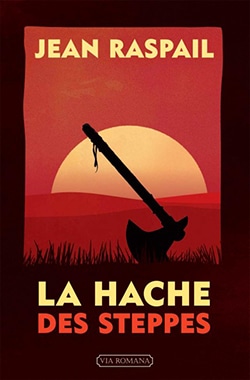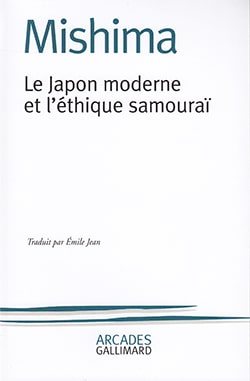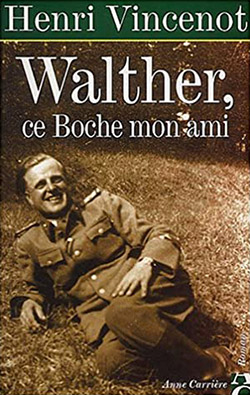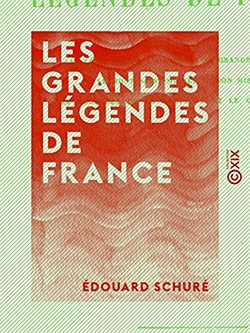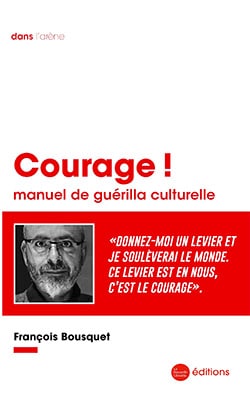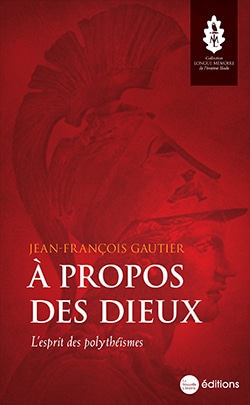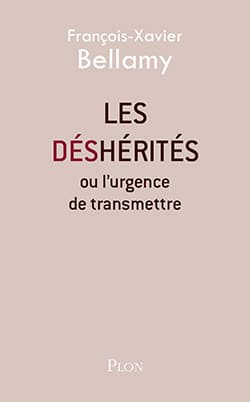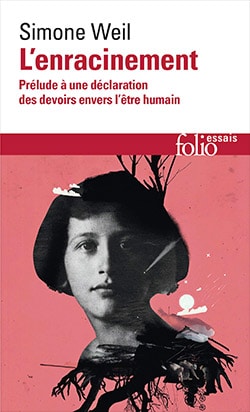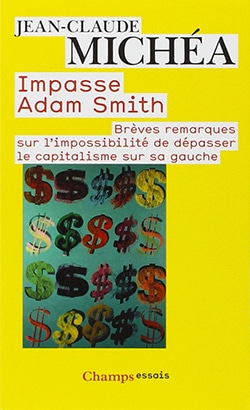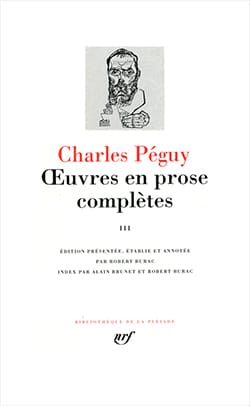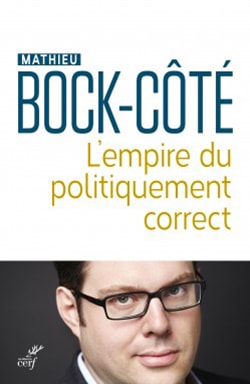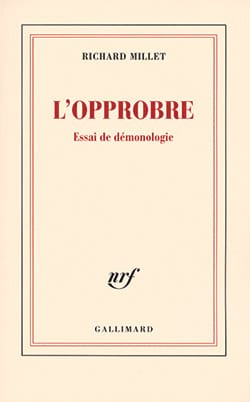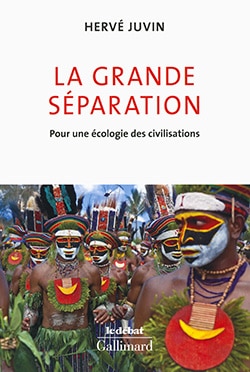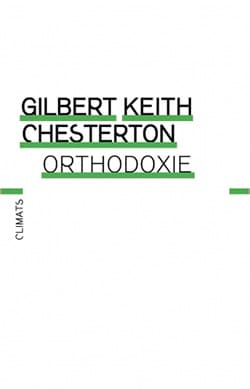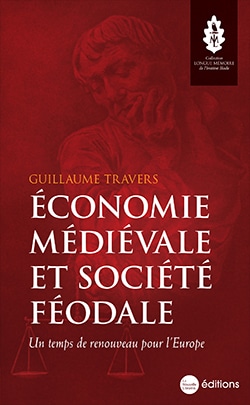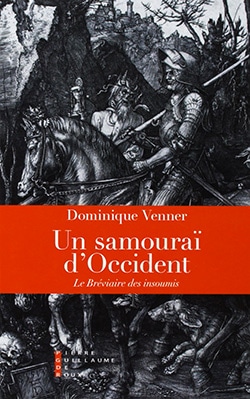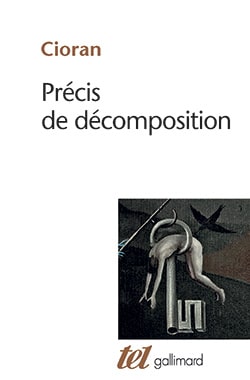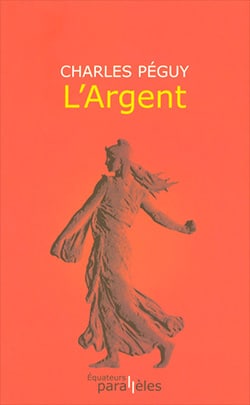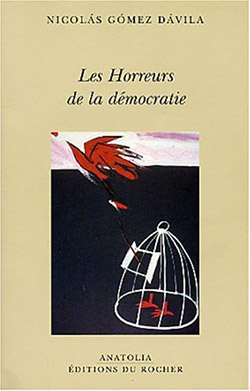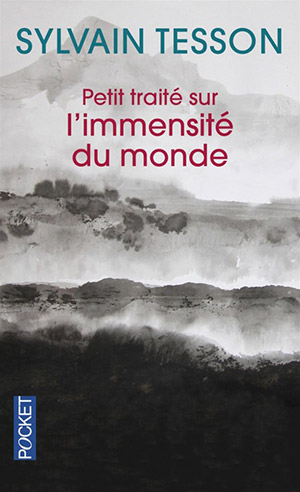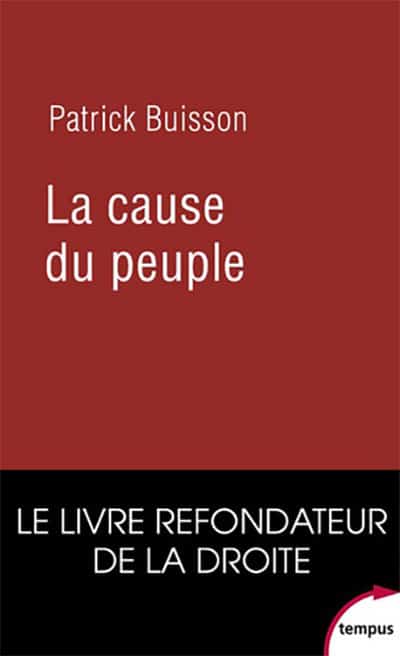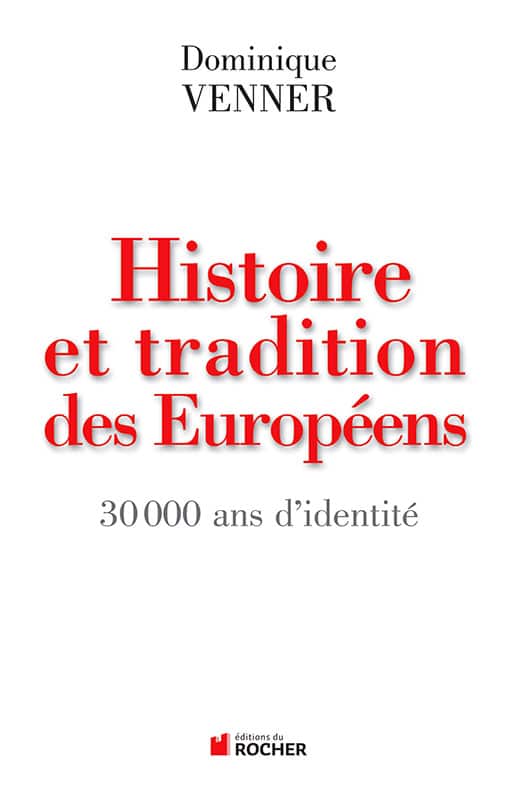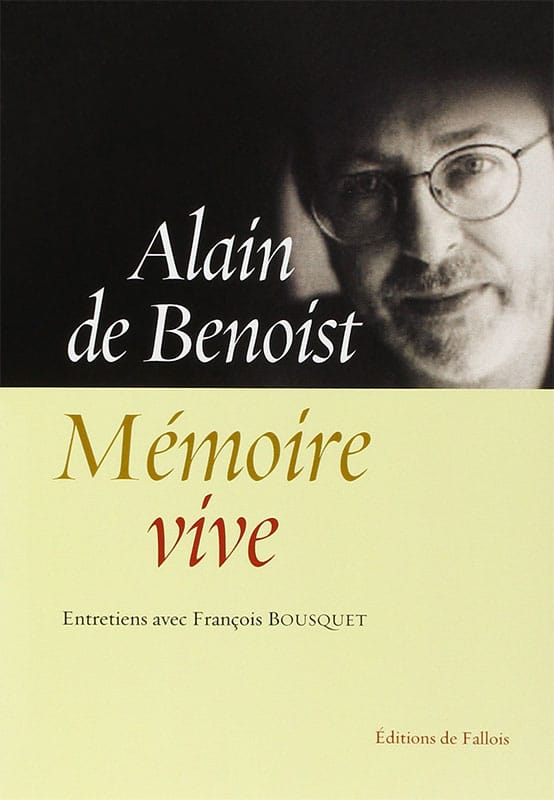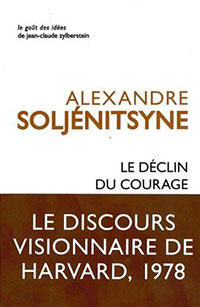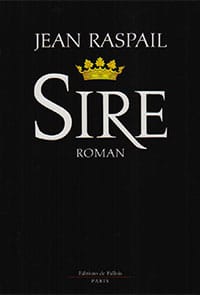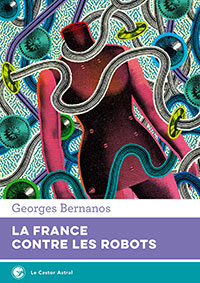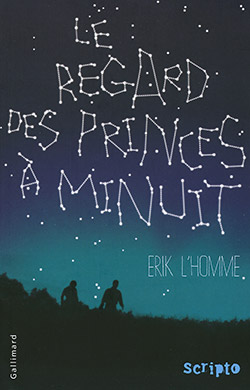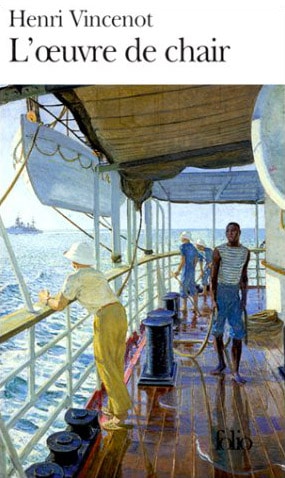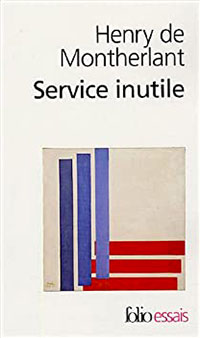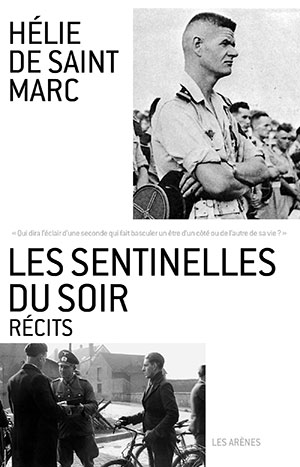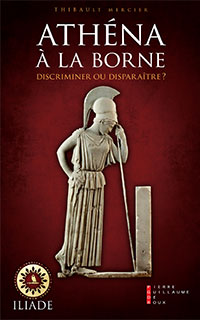« Dans le courant des IXe et Xe siècles, les invasions barbares sur le territoire de l’ancienne Gaule avaient multiplié massacres et destructions : hordes sauvages se succédant les unes aux autres comme les flots écumeux d’un Océan démonté ; invasions sarrasines qui couvrent le Midi de la France, tandis que les Hongrois foulent les marches de l’Est. Par les fleuves arrivent les Normands, jusqu’au centre du pays, « nageant par l’Océan en manière de pirates ». « Ces étrangers, écrit le chroniqueur Richer, se livraient aux plus cruels sévices ; ils saccageaient villes et villages et ravageaient les champs ; ils brûlaient les églises ; puis ils repartaient en emmenant une foule de captifs ». Dans le courant des IXe et Xe siècles de notre ère, toutes les villes de France furent détruites : toutes. Imagine-t-on les égorgements, les déprédations que contient un pareil fait ? […] Alors se fit, dans l’anarchie, le travail de reconstruction sociale où se forma la nation française ; elle se forma autour de la seule force organisée qui fût demeurée intacte, sous le seul abri que rien ne peut renverser, parce qu’il a ses fondements dans le cœur humain : la famille. Parmi la tourmente, la famille se fortifia, elle prit plus de cohésion. Autour du chef de famille, « cap d’hostel » diront les méridionaux, se groupèrent les rejetons des branches cadettes. Ainsi la famille grandit, devint un petit État. De génération en génération, elle accrut son action sociale jusqu’à en faire une action politique et avec le temps, de grande envergure ; tant et tant qu’elle en arriva à former l’État lui-même par la transformation progressive en institutions publiques de ses institutions privées. Telle a été l’origine à la fois humble et grandiose, simple et magnifique, modeste et glorieuse, de ce qu’on appelle aujourd’hui la France. Ce travail immense et d’une inimaginable puissance et activité, se fit dans le courant des IXe-XIe siècles, les plus grands de notre histoire. Au XIIe siècle, la France est faite par des institutions que le peuple s’est données lui-même, puisant leur sève dans son propre sang : chaque détail en répond à ses fins, chaque institution a son but, tandis que la pratique, en ses manifestations multiples et diverses, s’adapte naturellement au génie national. »
Frantz Funck-Brentano
La Renaissance, éditions Fayard, 1935