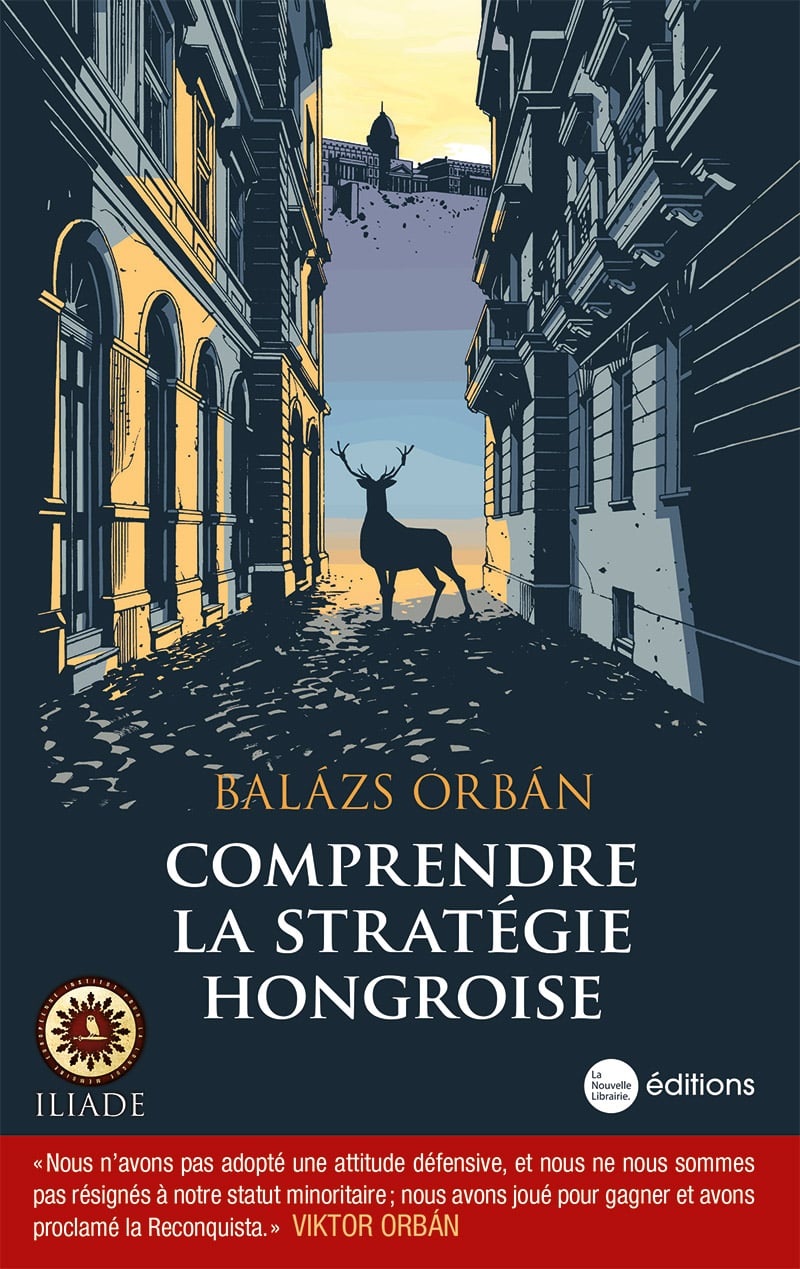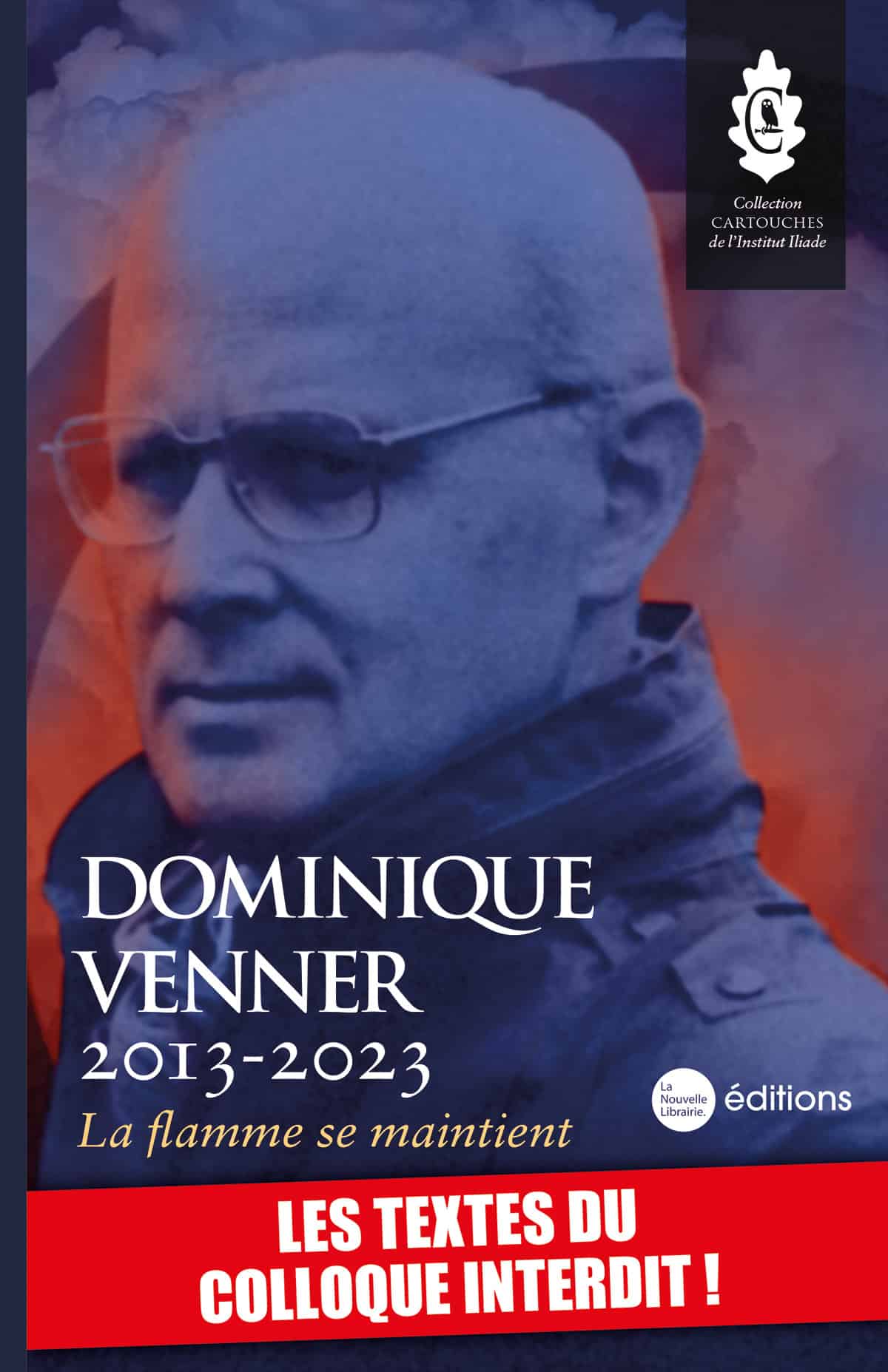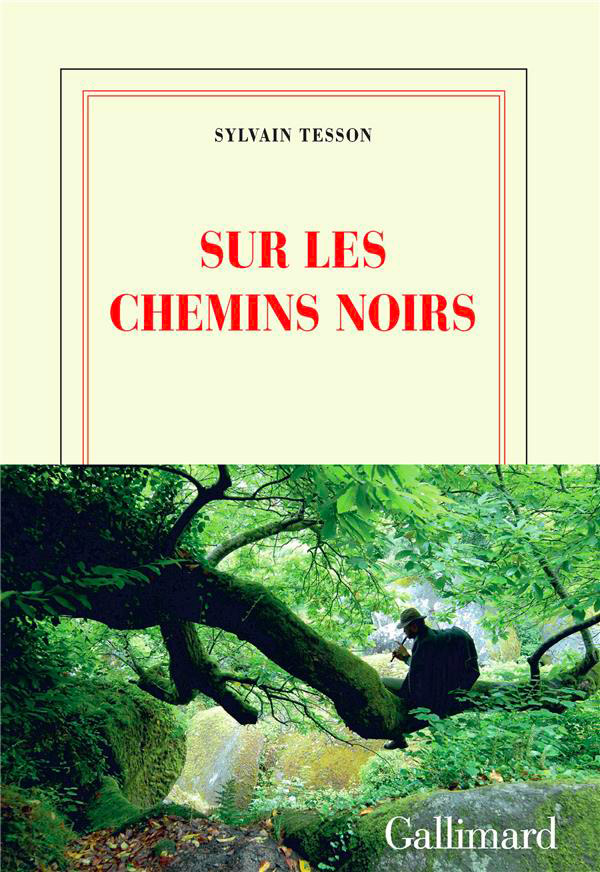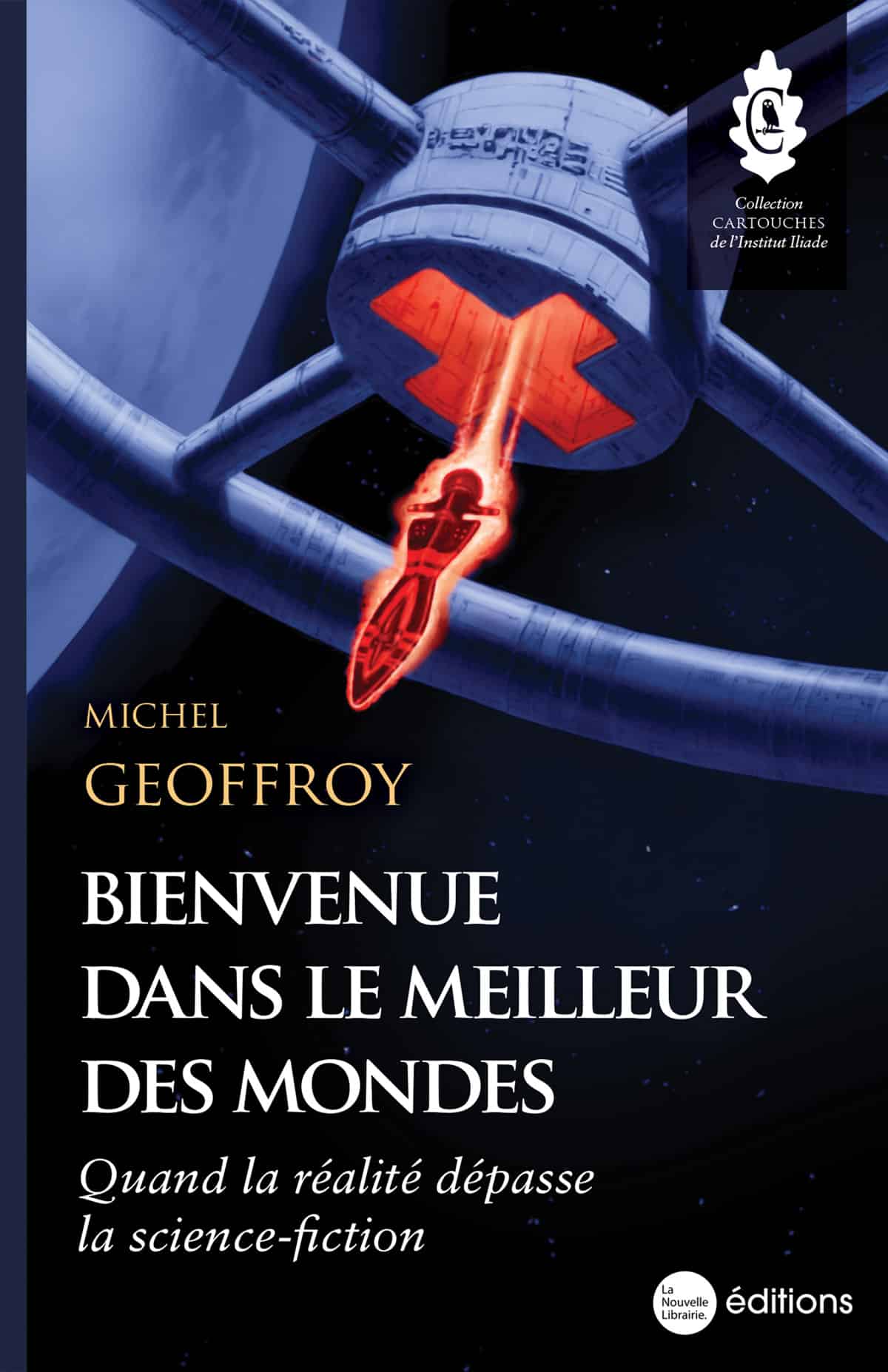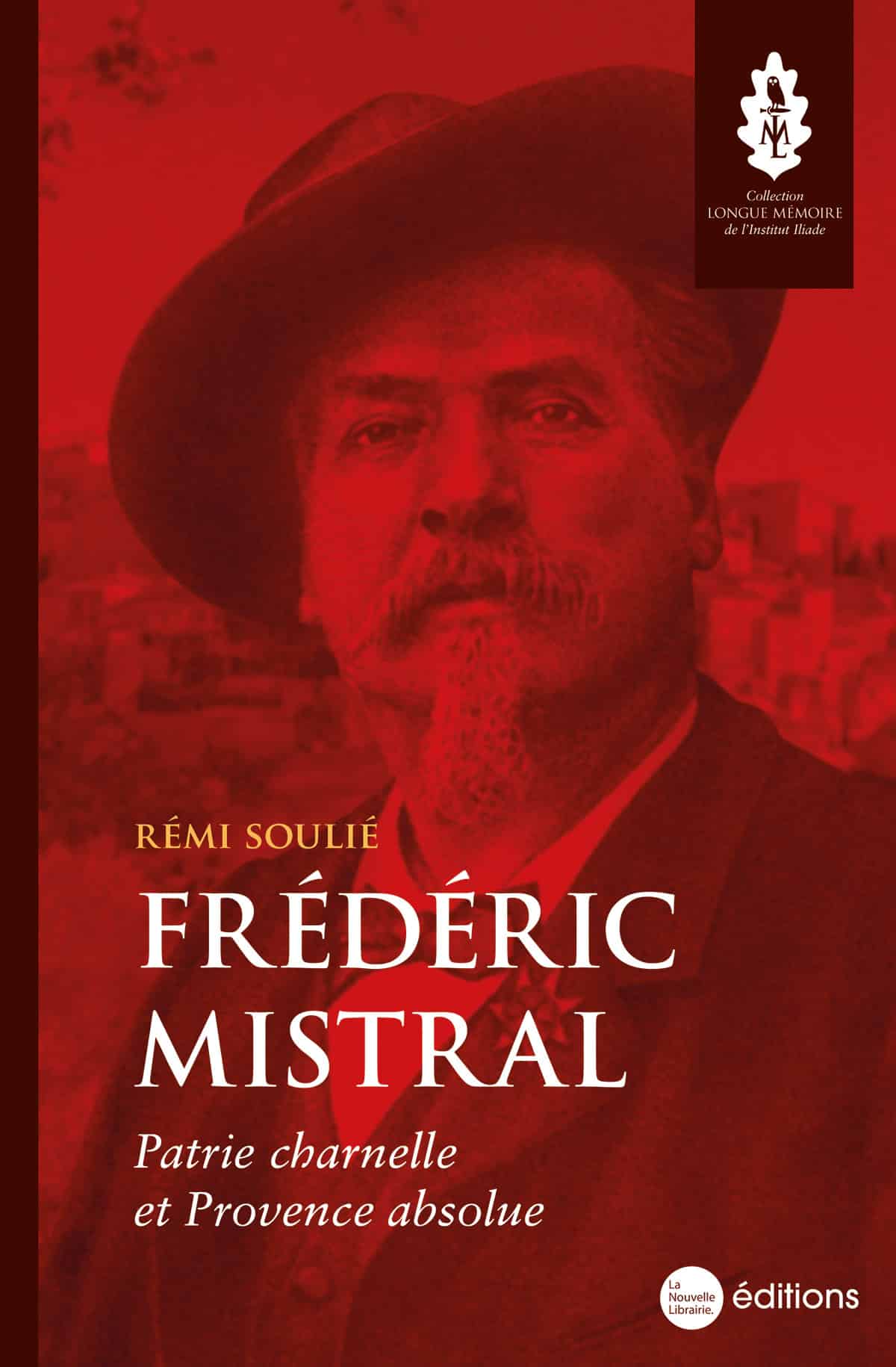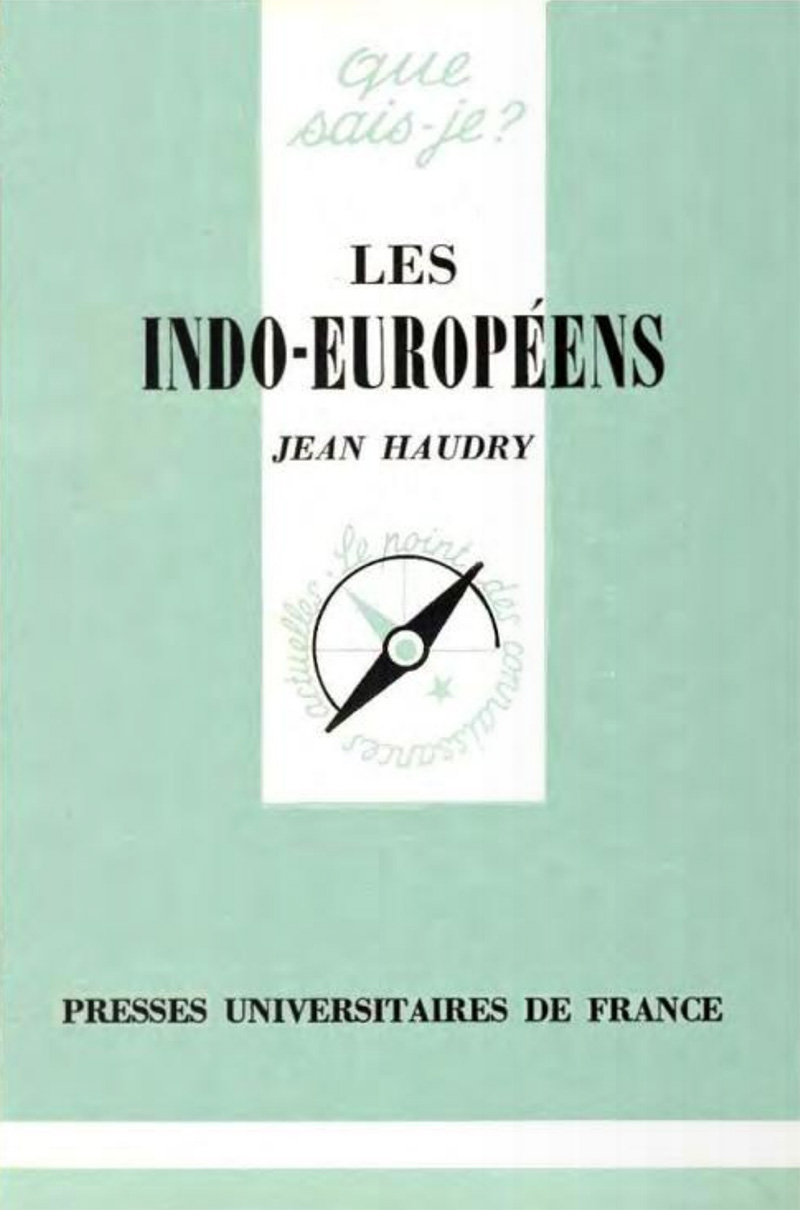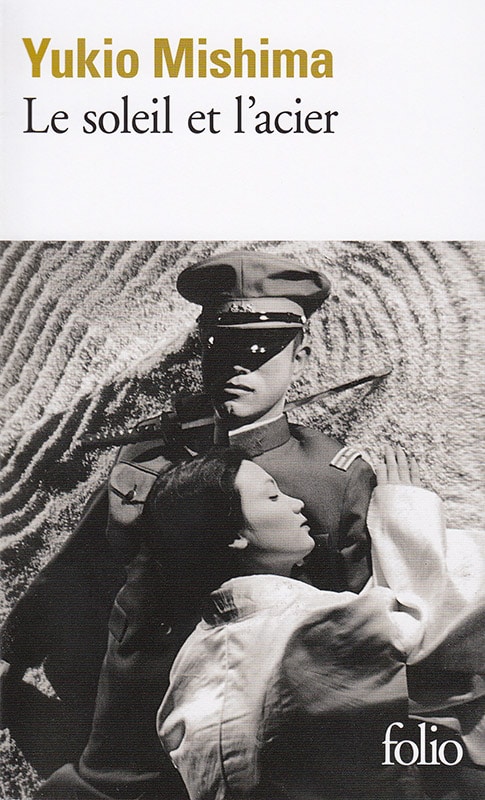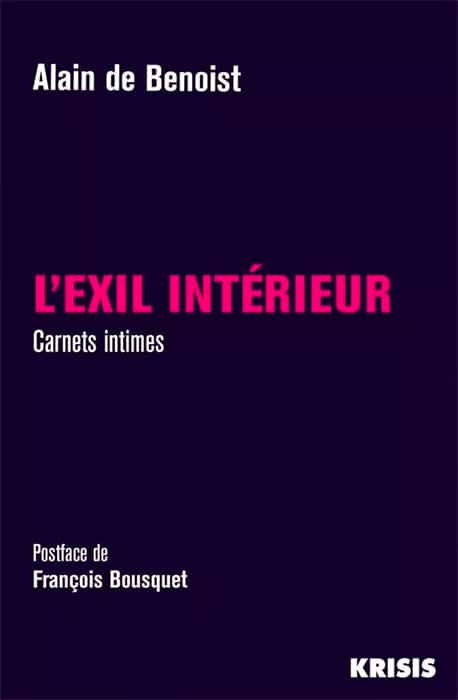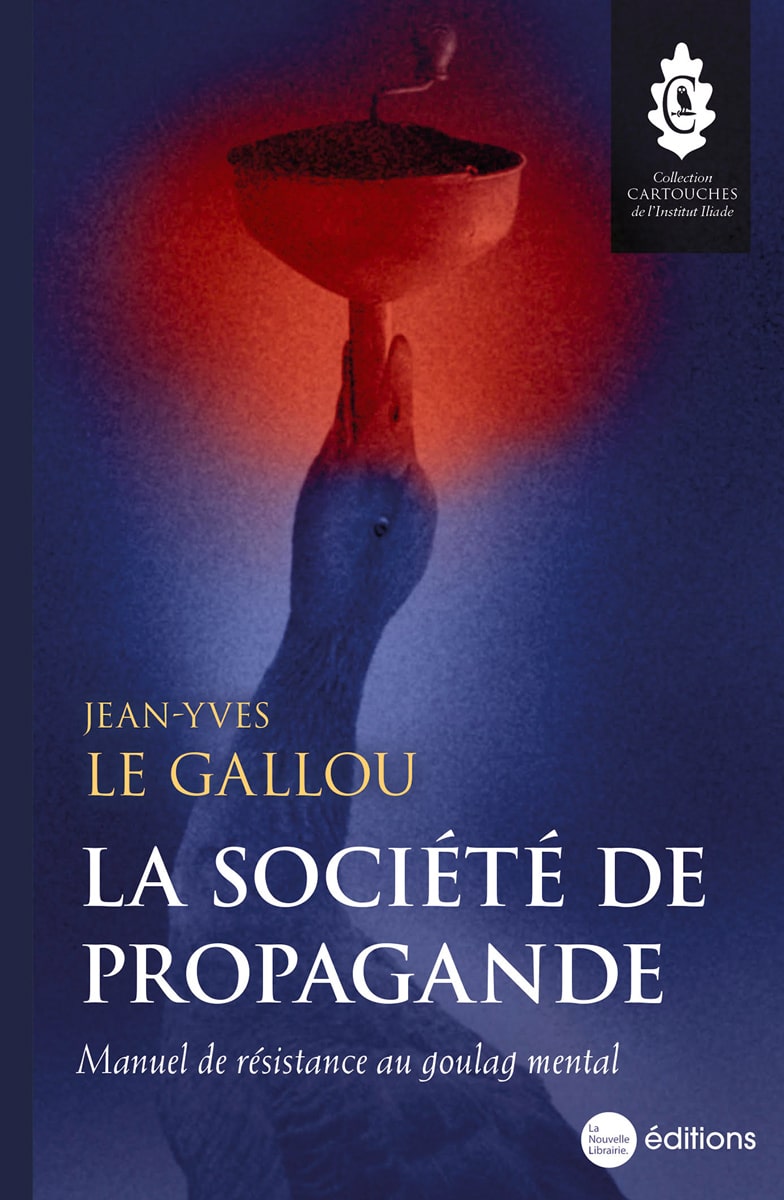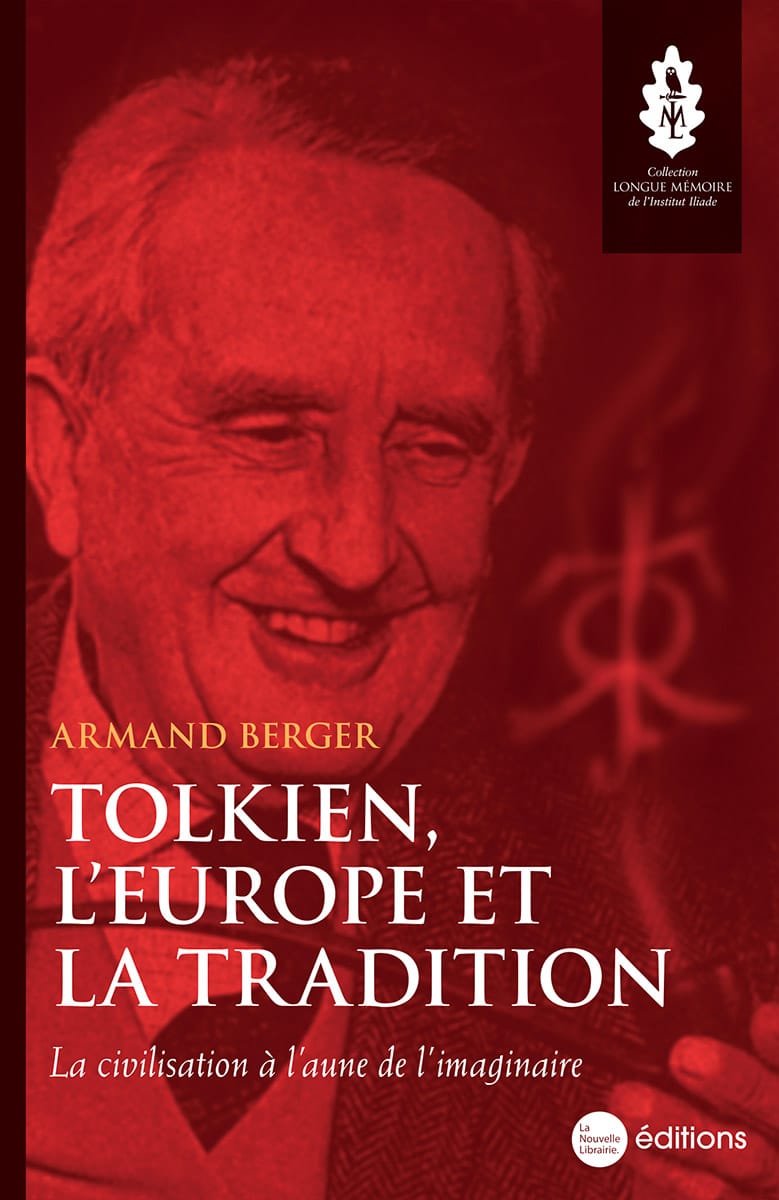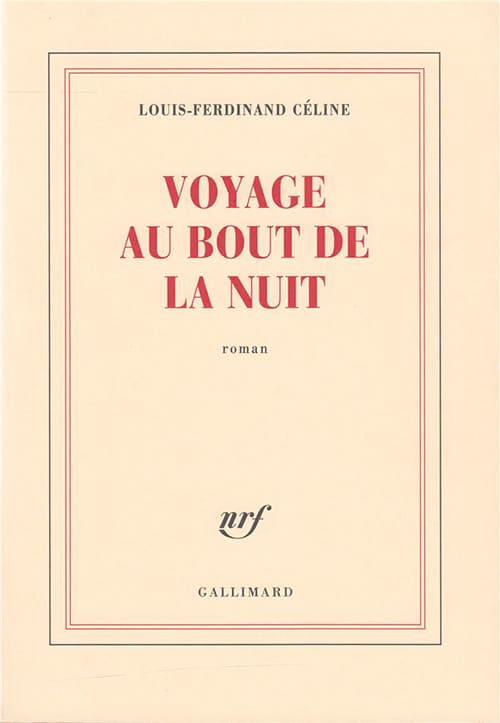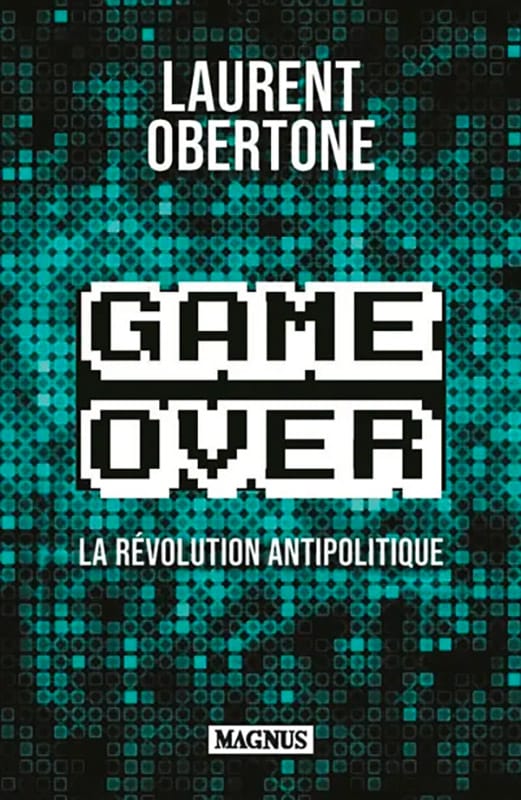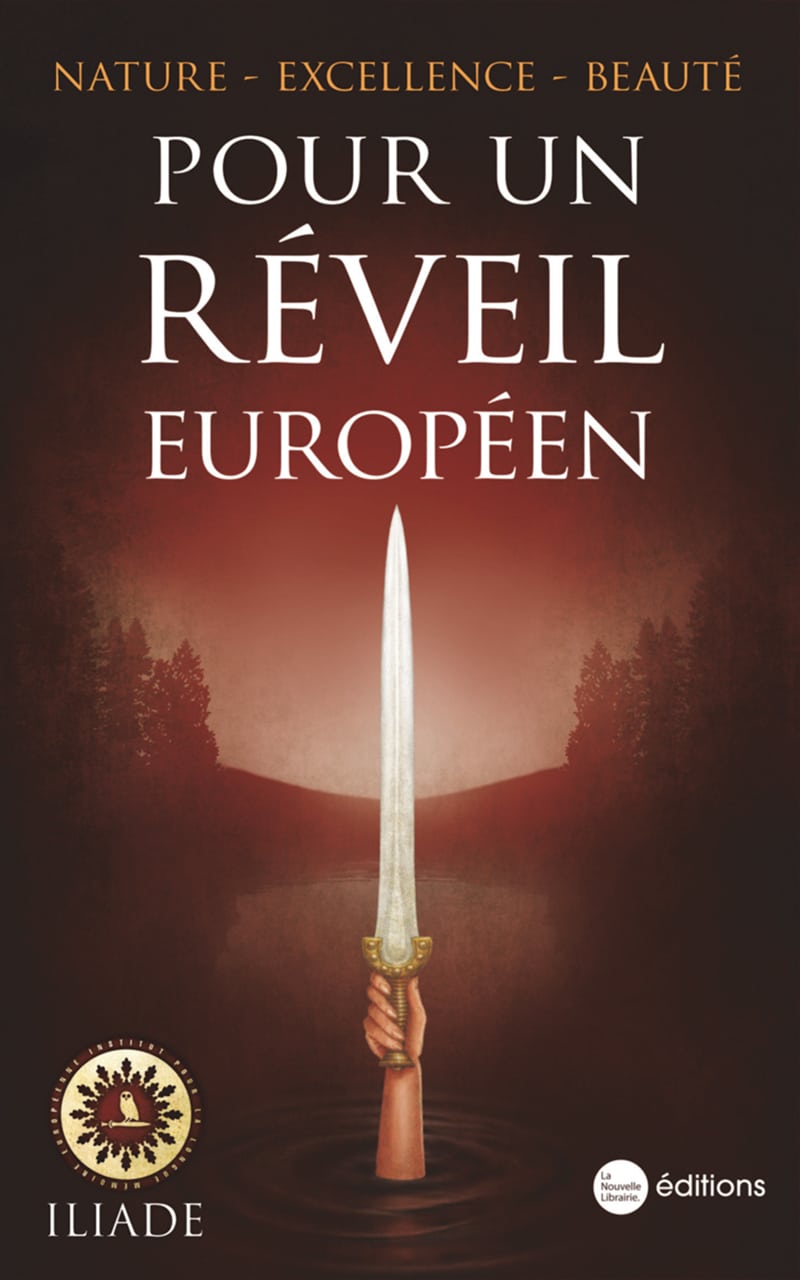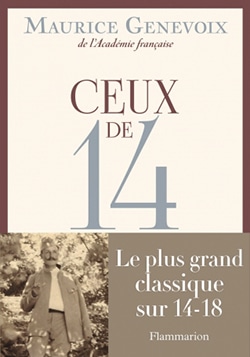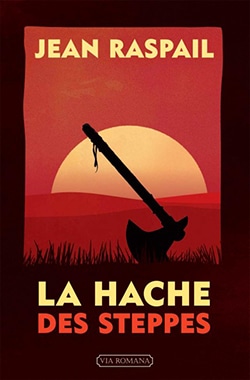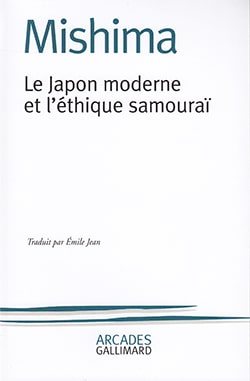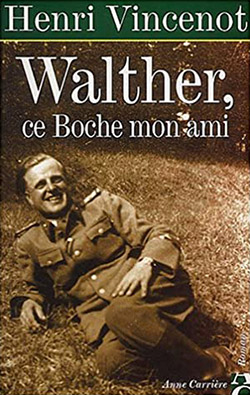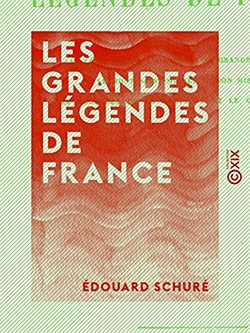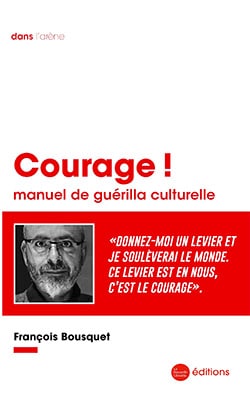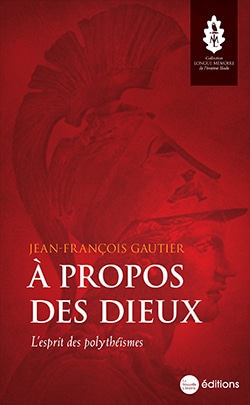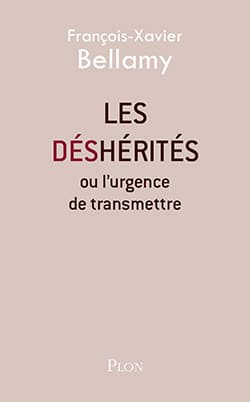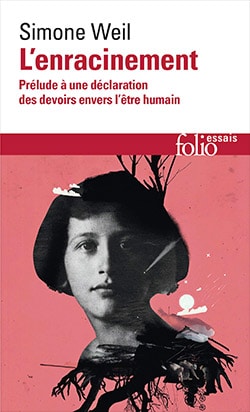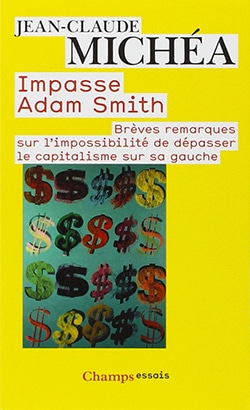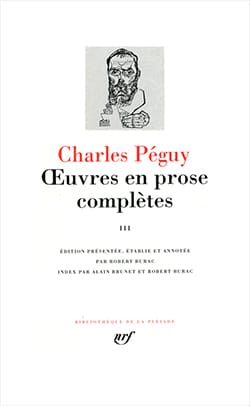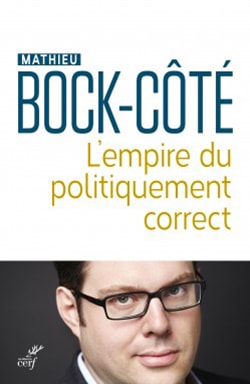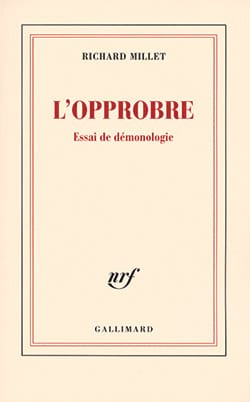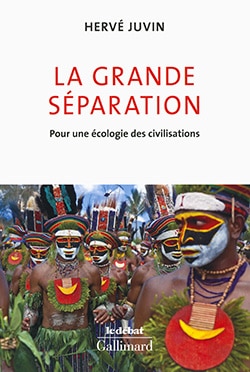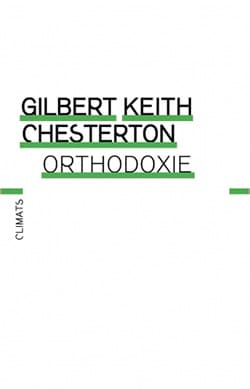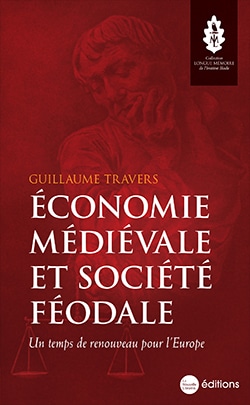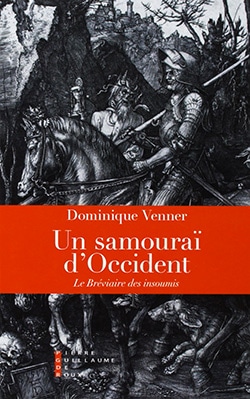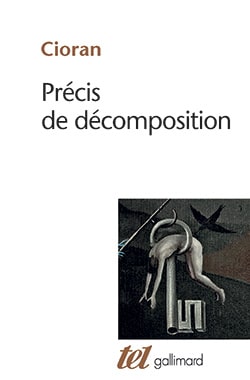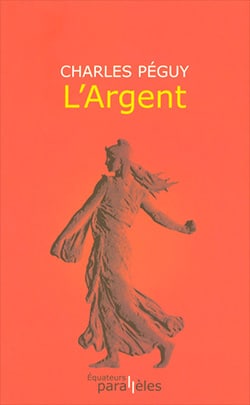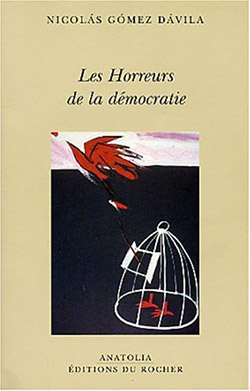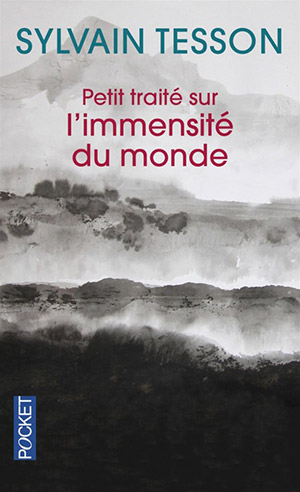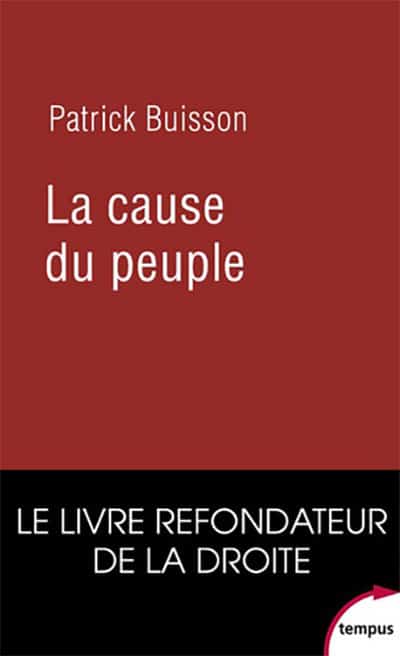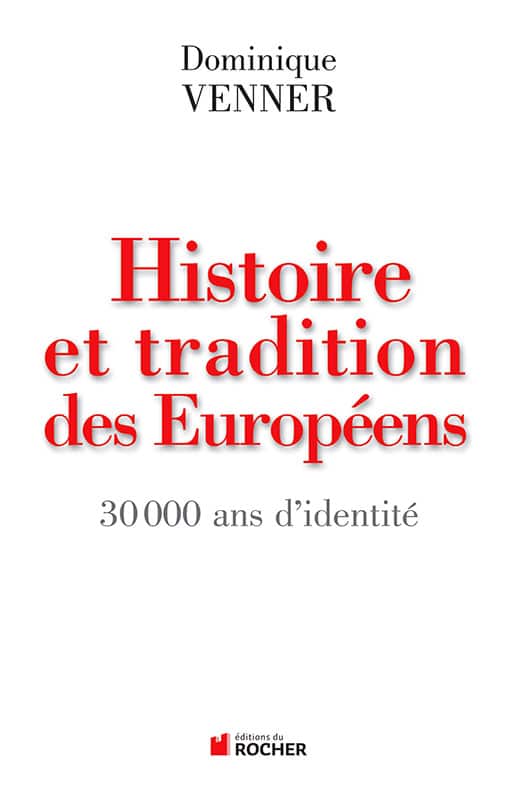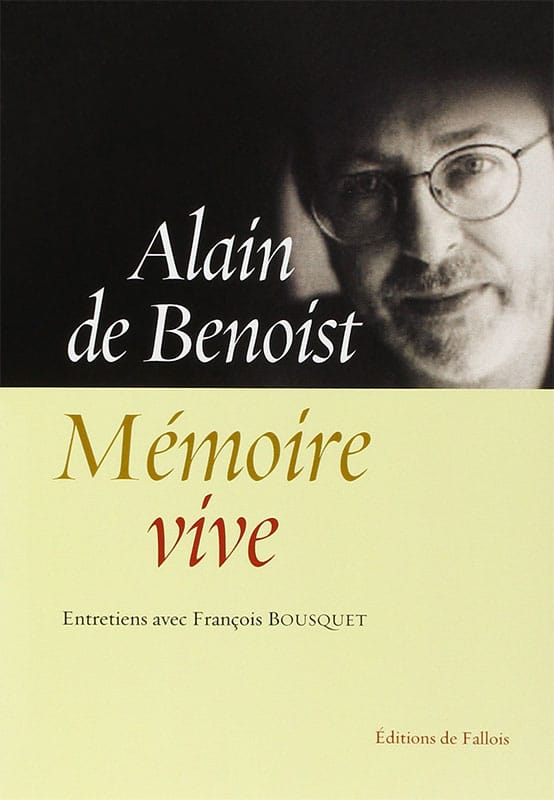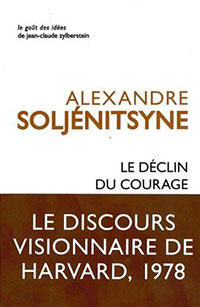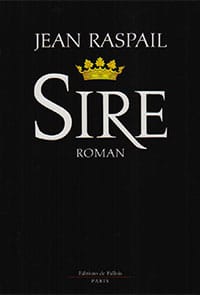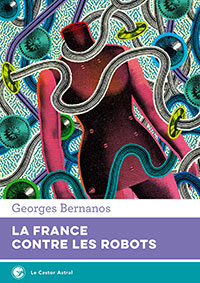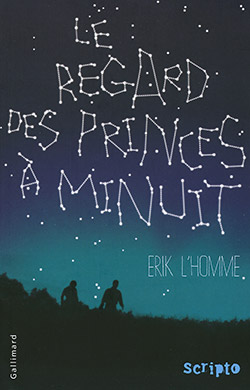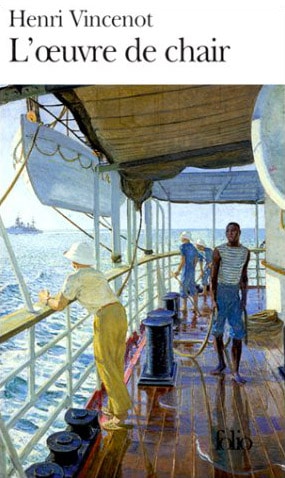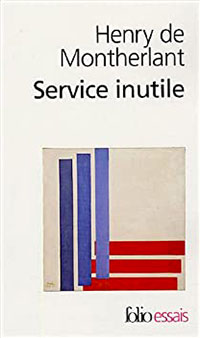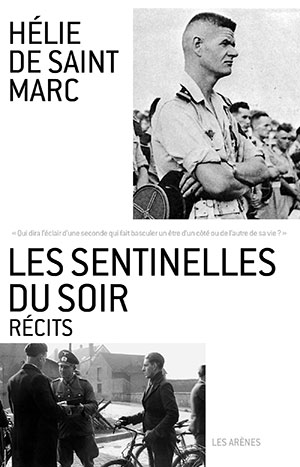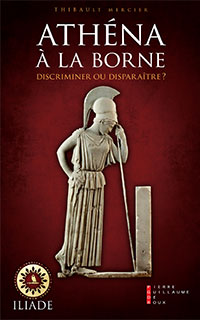Thème
Citations sur la nature
Nous luttons pour que les hommes restent fidèles…
« Nous luttons pour que les hommes restent fidèles à leur nature profonde, pour qu’ils s’épanouissent dans tous les domaines, pour qu’ils continuent à former des communautés « à l’échelle humaine », de la famille à l’Europe, de l’usine à la région. Nous luttons contre le temps des robots que nous préparent ensemble les techniciens du monde communiste et ceux du monde capitaliste. Nous refusons « les temps modernes » parce qu’ils procèdent d’une même vision illusoire et irréelle. »
Jean Mabire
La torche et le glaive, éditions Libres opinions, 1994
C’était l’hiver. Il y était allé en voiture…
« C’était l’hiver. Il y était allé en voiture. Qui ne connaît pas la campagne l’hiver ne connaît pas la campagne, et ne connaît pas la vie. Traversant les vastes étendues dépouillées, les villages tapis, l’homme des villes est brusquement mis en face de l’austère réalité contre laquelle les villes sont construites et fermées. Le dur revers des saisons lui est révélé, le moment sombre et pénible des métamorphoses, la condition funèbre des renaissances. Alors, il voit que la vie se nourrit de la mort, que la jeunesse sort de la méditation la plus froide et la plus désespérée et que la beauté est le produit de la claustration et de la patience. »
Pierre Drieu la Rochelle
Gilles, éditions Gallimard, 1939
Ce feu résume une vivante tradition. Non pas une image inconsistante…
« La Flamme.
Ce feu résume une vivante tradition. Non pas une image inconsistante, mais une réalité. Une réalité aussi tangible que la dureté de cette pierre ou ce souffle de vent. Le symbole du solstice est que la vie ne peut pas mourir. Nos ancêtres croyaient que le soleil n’abandonne pas les hommes et qu’il revient chaque année au rendez-vous du printemps.
Nous croyons avec eux, que la vie ne meurt pas et que par-delà la mort des individus, la vie collective continue.
Qu’importe ce que sera demain. C’est en nous dressant aujourd’hui, en affirmant que nous voulons rester ce que nous sommes, que demain pourra venir.
Nous portons en nous la flamme. La flamme pure de ce feu de foi. Non pas un feu de souvenir. Non pas un feu de piété filiale. Mais un feu de joie et de gravité qu’il convient d’allumer sur notre terre. Là nous voulons vivre et remplir notre devoir d’hommes sans renier aucune des particularités de notre sang, notre histoire, notre foi entremêlés dans nos souvenirs et dans nos veines…
Ce n’est pas la résurrection d’un rite aboli. C’est la continuation d’une grande tradition. D’une tradition qui plonge ses racines au plus profond des âges et ne veut pas disparaître. Une tradition dont chaque modification ne doit que renforcer le sens symbolique. Une tradition qui peu à peu revit. »
Jean Mabire
Les Solstices, Histoire et actualité, éditions Le Flambeau, 1991
Pour la puissance mondiale, tout aussi intégriste…
« Pour la puissance mondiale, tout aussi intégriste que l’orthodoxie religieuse, toutes les formes différentes et singulières sont des hérésies. À ce titre, elles sont vouées soit à rentrer de gré ou de force dans l’ordre mondial, soit à disparaître. […] L’objectif est de réduire toute zone réfractaire, de coloniser et de domestiquer tous les espaces sauvages, que ce soit dans l’espace géographique ou dans l’univers mental. »
Jean Baudrillard
Power Inferno, éditions Galilée, 2002
Nous ne sommes pas de ceux qui ne pensent qu’au sein des livres…
« Nous ne sommes pas de ceux qui ne pensent qu’au sein des livres et dont l’idée attend pour naître les impulsions de l’imprimé ; notre habitude est de penser au grand air, marchant, sautant, montant, dansant, et de préférence sur les montagnes solitaires ou sur l’extrême bord de la mer, là où les chemins se font méditatifs eux-mêmes. »
Friedrich Nietzsche
Le Gai Savoir (Die fröhliche Wissenschaft, la gaya scienza), 1882, trad. Patrick Wotling, éditions Garnier-Flammarion, 2007
La Forêt, telle que l’avait annoncée et admirée Ernst Jünger…
« La Forêt, telle que l’avait annoncée et admirée Ernst Jünger, l’un des grands philosophes de ce siècle, la forêt refuge et régénération, source de l’éternelle jeunesse, est là aussi. Elle enferme symboliquement tous les éléments de notre survie. Je sais que lorsque les fous et les sages, qui prétendent se partager la domination du monde, auront, l’un après l’autre, appuyé sur tous les boutons qui peuvent anéantir notre planète, l’on verra sortir des bunkers secrets ou des halliers indestructibles quelques fiers « Ayacks » qui se porteront en avant, les bras croisés, jusqu’aux Falaises de marbre, pour regarder sans ciller naître un monde nouveau qui sera pour très longtemps ou pour toujours le monde des vivants. »
Jean-Louis Foncine
Le Royaume des Vivants, texte écrit à l’occasion du 50ème anniversaire de la Collection « Signe de Piste », 1987
Comme le chien loup de Jack London, je ne peux résister…
« Comme le chien loup de Jack London, je ne peux résister longtemps à l’appel de la forêt. Le besoin que j’ai d’elle s’enracine dans ma part animale autant que dans ma spiritualité. L’une n’allant pas sans l’autre. Je ne me « promène » pas en forêt. Marchant par les taillis et les futaies, je vais à la rencontre de mes origines et de mon éternité. Bien que domestiqué par l’homme, la forêt conserve son mystère. Il suffit pour cela d’attendre la chute du jour et les angoisses du cycle nocturne, domaine d’Artémis, la toujours jeune, dont les cheveux d’or s’ornent du croissant de lune. »
Dominique Venner
Dictionnaire amoureux de la chasse, éditions Plon, coll. Dictionnaire amoureux, 2006
Un héroïsme sans drapeaux ni tambours…
« Un héroïsme sans drapeaux ni tambours. Semblable à l’enfantement, il se manifeste dans le silence du quotidien et des tâches sacrées par lesquelles, chaque jour, les femmes font renaître la vie au sein d’un foyer. Oui, il y a une sacralité des gestes quotidiens des femmes, parce que ces gestes renouvellent la vie par les travaux de la maison, le soir aux enfants, la préparation des repas, l’attention à la toilette, toutes choses par lesquelles un foyer existe ou non, et par lesquelles la transmission de la tradition s’effectue par exemplarité. »
Dominique Venner
Le Choc de l’histoire, Via Romana, 2011
À l’ENA, on ne leur a pas appris la différence…
« À l’ENA, on ne leur a pas appris la différence entre la politique et le politique. On leur a seulement parlé de régimes politiques, de pratique gouvernementale et de météorologie électorale. La plupart d’entre eux s’imaginent que la politique se réduit à une gestion administrative inspirée du management des grandes entreprises. C’est, là, confondre le gouvernement des hommes avec l’administration des choses, et croire qu’il faut s’en remettre à l’avis des techniciens et des experts. Dans une telle optique, il n’y aurait pour chaque problème politique qu’une seule solution optimale : « Il n’y a pas d’alternative » est un mot d’ordre typiquement impolitique. En politique, il y a toujours des alternatives parce qu’un même fait peut toujours être jugé différemment selon le contexte et les critères d’appréciation retenus. Une autre forme classique d’impolitique consiste à croire que les fins du politique peuvent être déterminées par des catégories qui lui sont étrangères – économiques, esthétiques ou morales par exemple. En réalité, chaque activité humaine a sa propre finalité, sa propre morale et ses propres moyens. Dire qu’il y a une essence du politique, c’est dire que la politique est une activité consubstantielle à l’existence humaine au seul motif que l’homme est, par nature, un animal politique et social, et que la société ne dérive pas, contrairement à ce qu’affirment les théoriciens du contrat, d’un « état de nature » prépolitique ou présocial. [Pour] Julien Freund, comme toute activité humaine, la politique possède des présupposés, c’est-à-dire des conditions constitutives qui font qu’elle est ce qu’elle est, et non pas autre chose. Freund en retient trois : la relation du commandement et de l’obéissance, la relation du public et du privé, enfin la relation de l’ami et de l’ennemi. Cette dernière relation est déterminante, car il n’y a de politique que là où il y a possibilité d’un ennemi. Si, comme le dit Clausewitz, la guerre est la poursuite de la politique par d’autres moyens, c’est que le politique est intrinsèquement conflictuel. Il en résulte qu’un monde sans frontières serait un monde d’où le politique aurait disparu. C’est en ce sens qu’un État mondial est une absurdité. »
Alain de Benoist
Entretien avec Nicolas Gauthier, Boulevard Voltaire, 12 septembre 2014
Ceux qui prétendent combiner culture et égalité…
« Ceux qui prétendent combiner culture et égalité, éducation et égalité, et introduire l’égalité ou seulement de l’égalité dans la culture ou l’éducation, s’abusent eux-mêmes ou abusent les autres, ou les deux, car il y a une incompatibilité radicale, fondamentale, insurmontable, entre ces domaines, ces champs ou ces valeurs. L’égalité est aussi absente de la culture qu’elle l’est de la nature. Les plus belles proclamations ne peuvent que reconnaître, ou imposer, ou prétendre imposer, une égalité en droit ou une égalité de droits ; et cette attitude est un héroïque, un magnifique défi à tout ce qui s’observe dans la nature et entre les hommes. […] L’égalité est une contrainte que s’imposent à grand mal certaines civilisations, en général contre leurs plus anciennes traditions et contre leurs instincts. »
Renaud Camus
La grande déculturation, éditions Fayard, 2008
L’enracinement est peut-être le besoin le plus important…
« L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. […] Les échanges d’influences entre milieux très différents ne sont pas moins indispensables que l’enracinement dans l’entourage naturel. Mais un milieu déterminé doit recevoir une influence extérieure non pas comme un apport, mais comme un stimulant qui rende sa vie propre plus intense. Il ne doit se nourrir des apports extérieurs qu’après les avoir digérés, et les individus qui le composent ne doivent les recevoir qu’à travers lui. »
Simone Weil
L’enracinement, 1943, éditions Gallimard, 1949
Auteurs
Auteurs récemment ajoutés