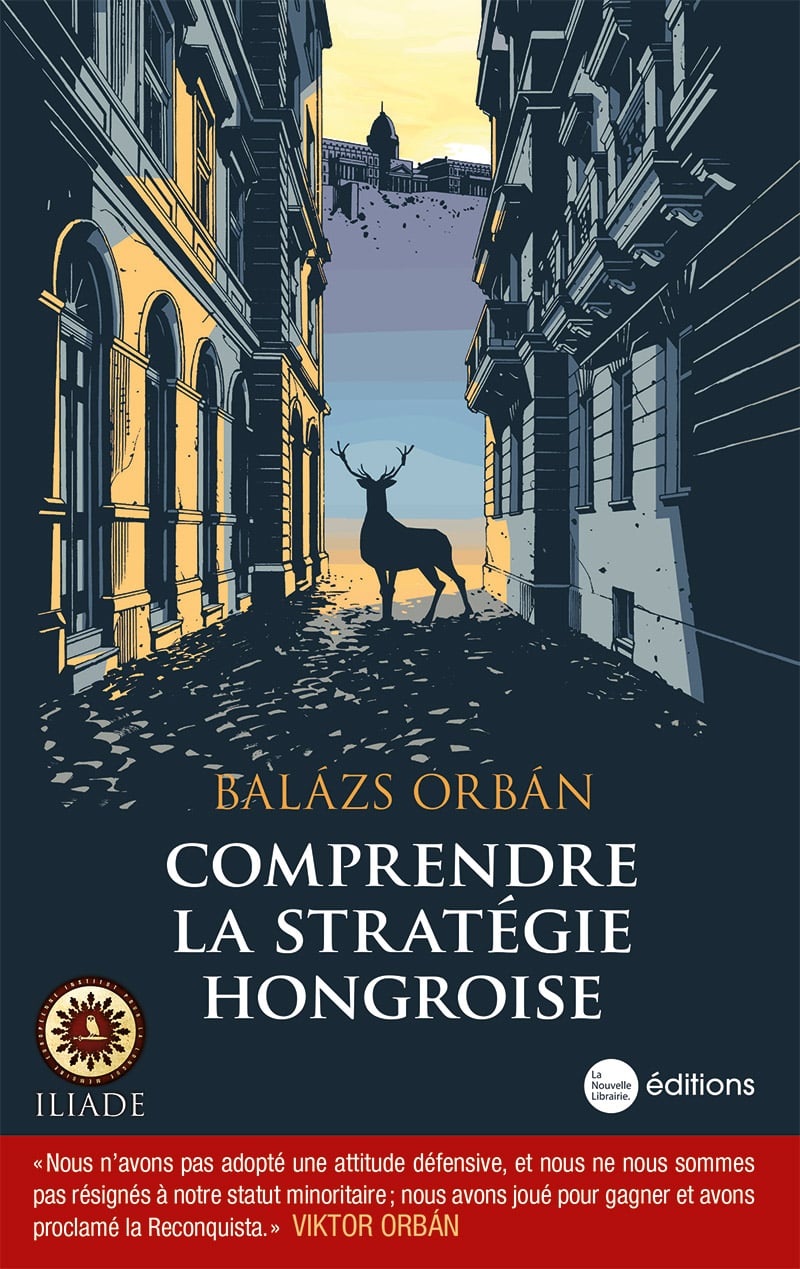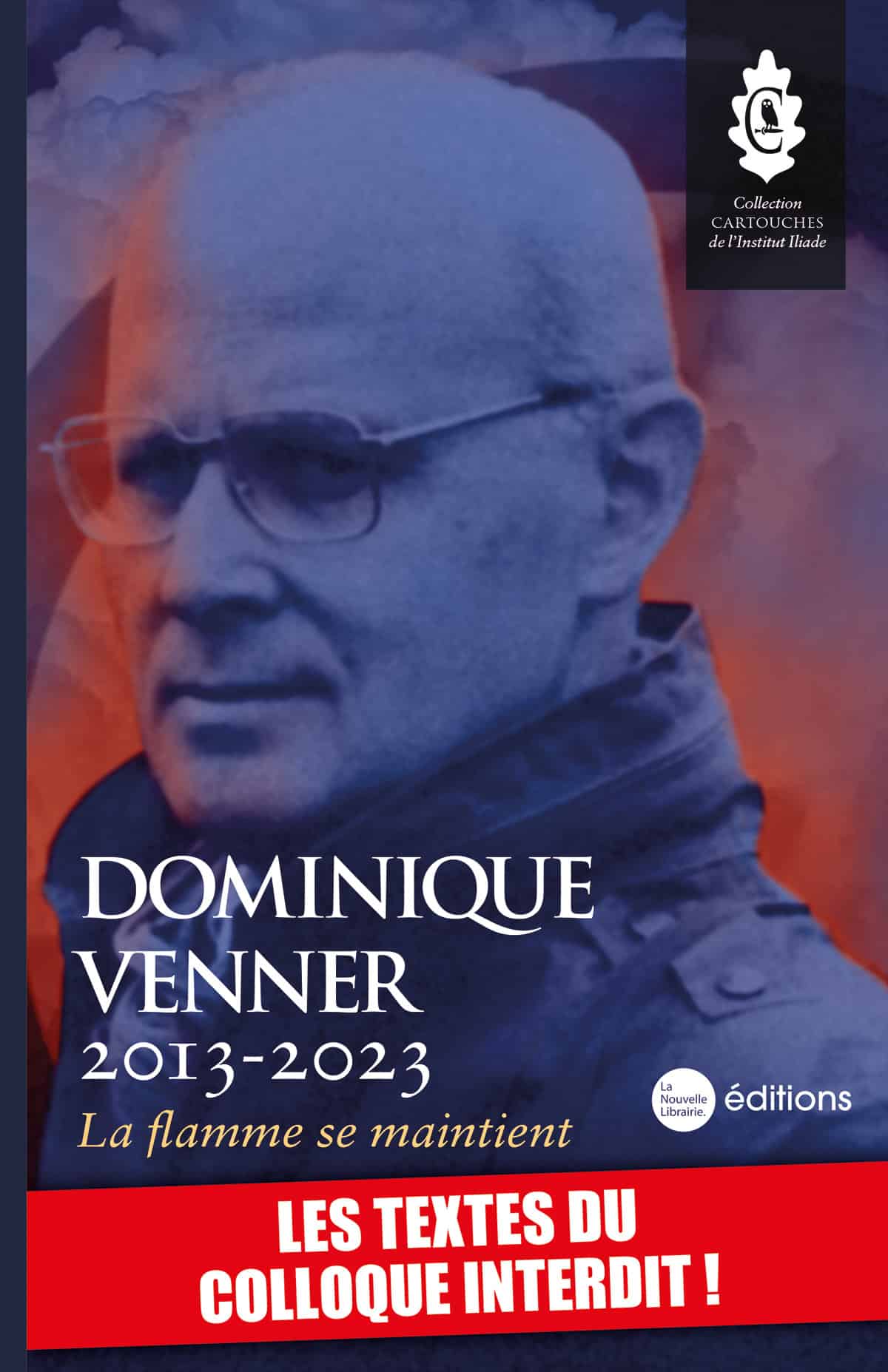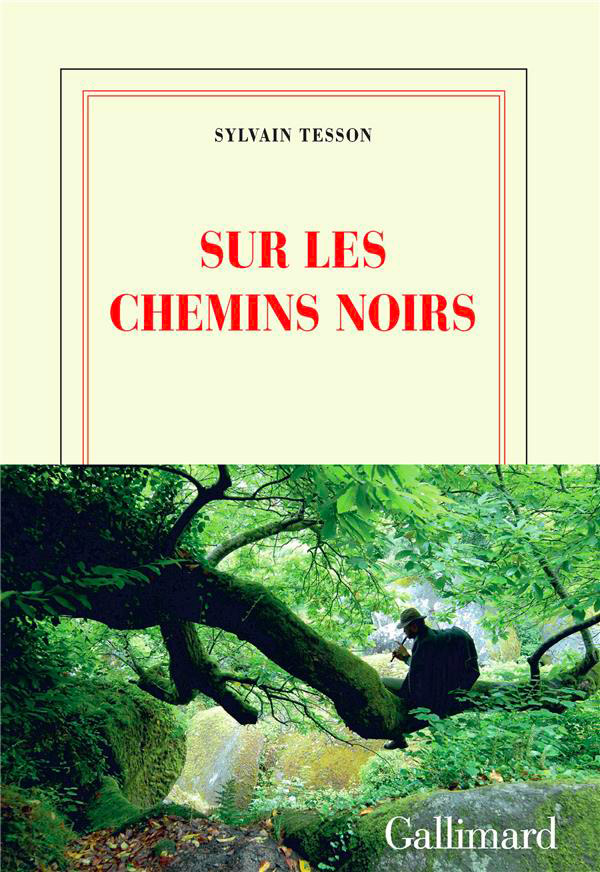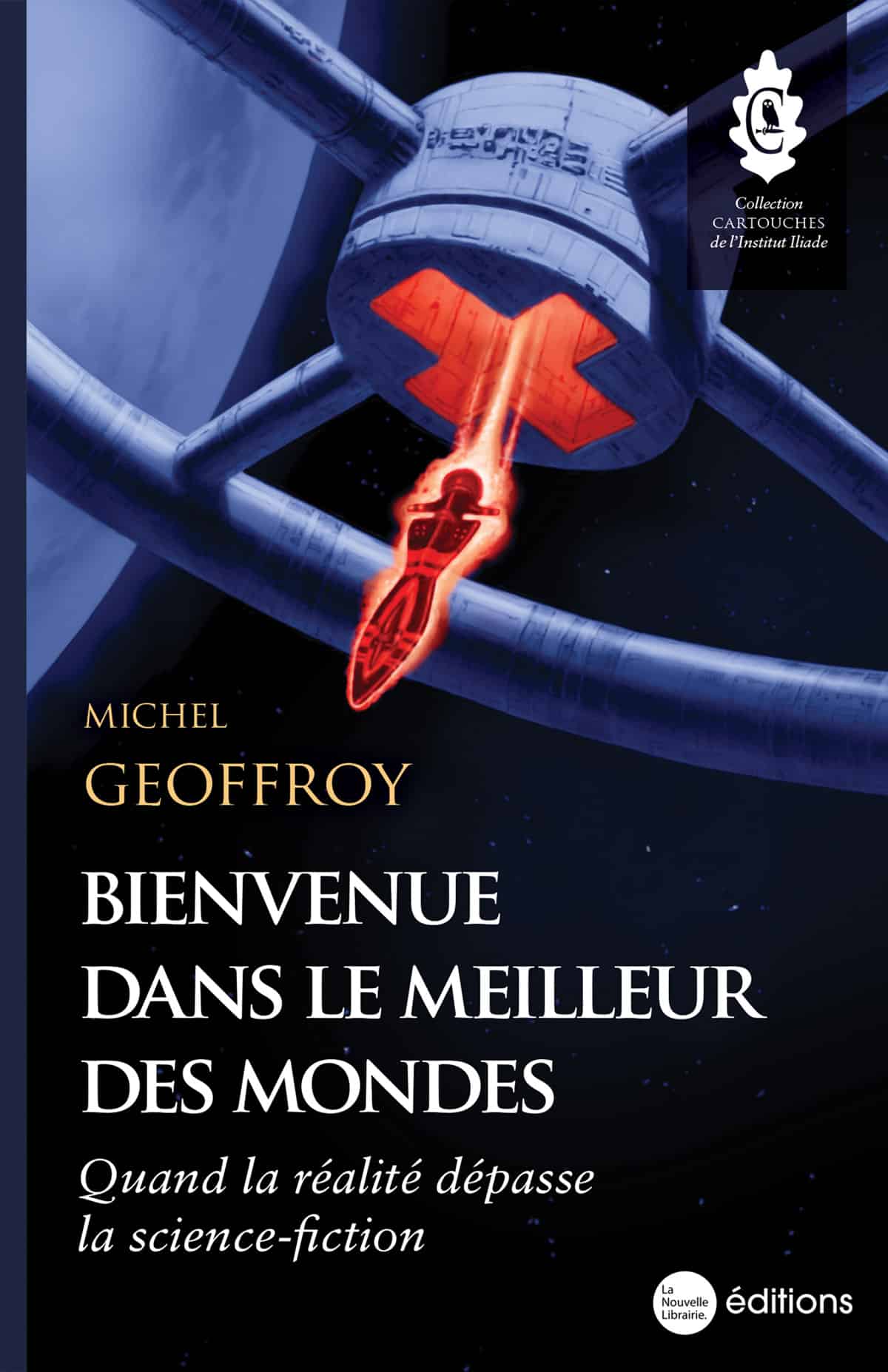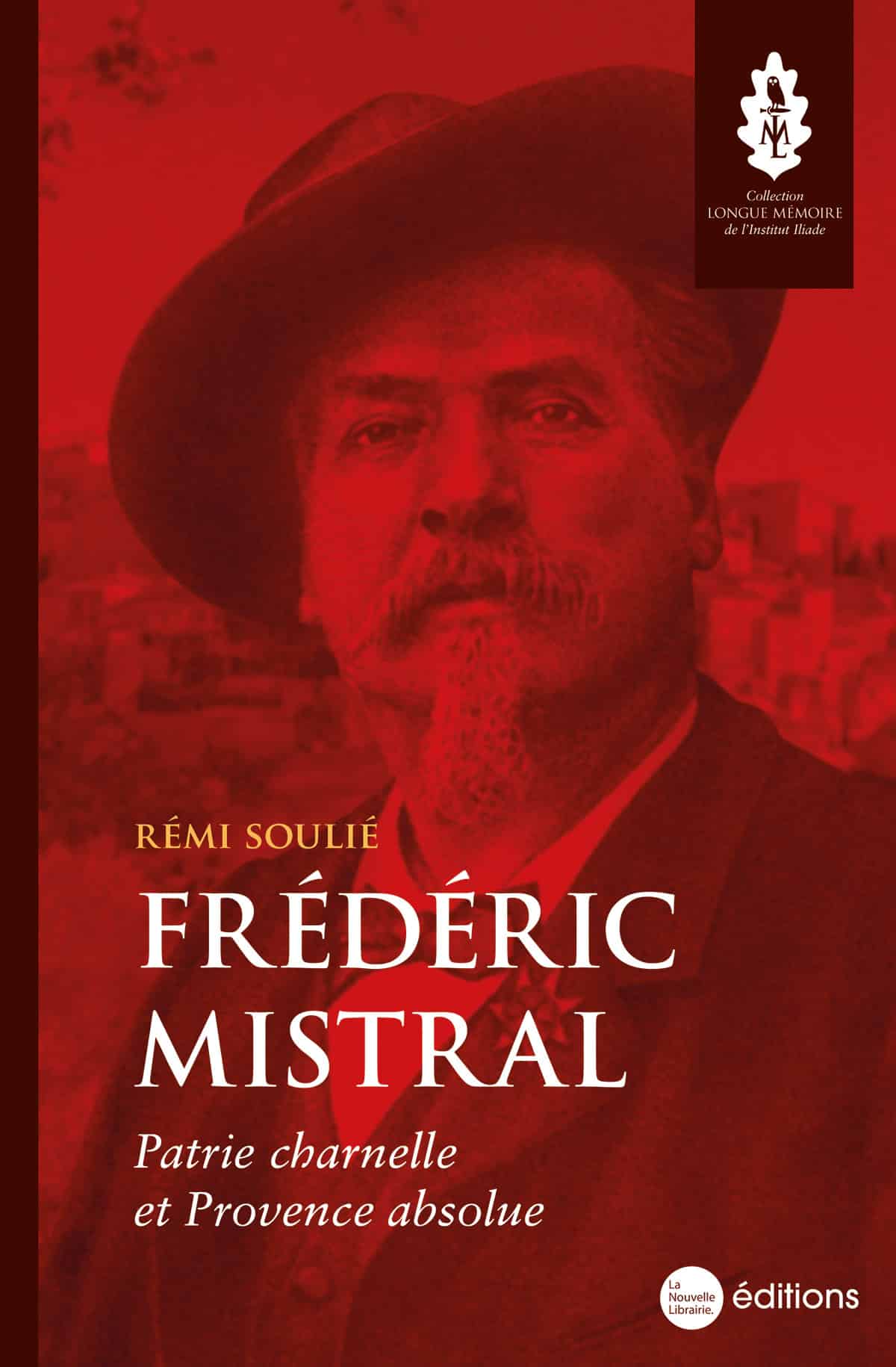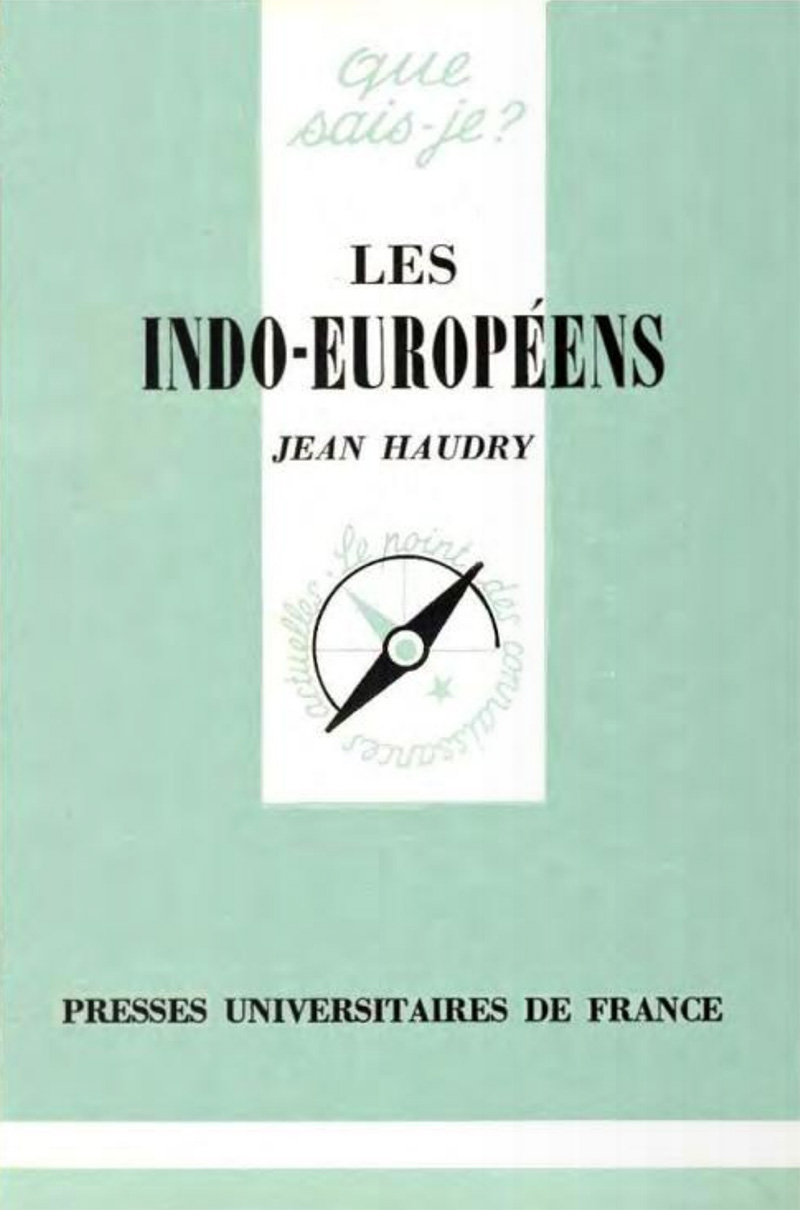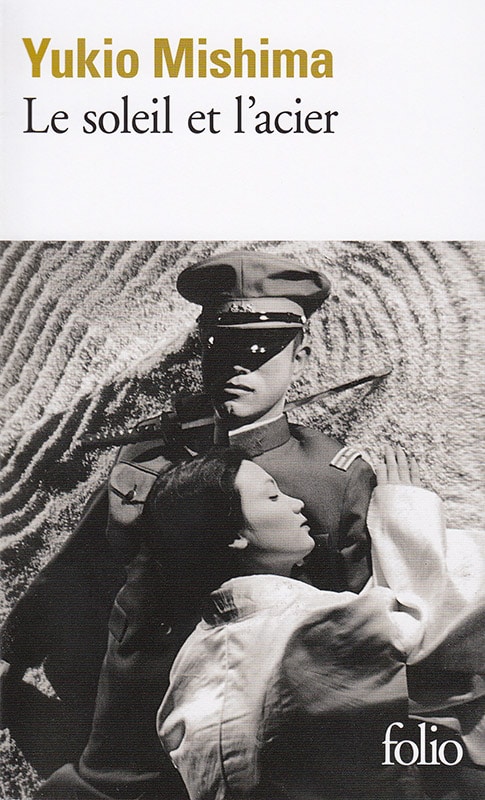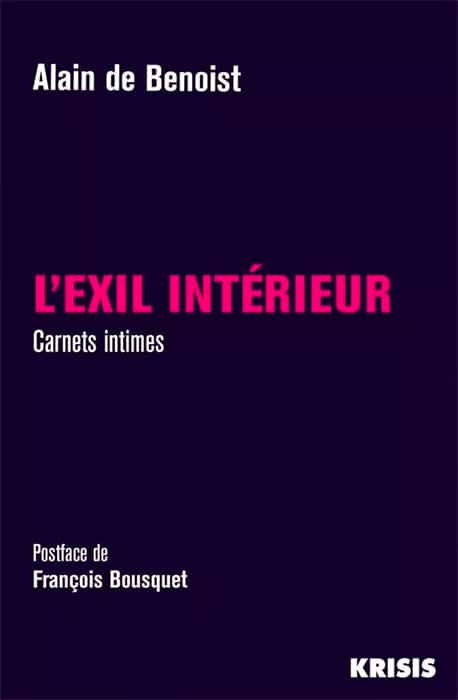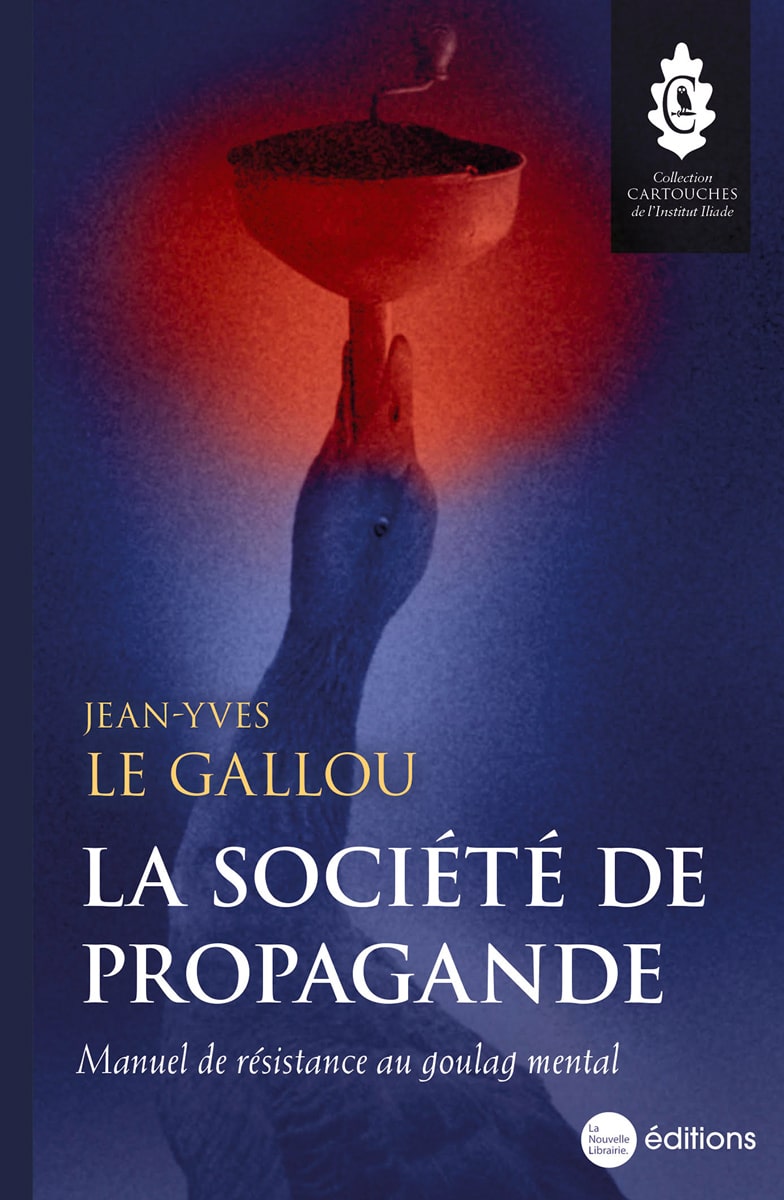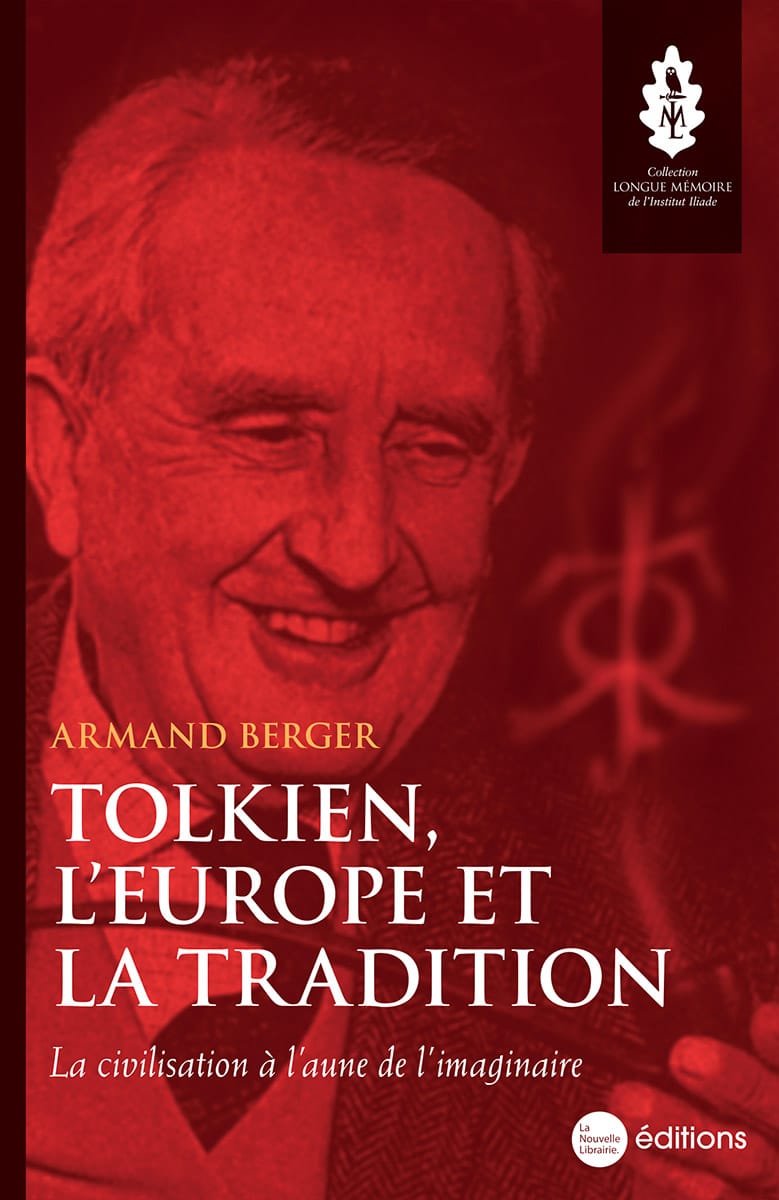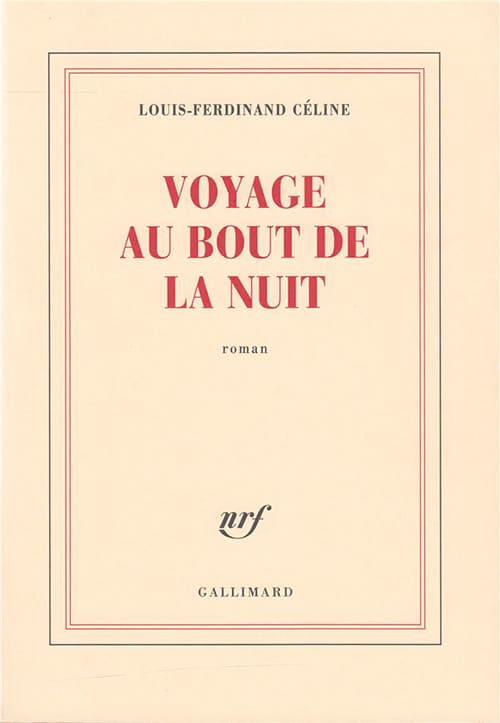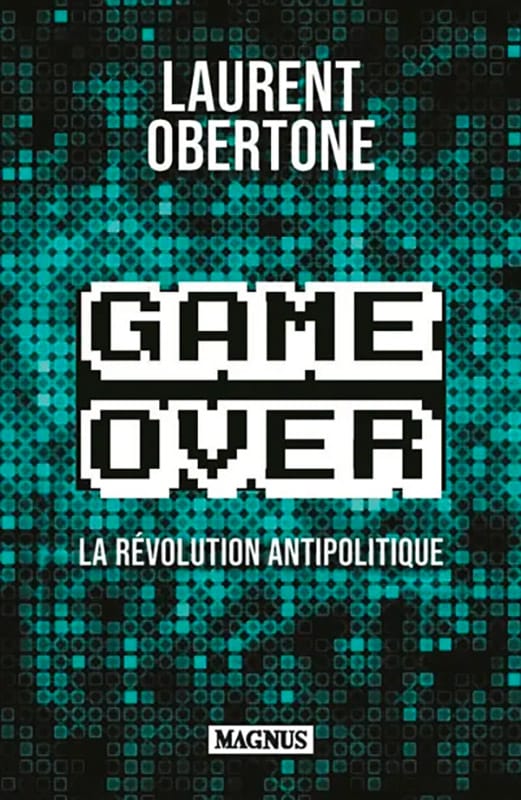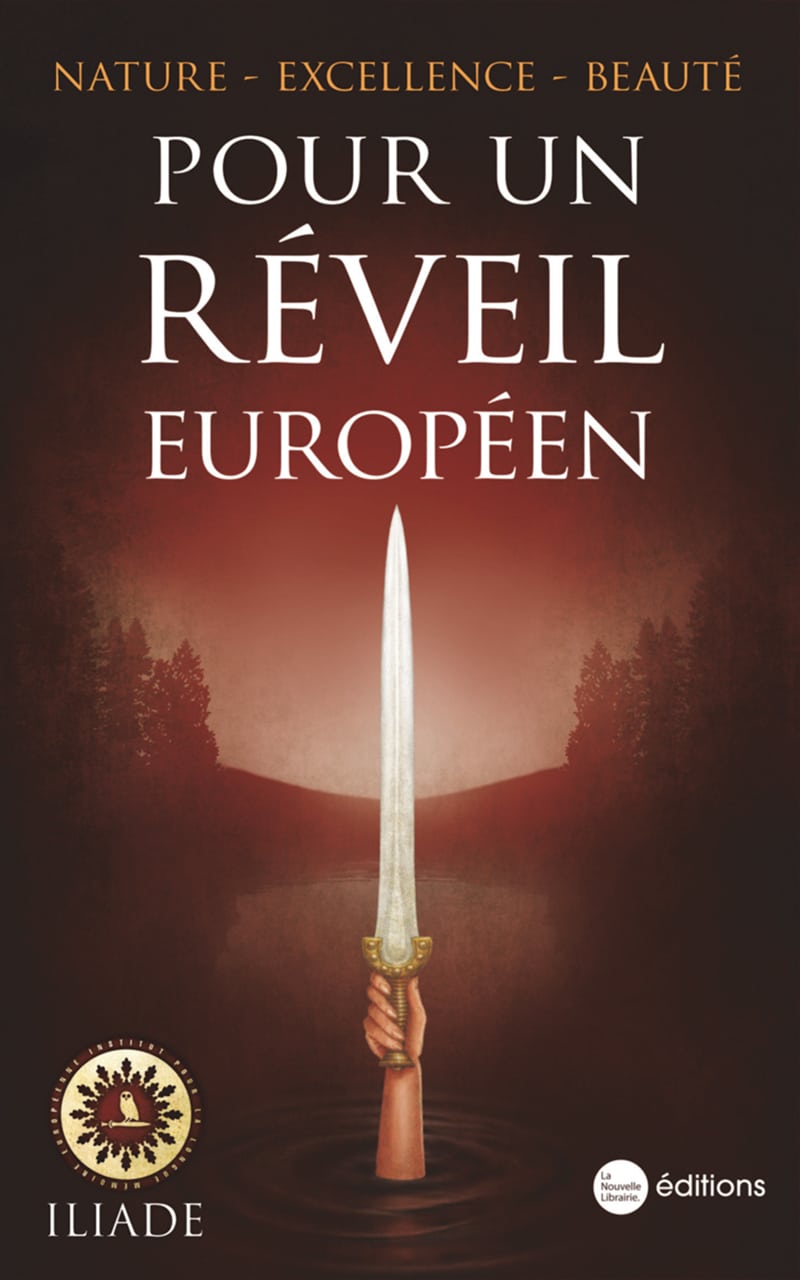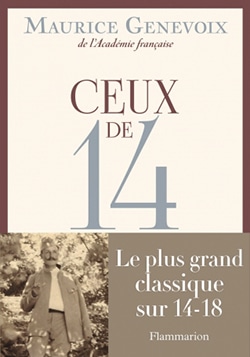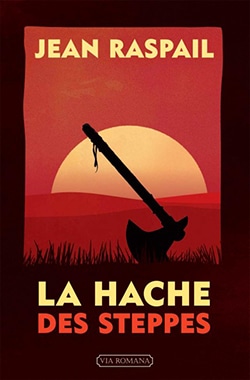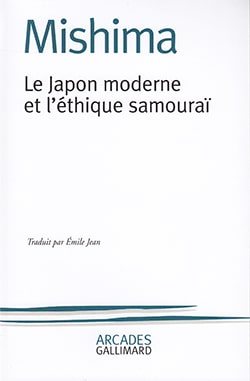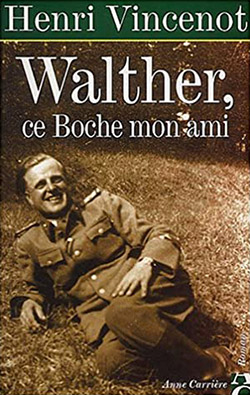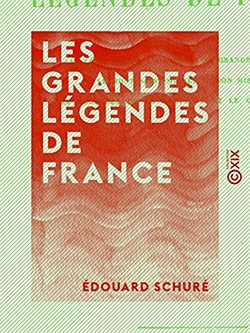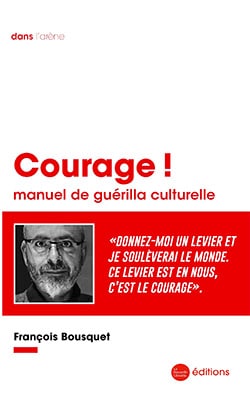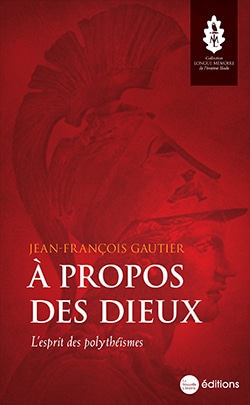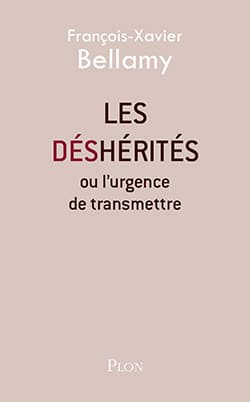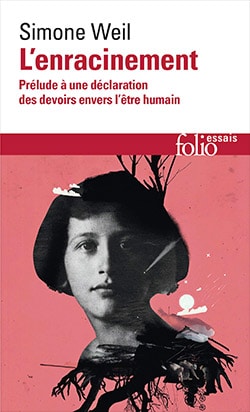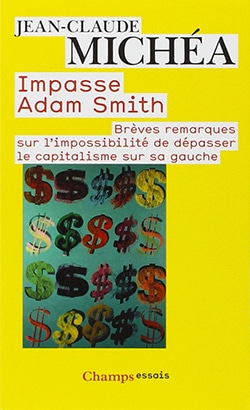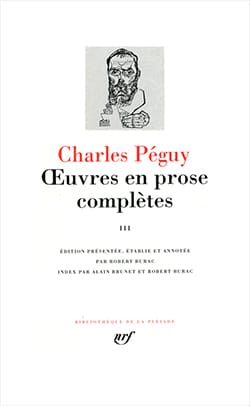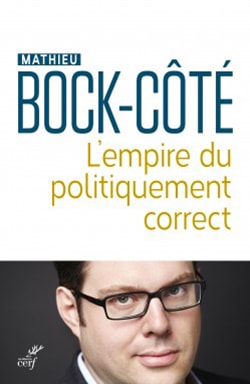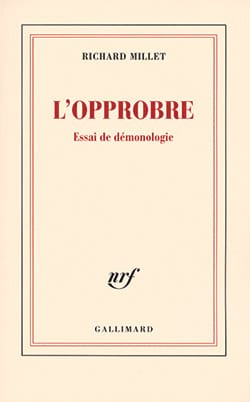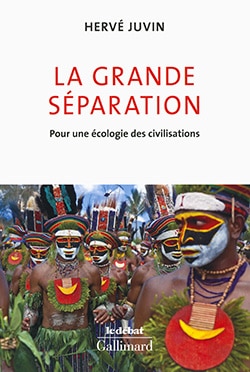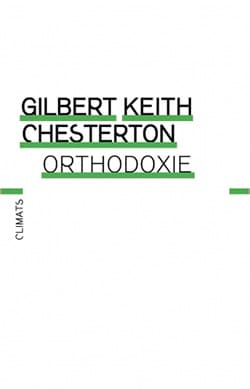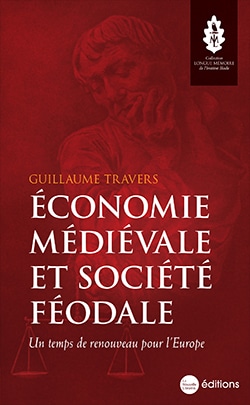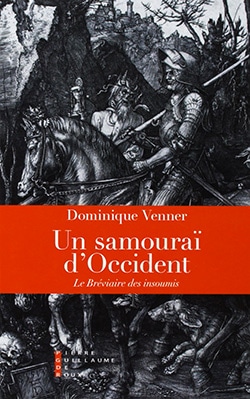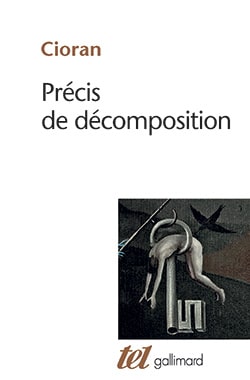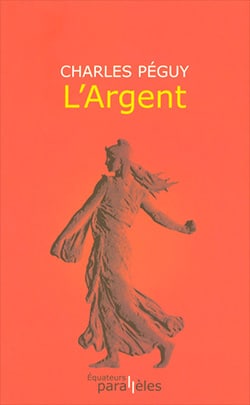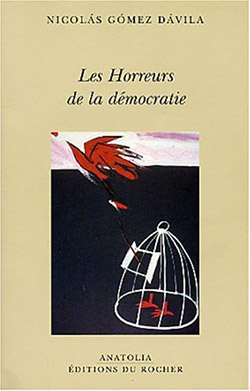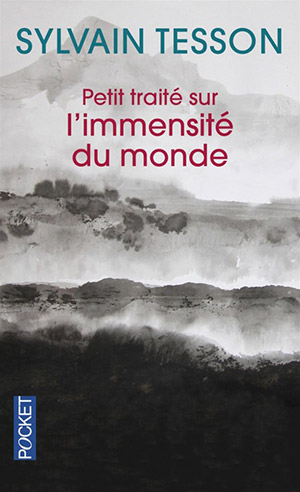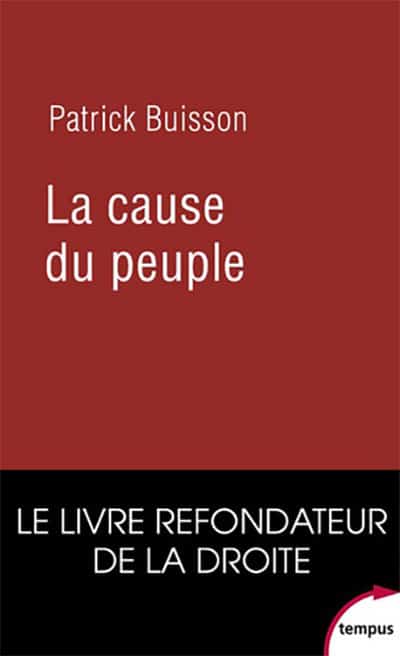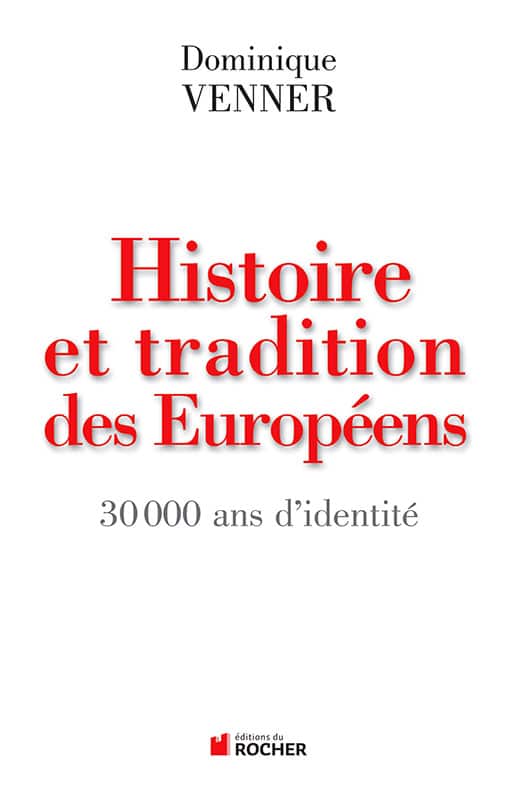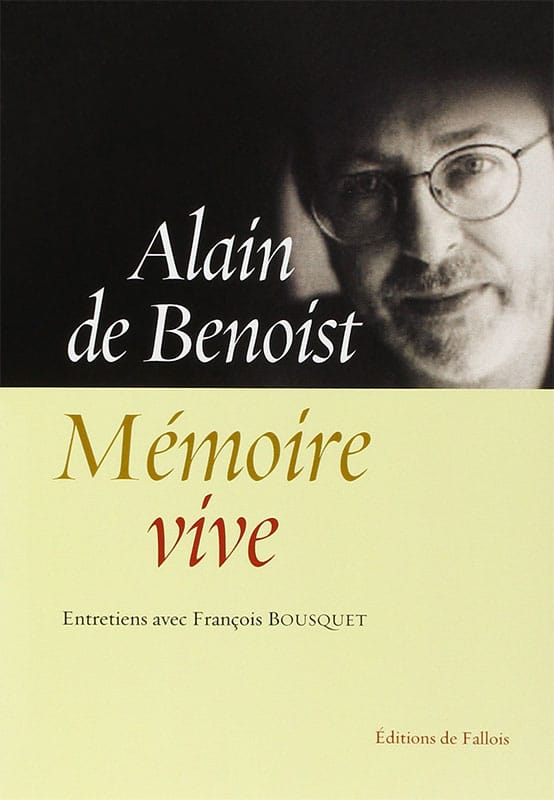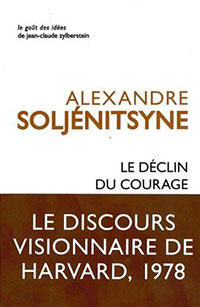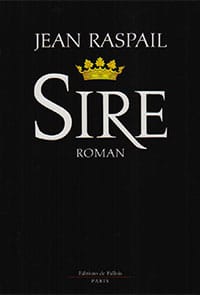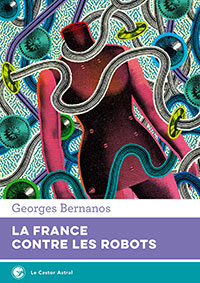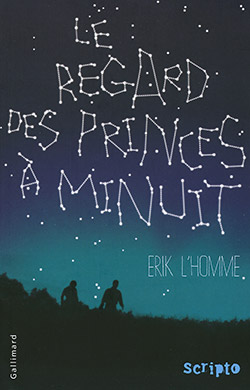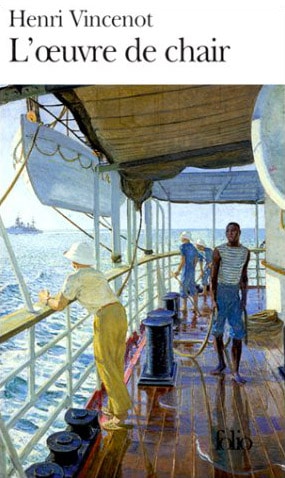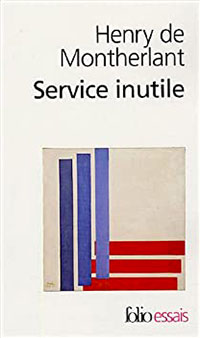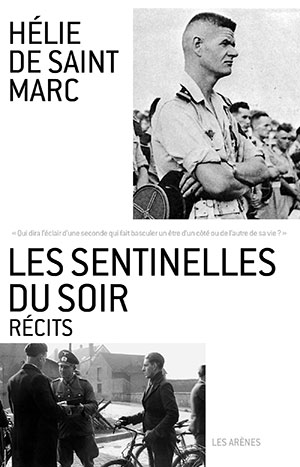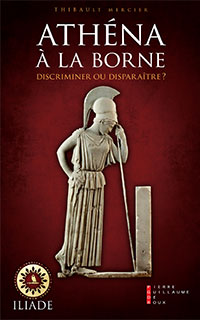« L’intelligentsia occidentale semble céder une fois encore, mais avec une intensité peut-être jamais atteinte, à l’illusion que l’homme aurait changé au point que l’Histoire ne pourrait plus être tragique, et qu’il y n’y aurait plus lieu dès lors de s’imposer l’angoisse du choix, ni de se préoccuper d’autres choses que de rechercher sa propre satisfaction.
Le temps du tragique passé, voici celui de la jouissance sans entrave, de la jouissance comme seule et unique réponse à toute question existentielle. Mais jouissance égoïste qui n’est à la portée que du petit nombre qui a les moyens de s’extraire de la dureté de la vie. La frustration des autres, du plus grand nombre, montrera peut-être demain que le tragique n’appartient pas du tout à un passé révolu. »
Henri Guaino
Ils veulent tuer l’occident, éditions Odile Jacob, 2019