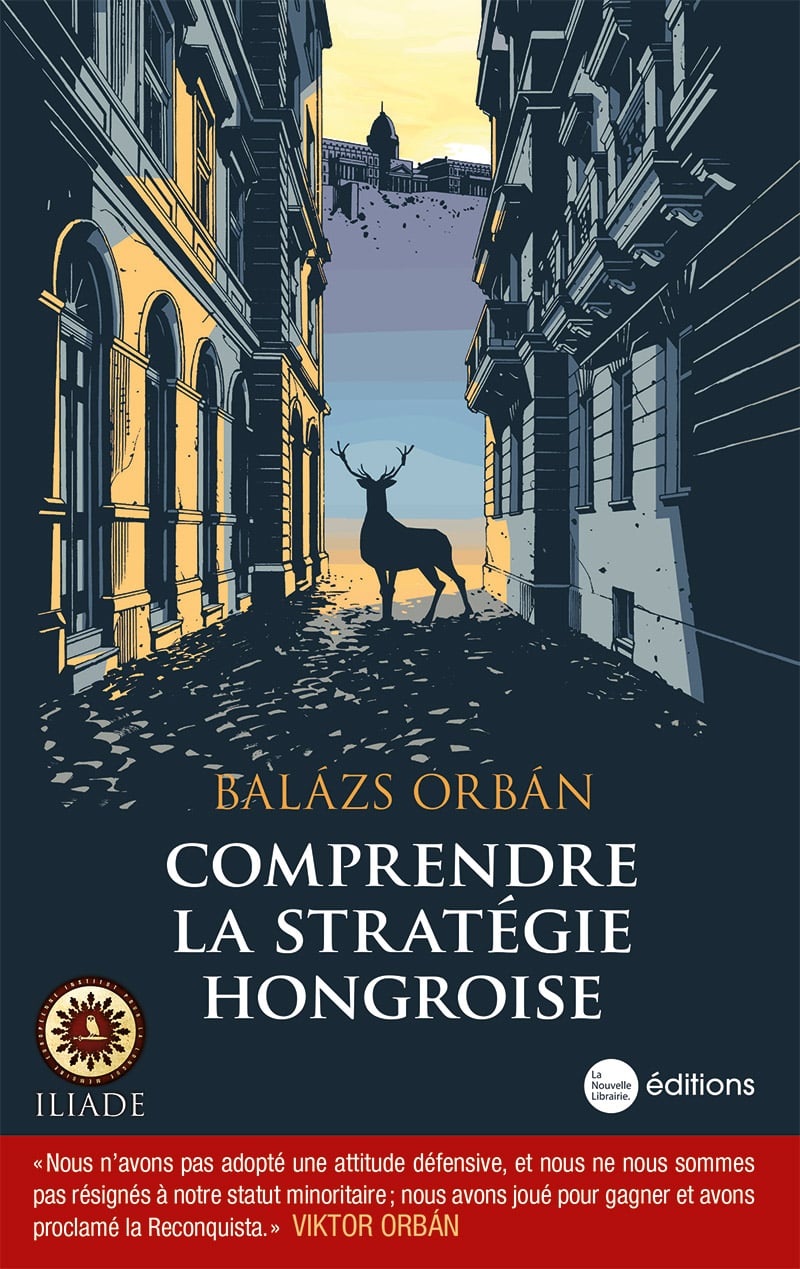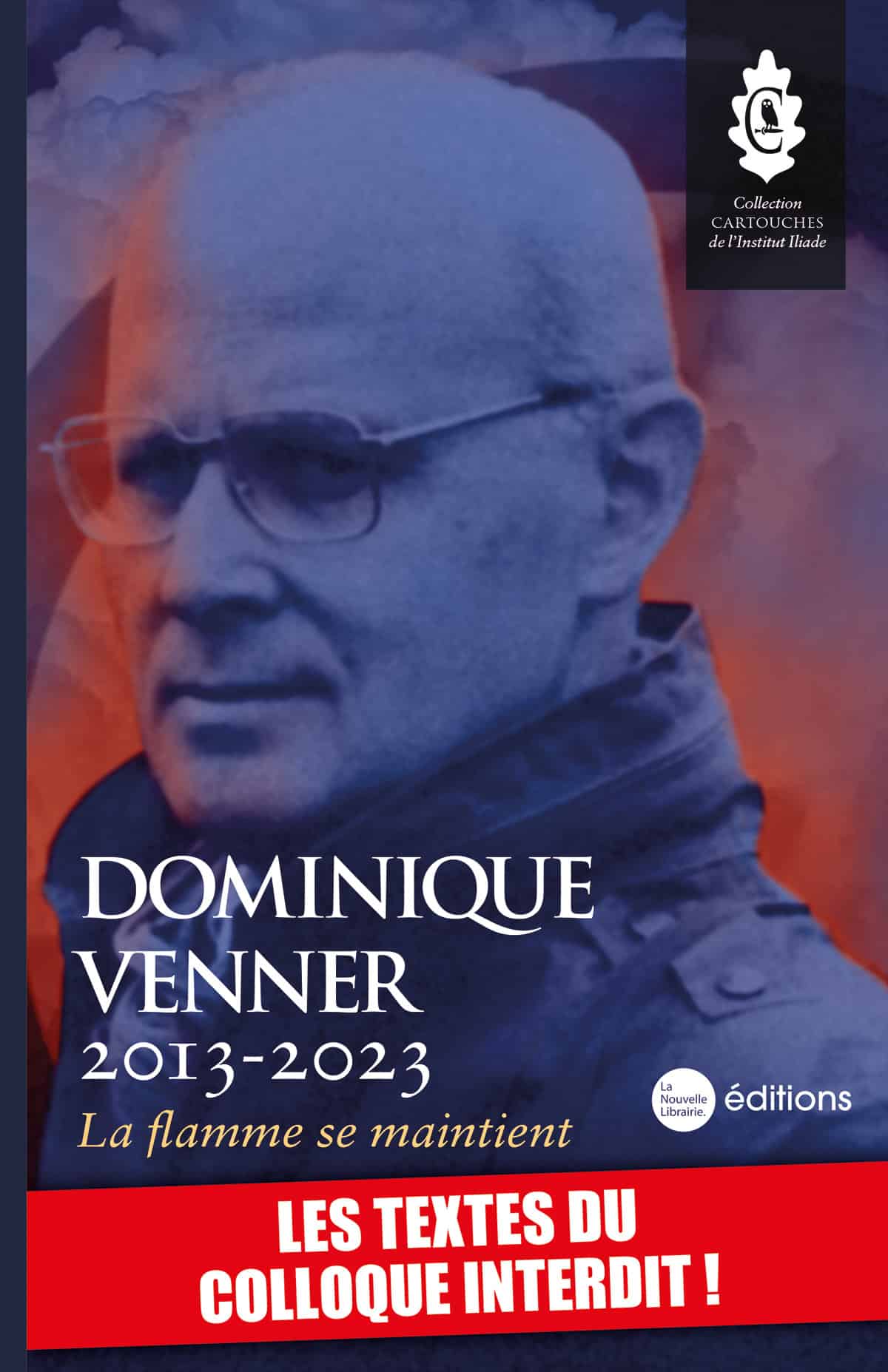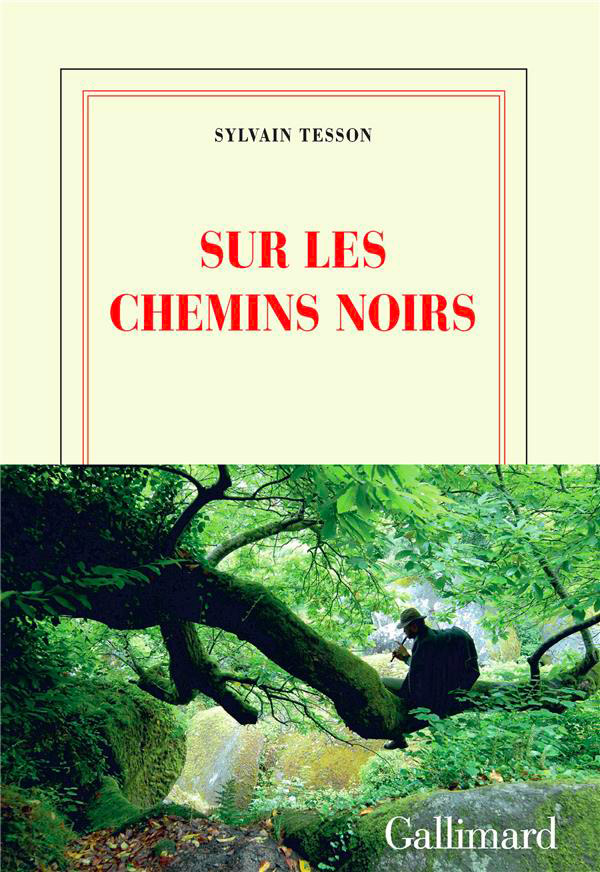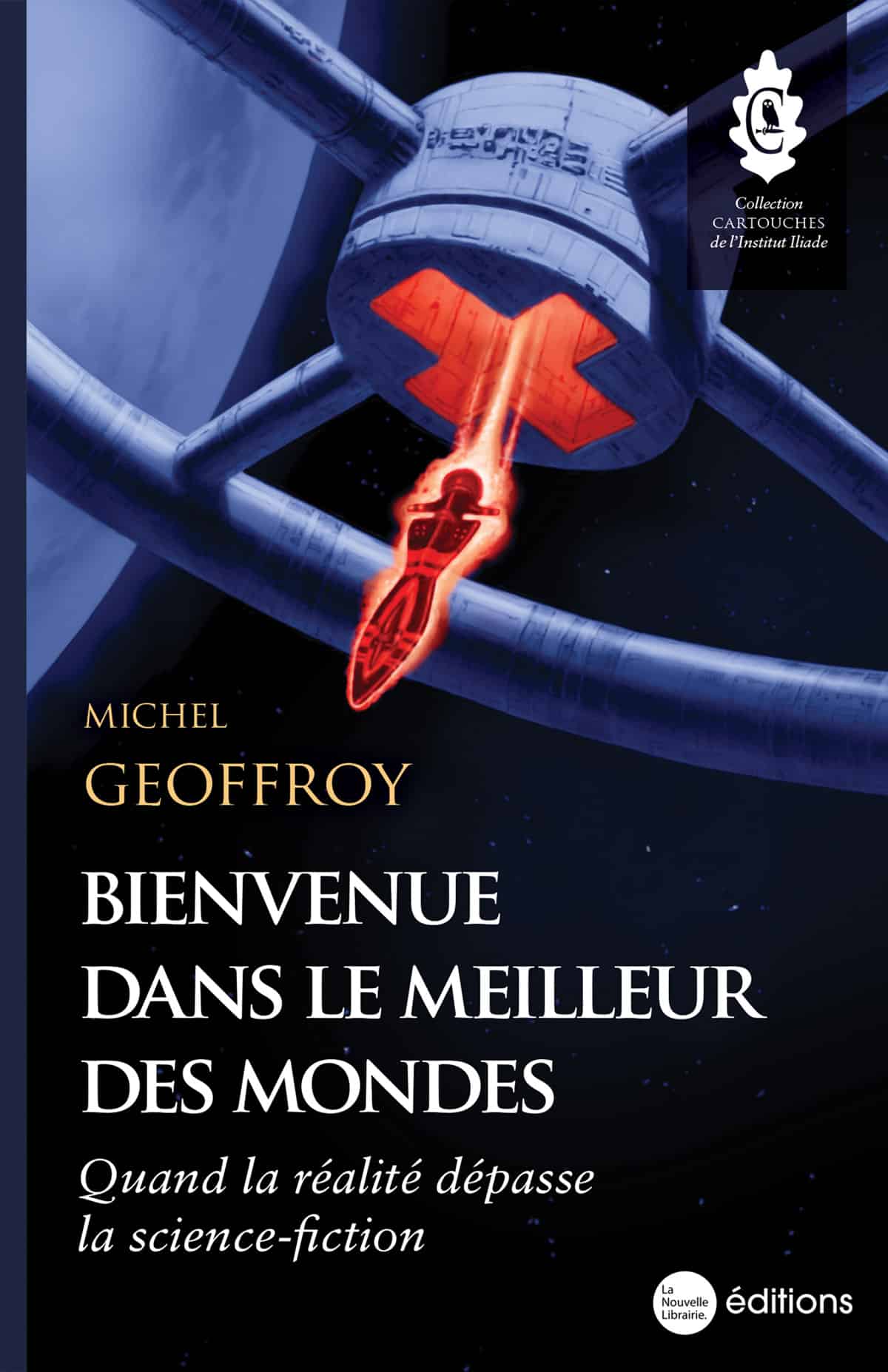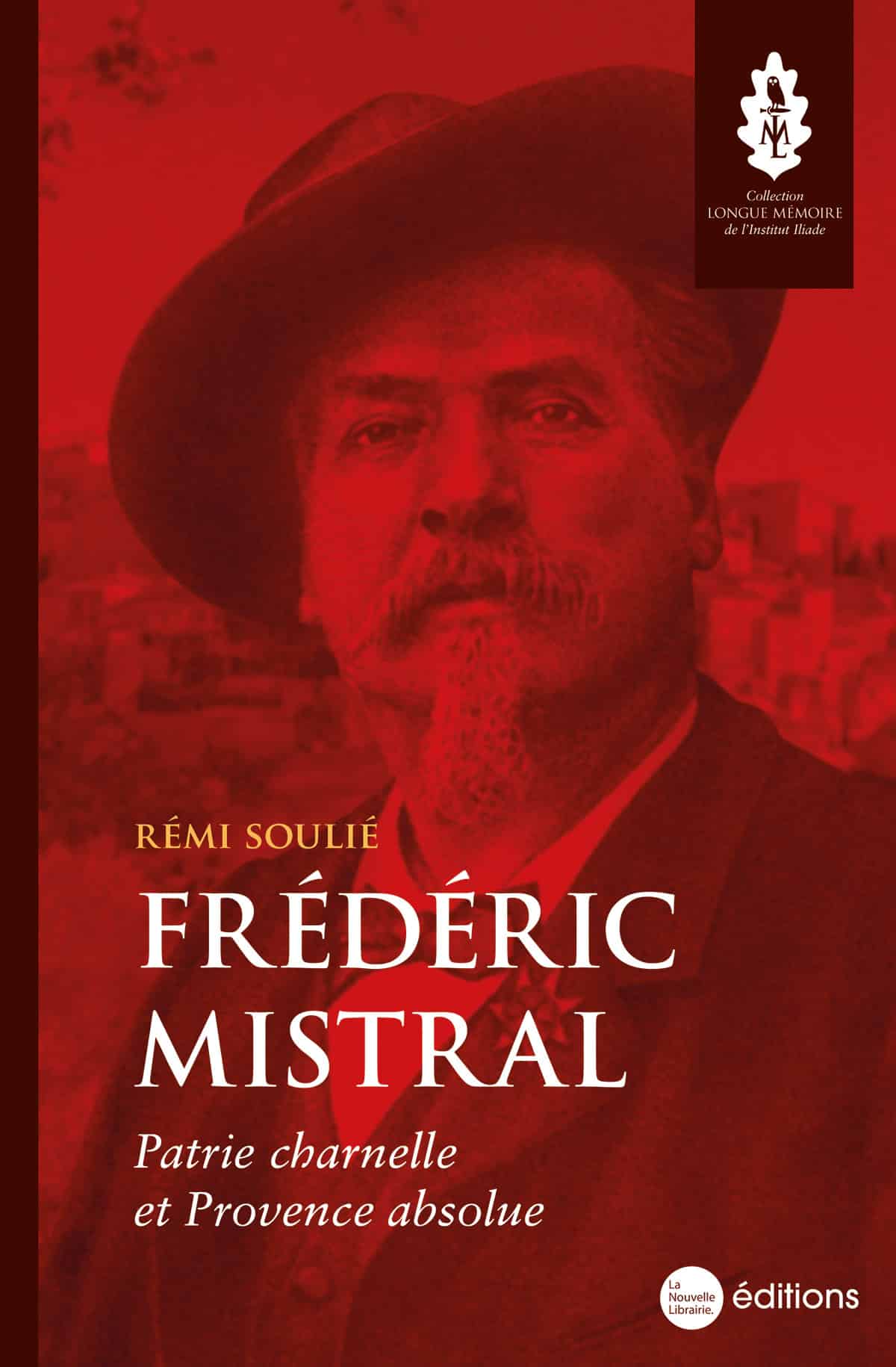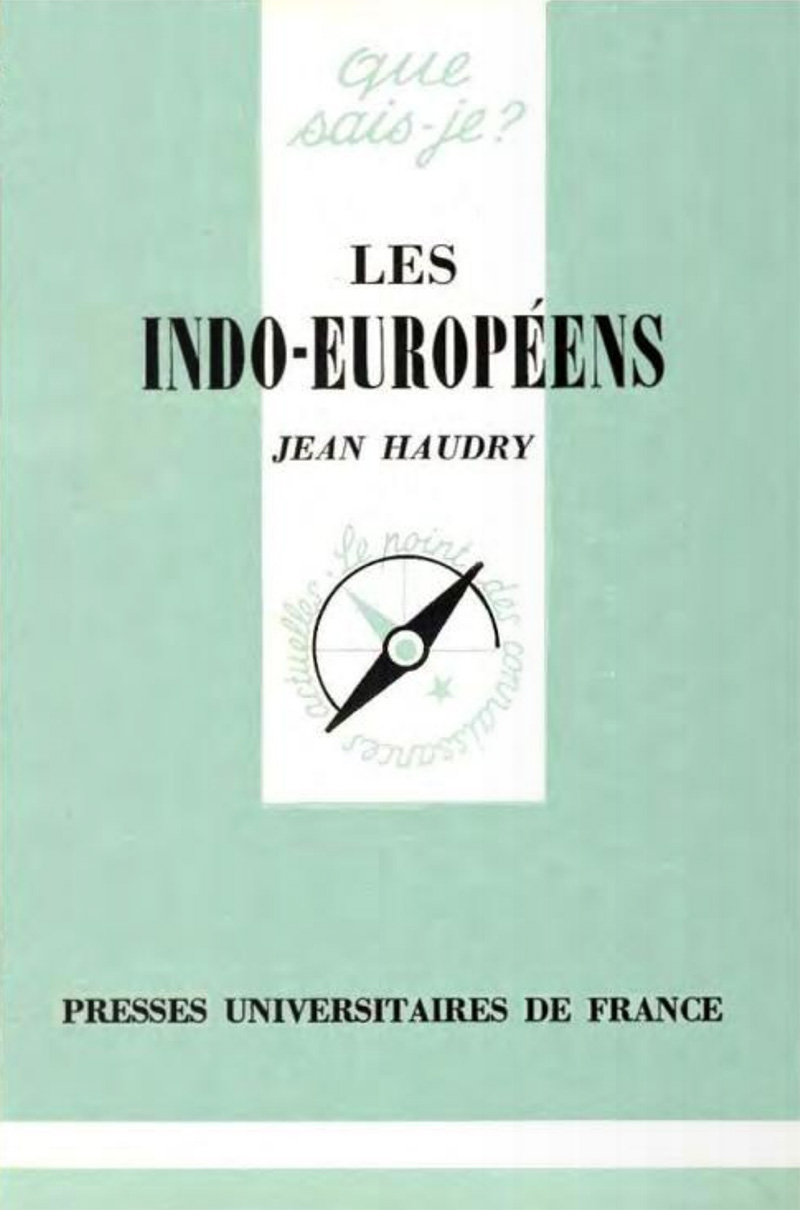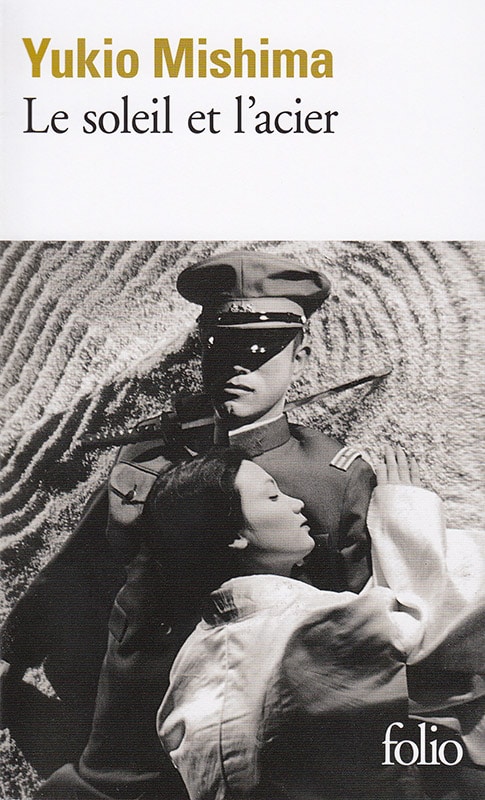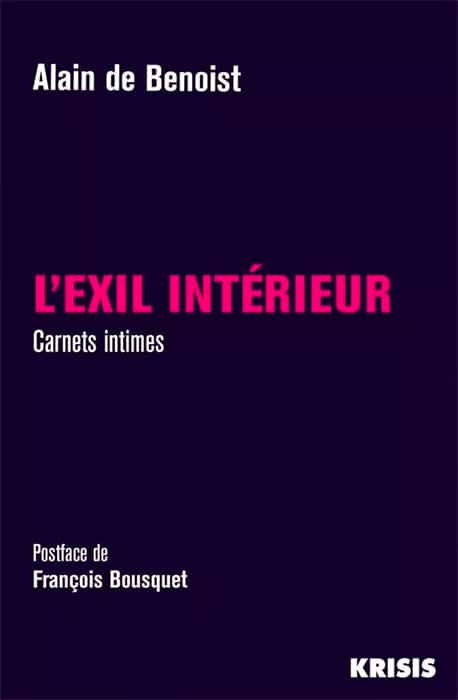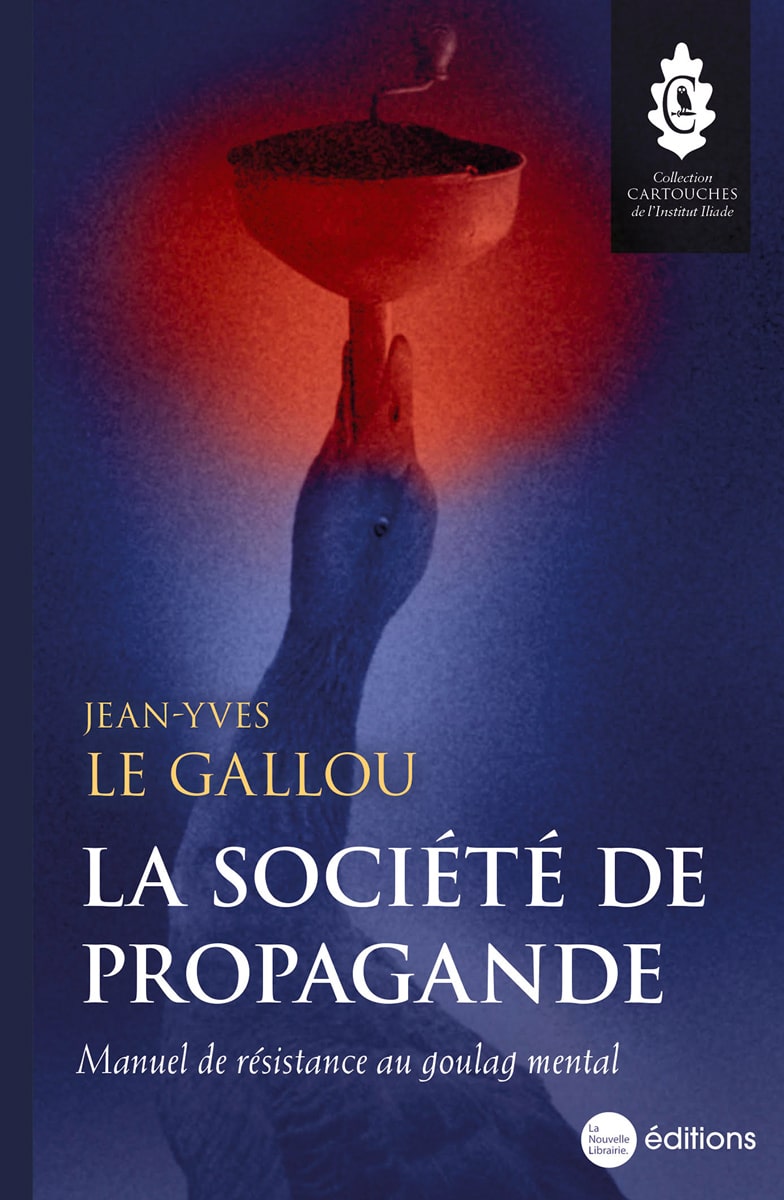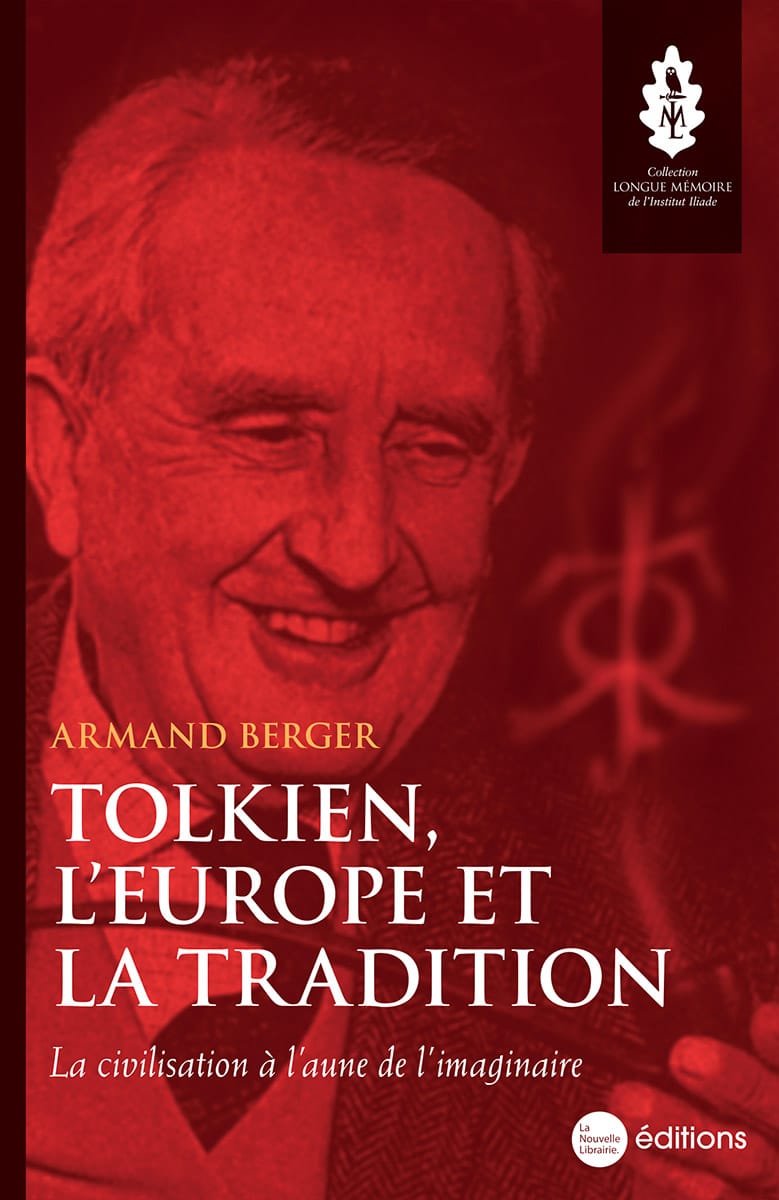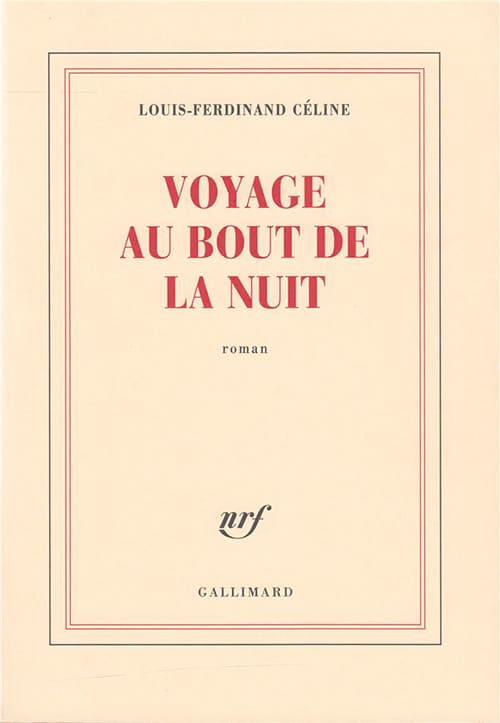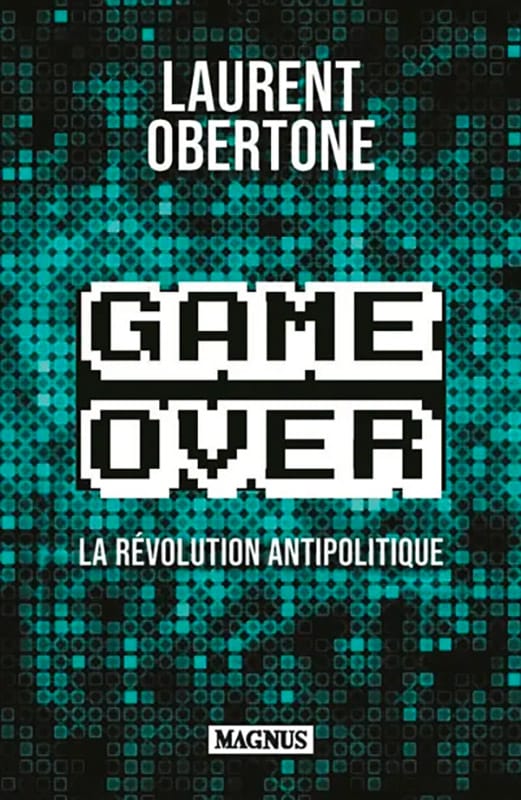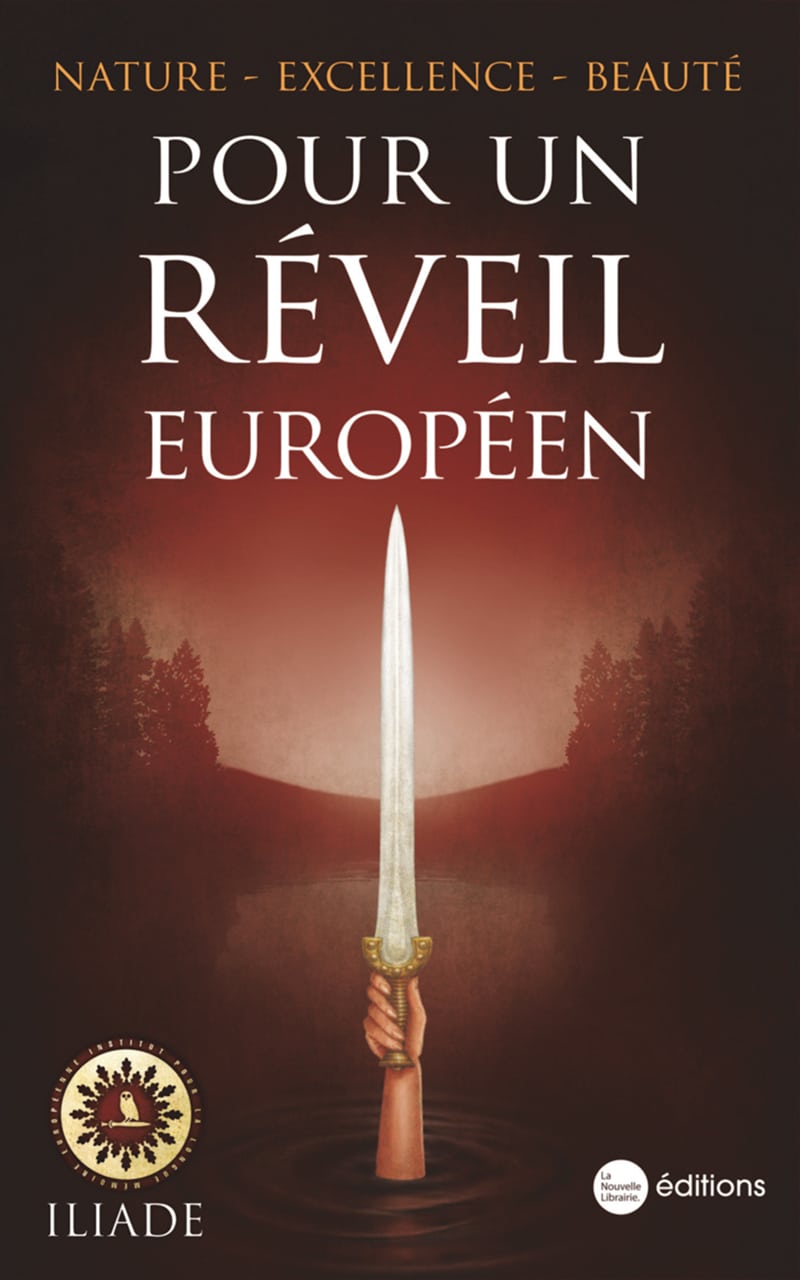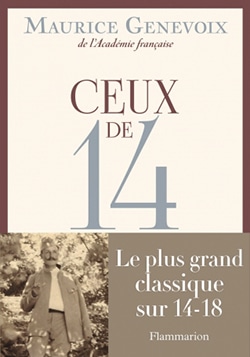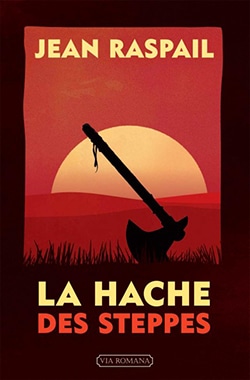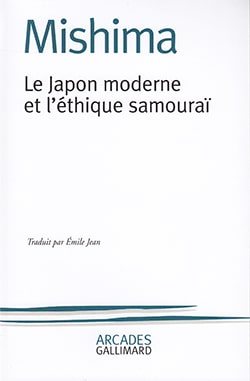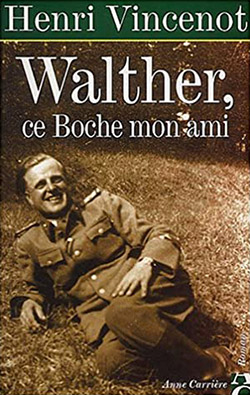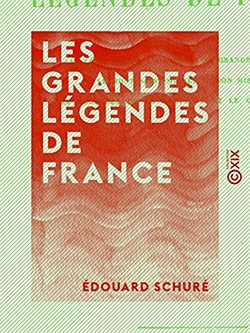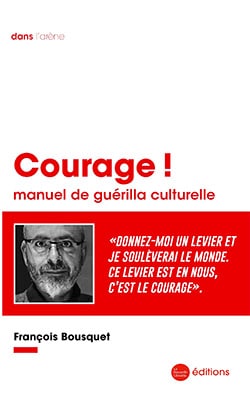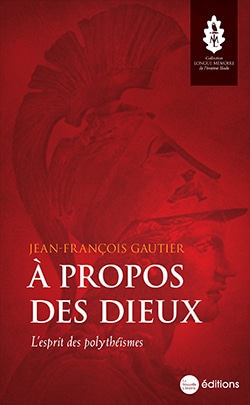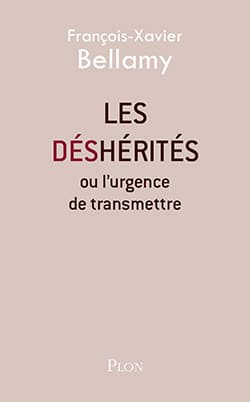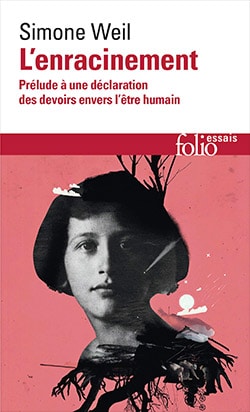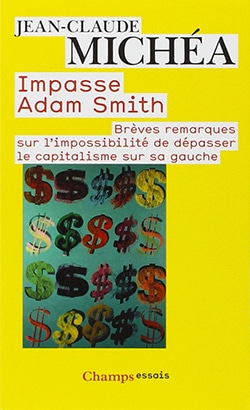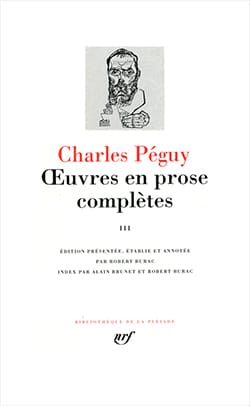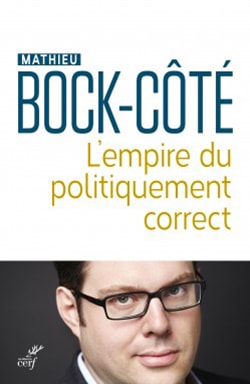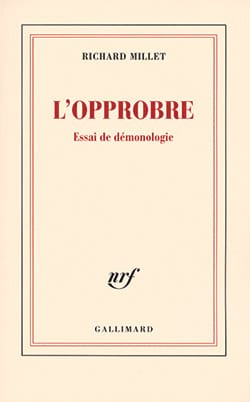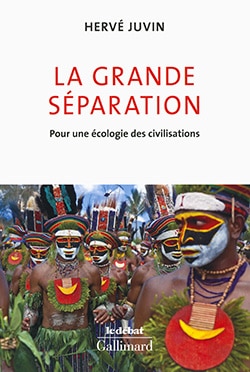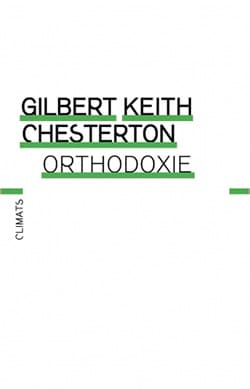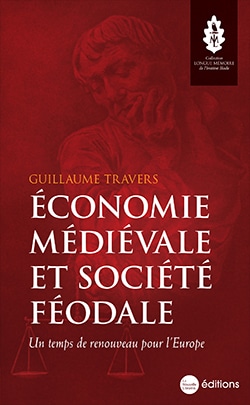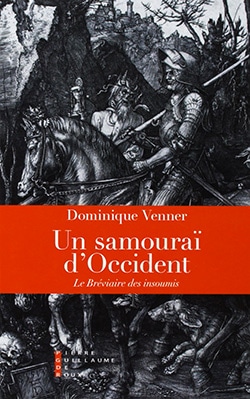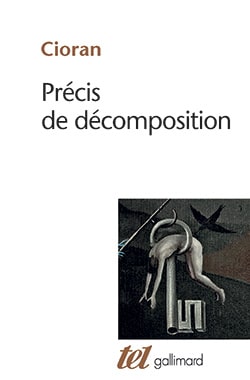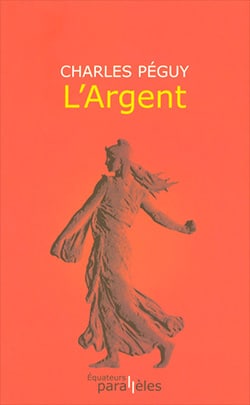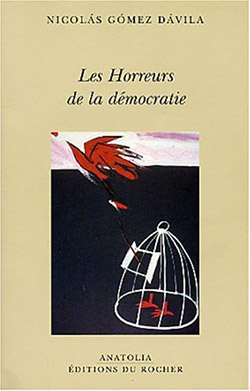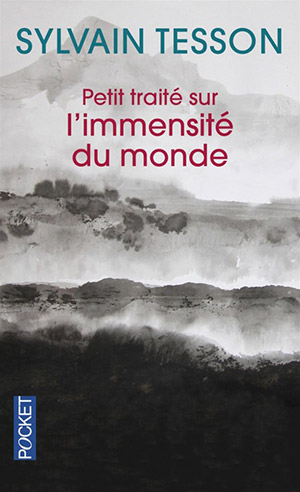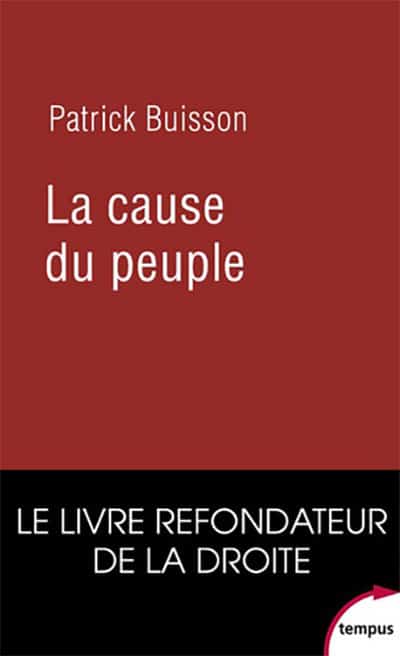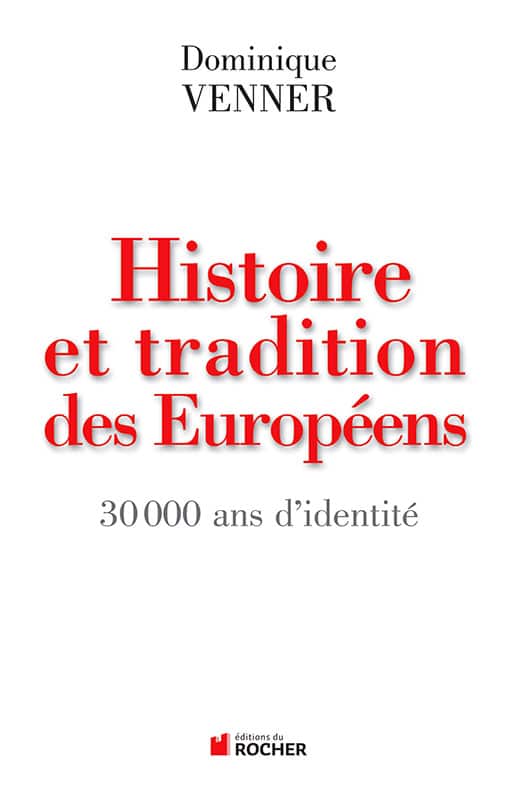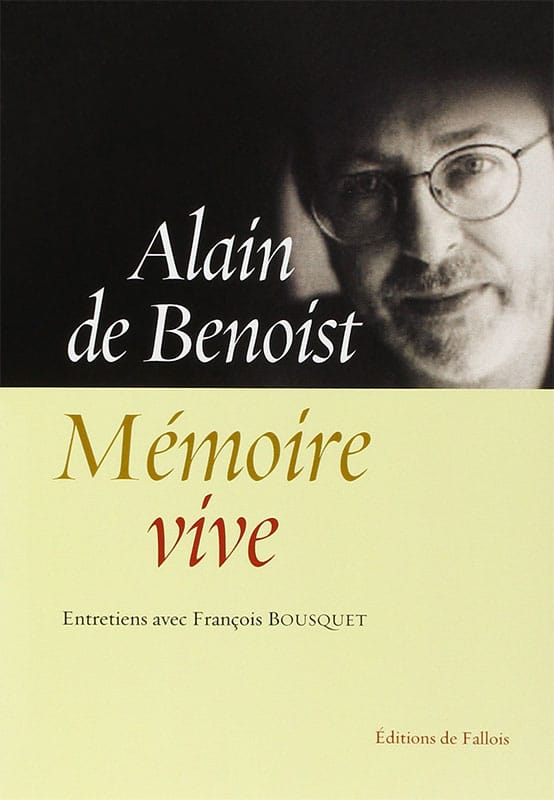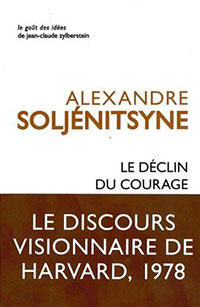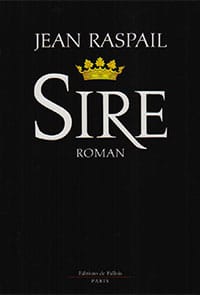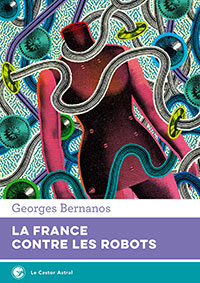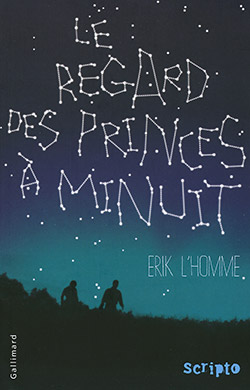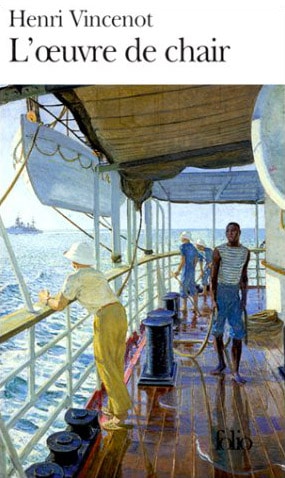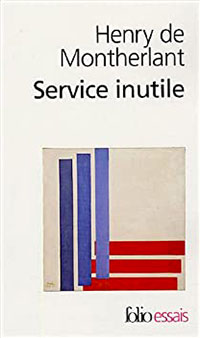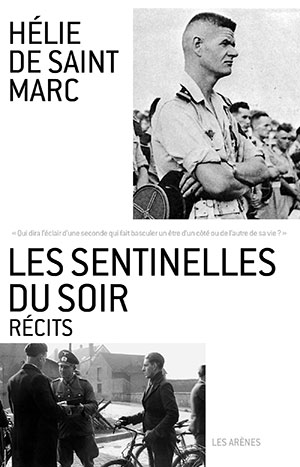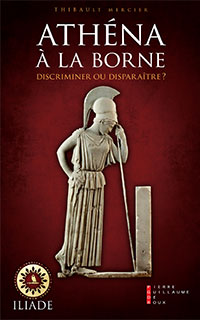« Au milieu d’un monde à la dérive, nous sommes seuls. Nous sommes tragiquement seuls. Nous n’avons rien à voir avec toutes les formules commodes qui permettent toujours d’entrer dans une des chapelles bien étiquetées de l’échiquier politique. Nous naviguons sur une mer inconnue et personne ne peut comprendre vers quels continents nous cinglons. Nous ne sommes à l’aise nulle part. Mais si chaque parti nous est étranger, chaque militant reste notre frère. Un véritable activiste refuse toutes les formations de l’heure mais il accepte tous les hommes de courage. Et c’est pourquoi nous sommes joyeusement seuls.
C’est justement parce que nous refusons toutes les compromissions et toutes les manœuvres que nous serons le plus pur métal de l’alliage de demain. »
Jean Mabire
La torche et le glaive, éditions Libres opinions, 1994