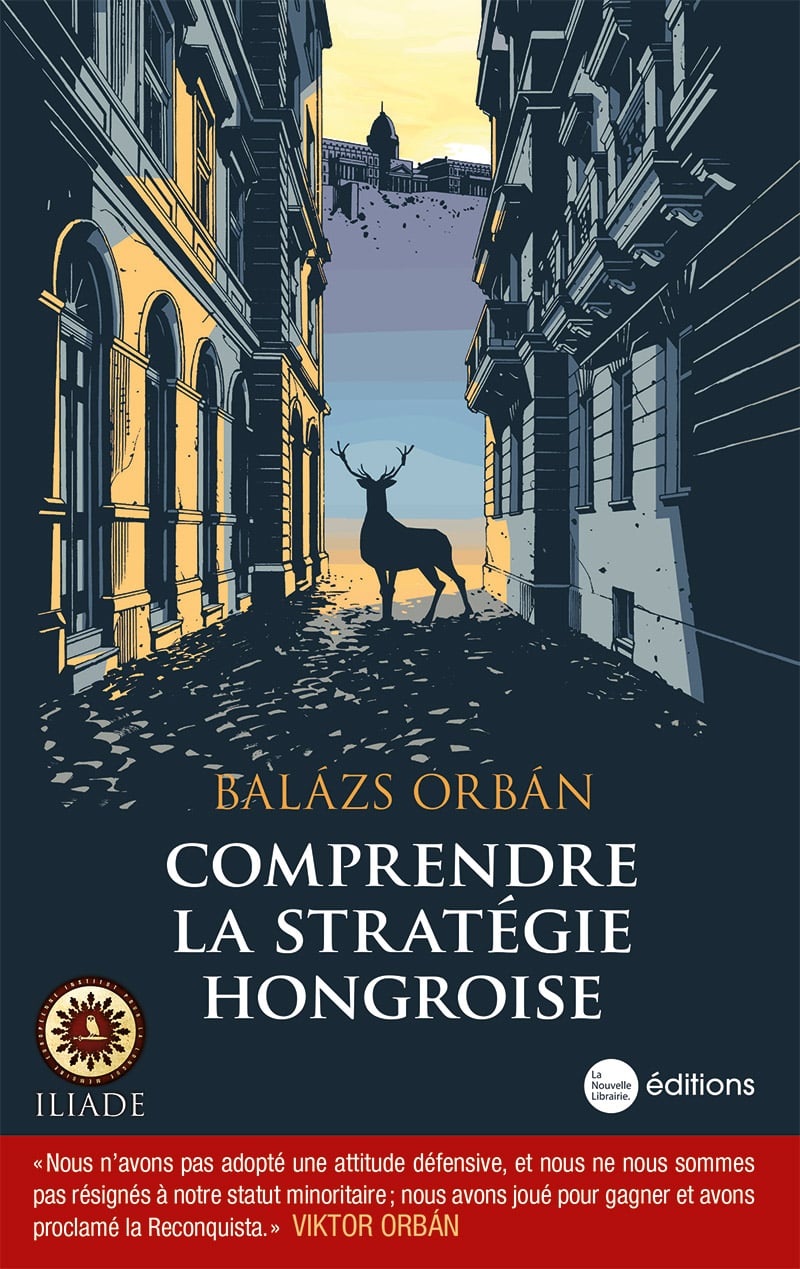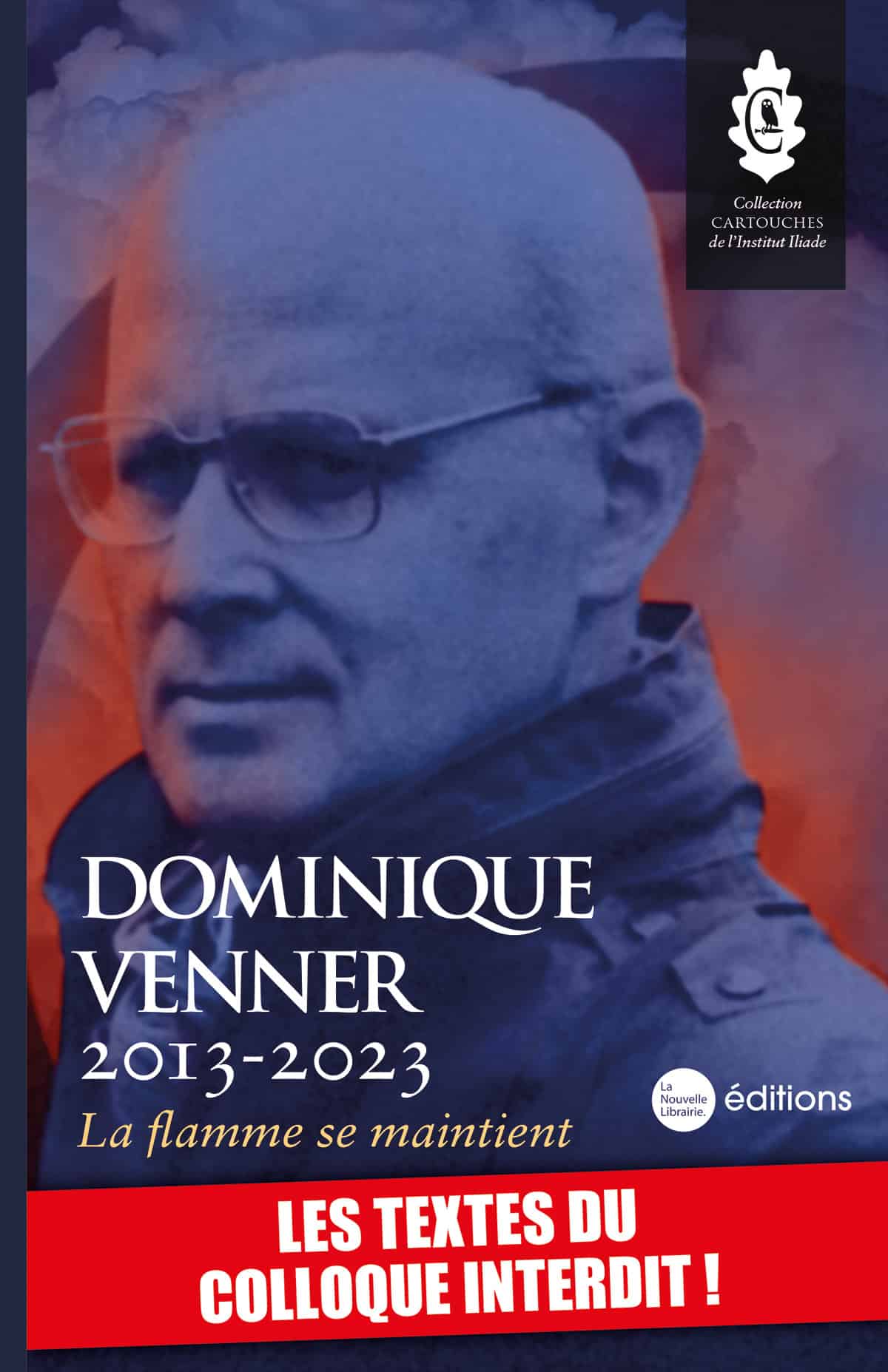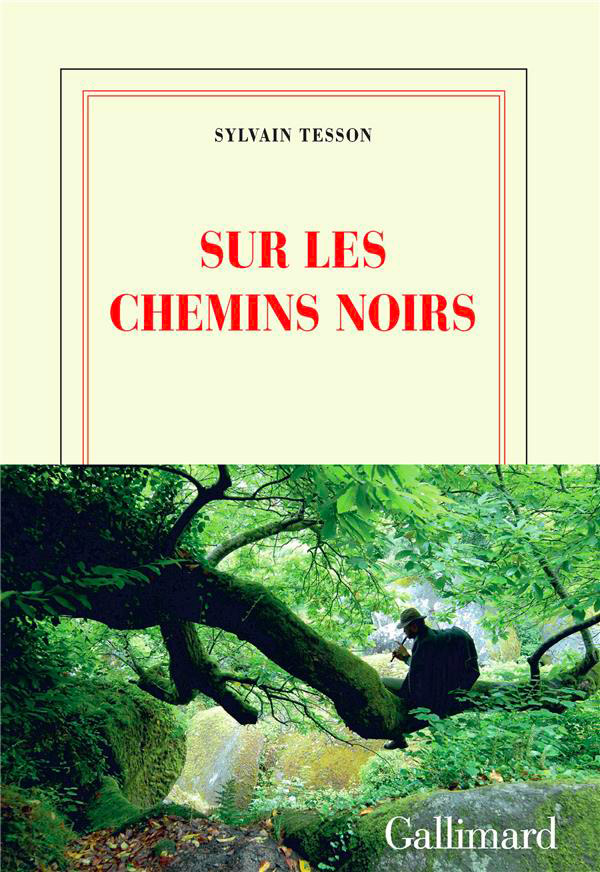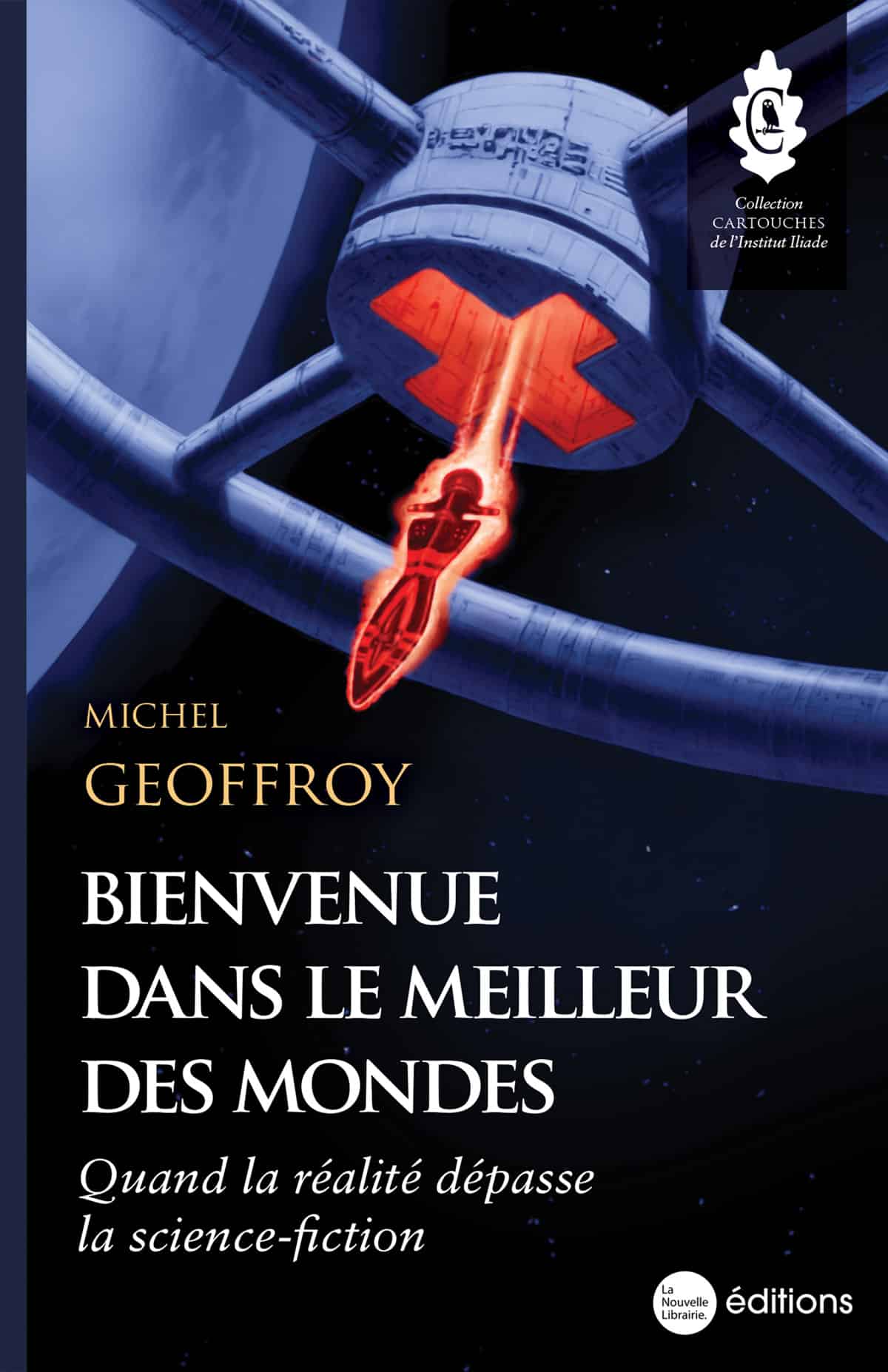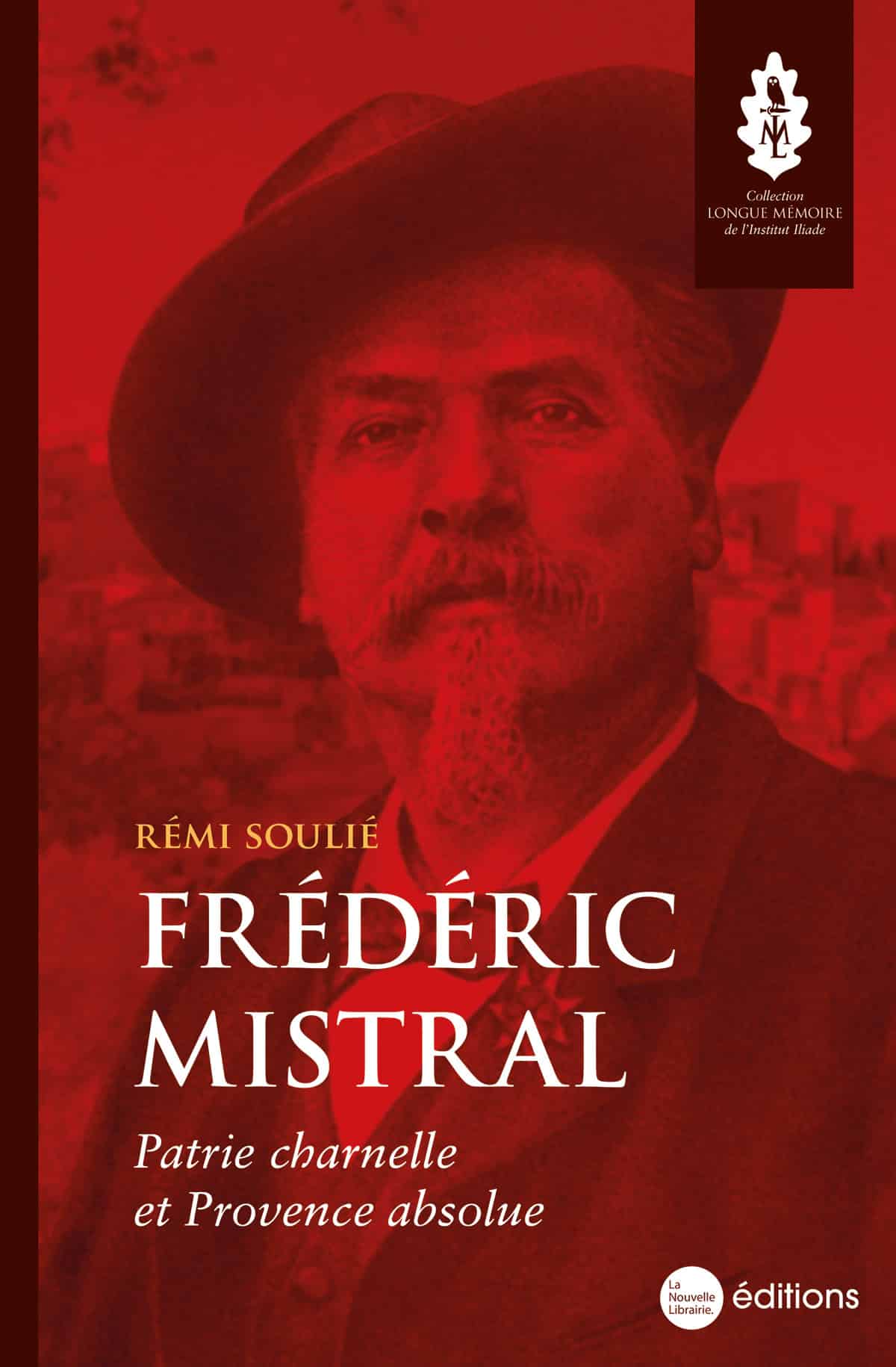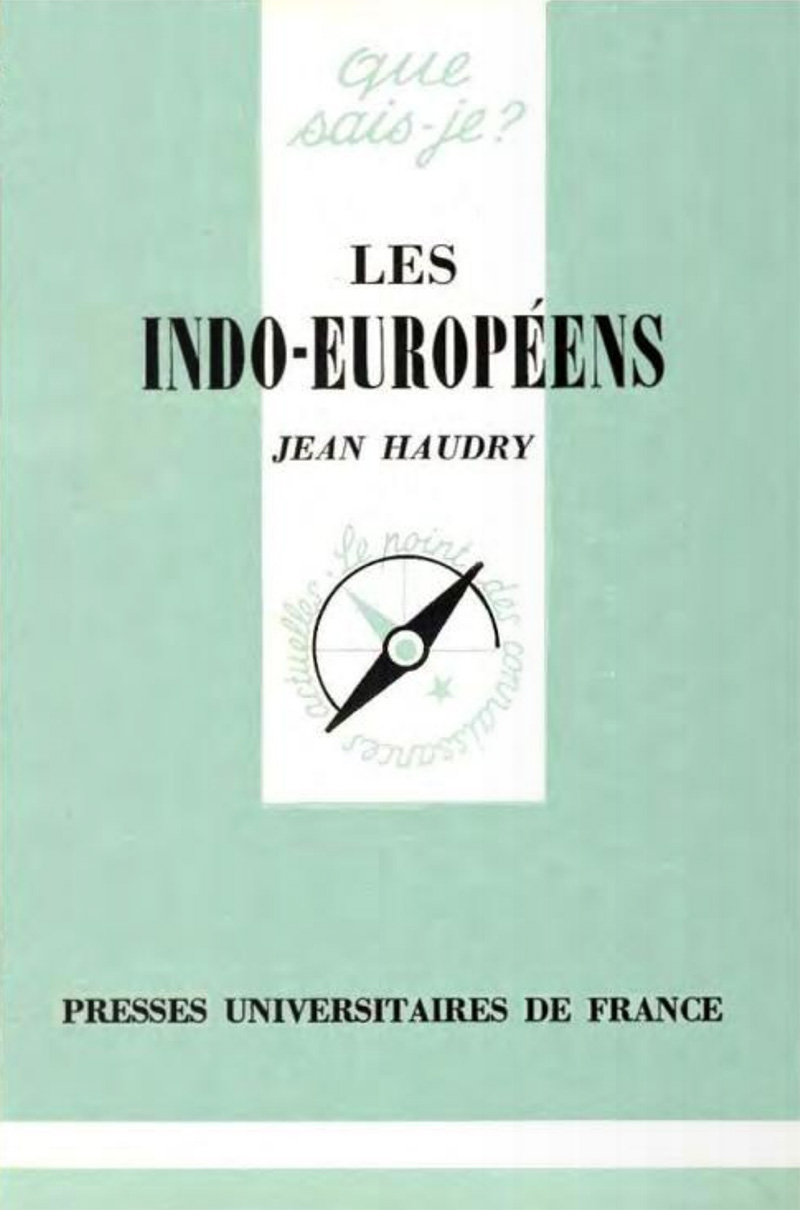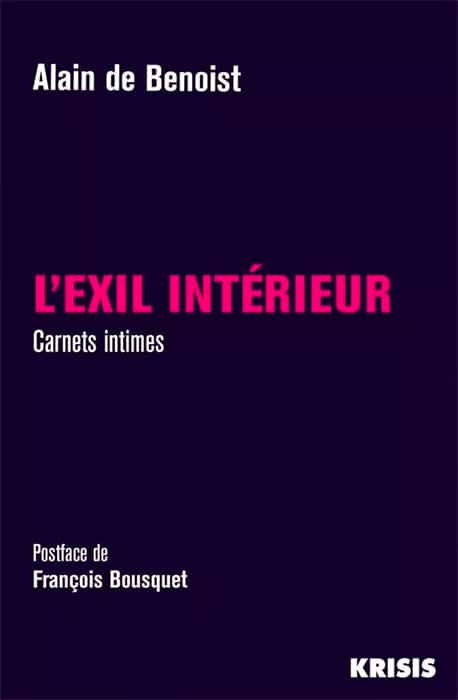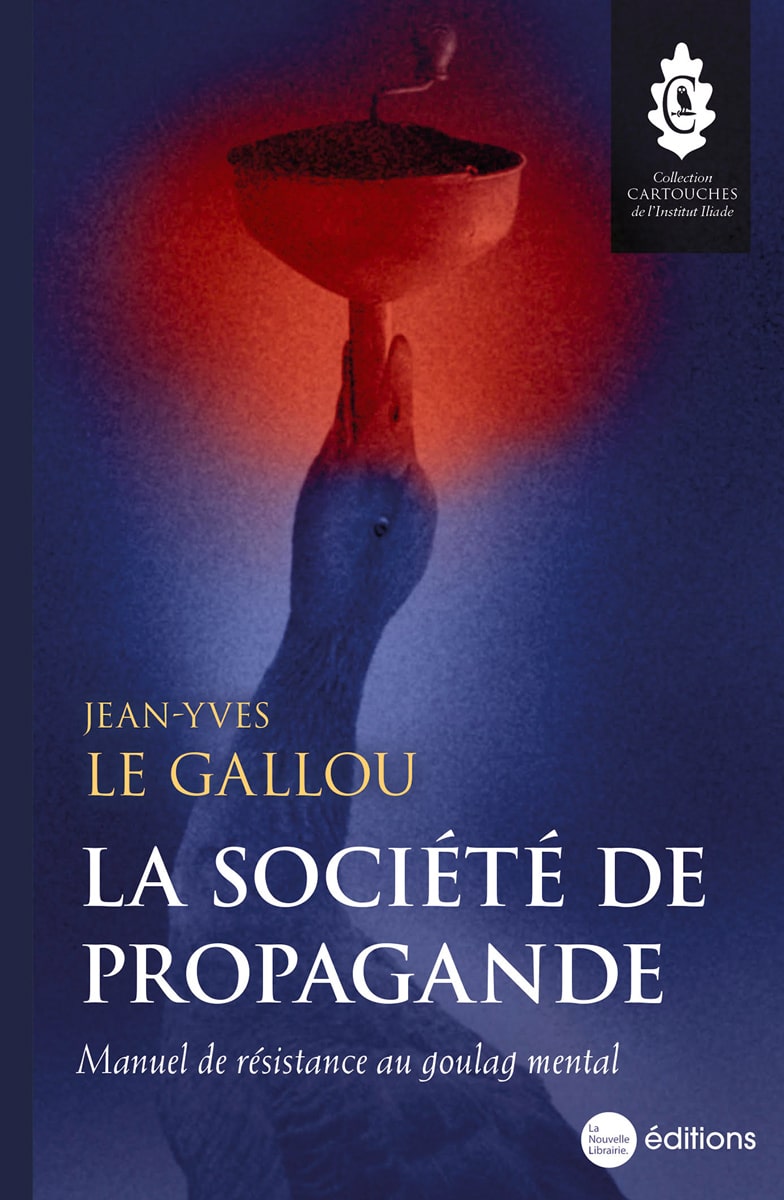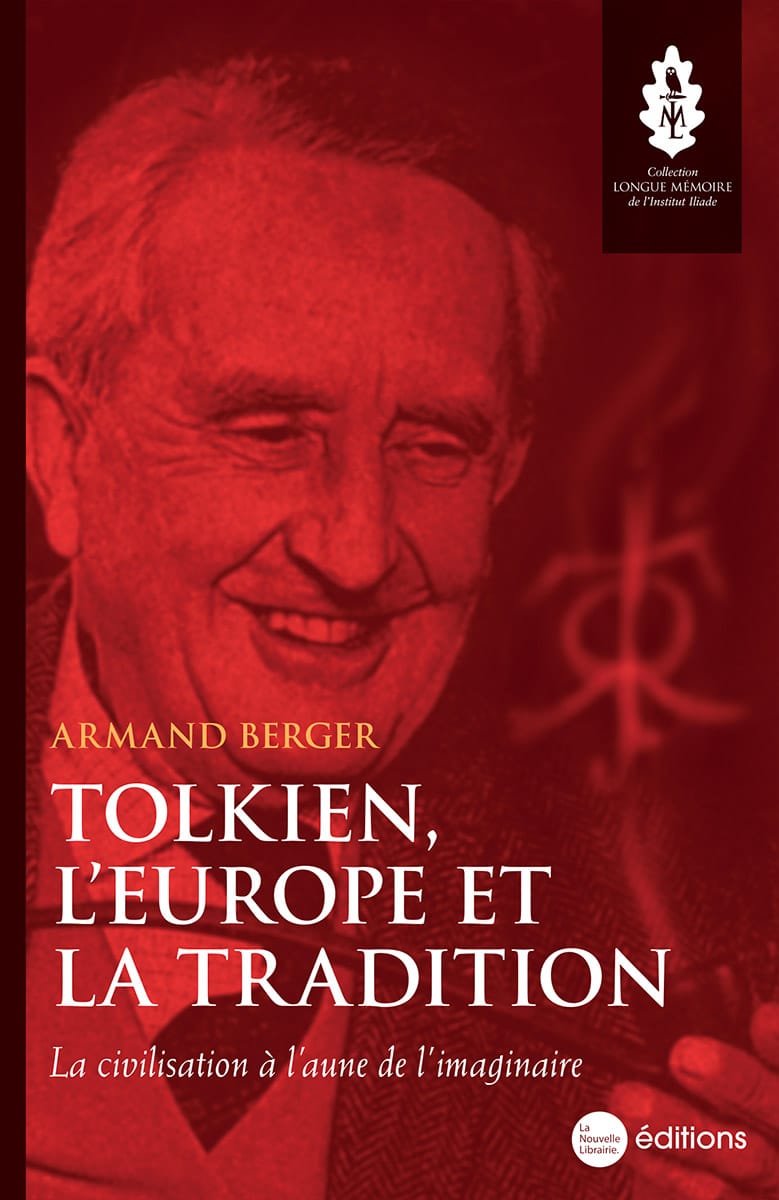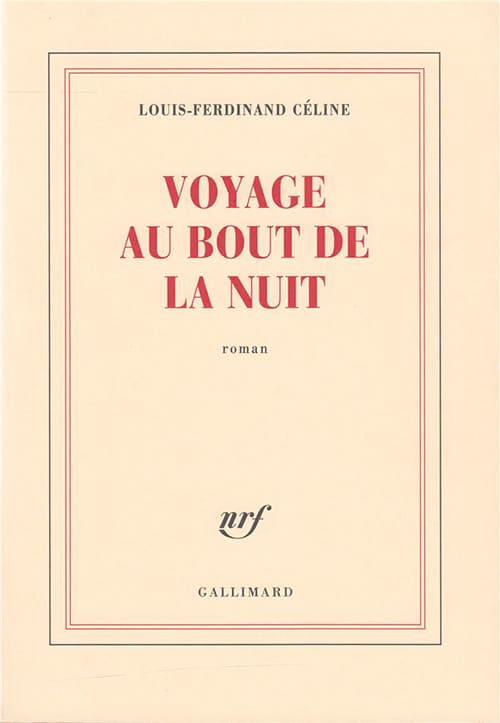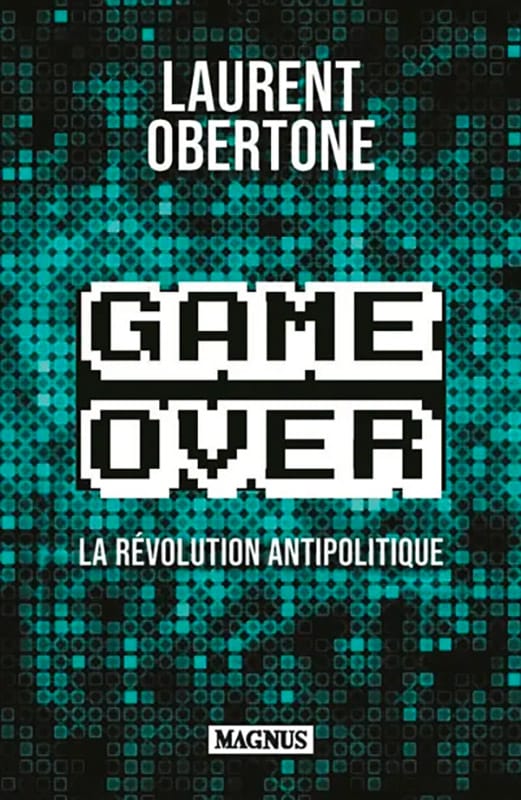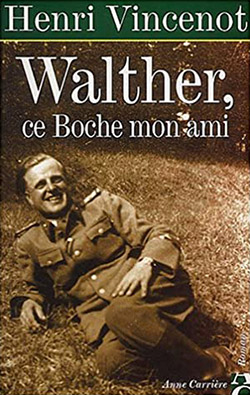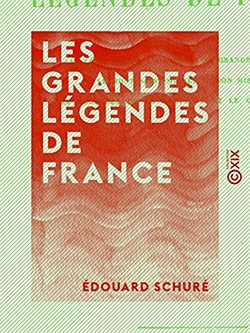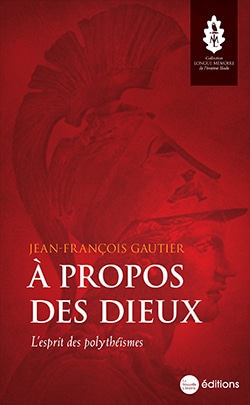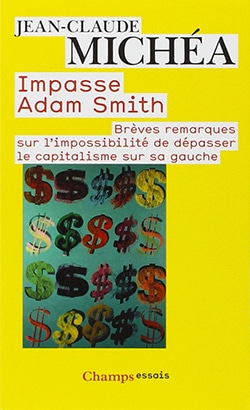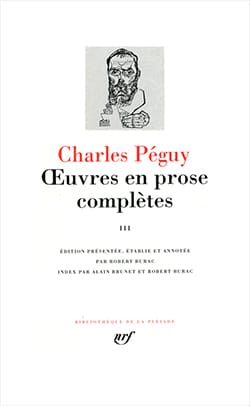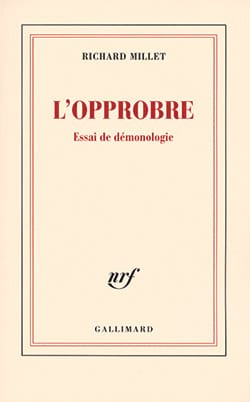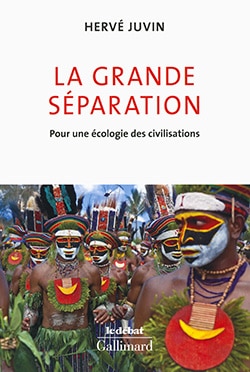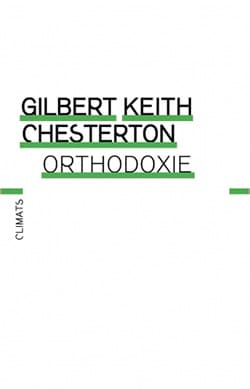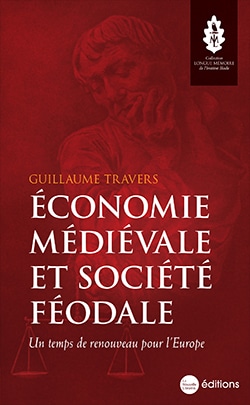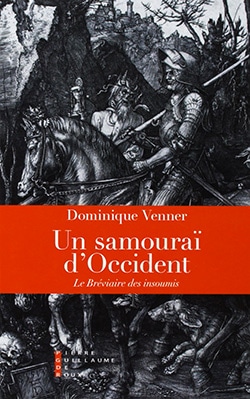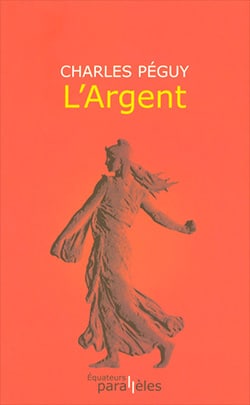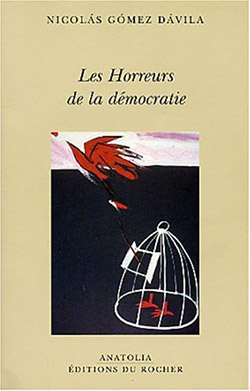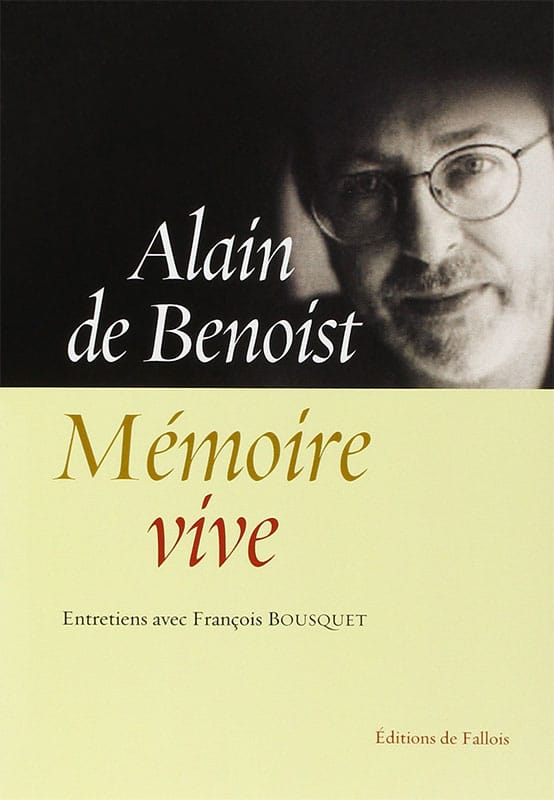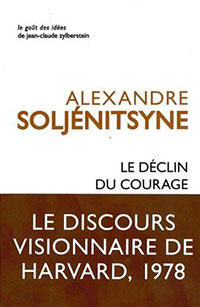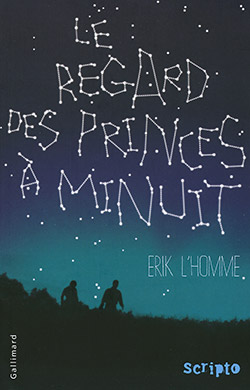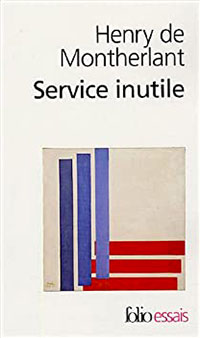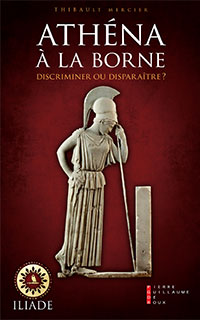« Ce n’est pas dans le premier moment d’une émotion très vive que l’on jouit le plus de ses sentiments. Je m’avançais vers Athènes avec une espèce de plaisir qui m’ôtait le pouvoir de la réflexion ; non que j’éprouvasse quelque chose de semblable à ce que j’avais senti à la vue de Lacédémone. Sparte et Athènes ont conservé jusque dans leurs ruines leur différent caractère : celles de la première sont tristes, graves, solitaires, celle de la seconde sont riantes, légères, habitées. À l’aspect de la patrie de Lycurgue, toutes les pensées deviennent sérieuses, mâles et profondes ; l’âme fortifiée semble s’élever et s’agrandir. Devant la ville de Solon, on est comme enchanté par les prestiges du génie ; on a l’idée de l’homme considéré comme un être intelligent et immortel. Les sentiments de la nature humaine prenaient à Athènes quelque chose d’élégant qu’ils n’avaient point à Sparte. L’amour de la patrie et de la liberté n’étaient point pour les Athéniens un instinct aveugle mais un sentiment éclairé, fondé sur ce goût du beau dans tous les genres que le ciel leur avait si libéralement départi ; enfin, en passant des ruines de Sparte aux ruines d’Athènes je sentis que j’aurais voulu mourir avec Léonidas et vivre avec Périclès. »
François-René de Chateaubriand
Itinéraires de Paris à Jérusalem, en passant par la Grèce, et en revenant par l’Égypte, la Barbarie et l’Espagne, 1811, éditions Gallimard, coll. Folio classique, 2005