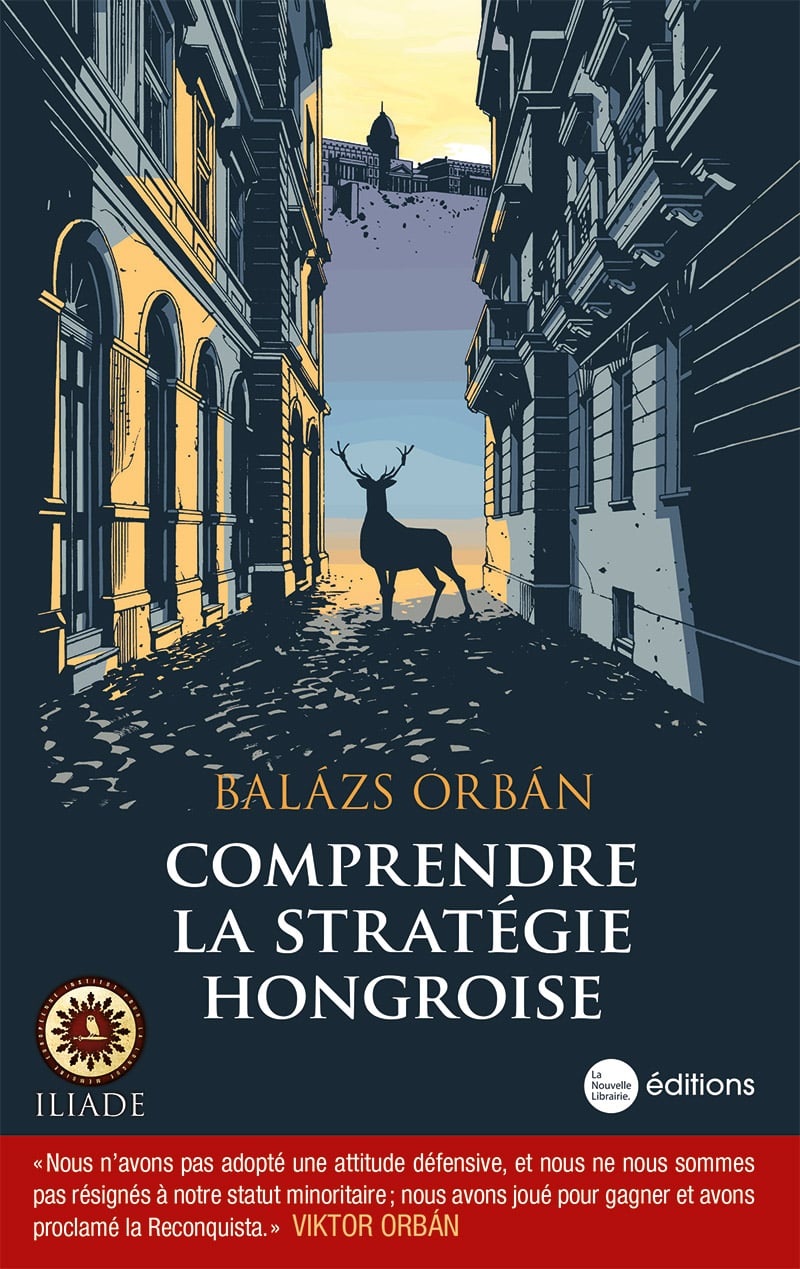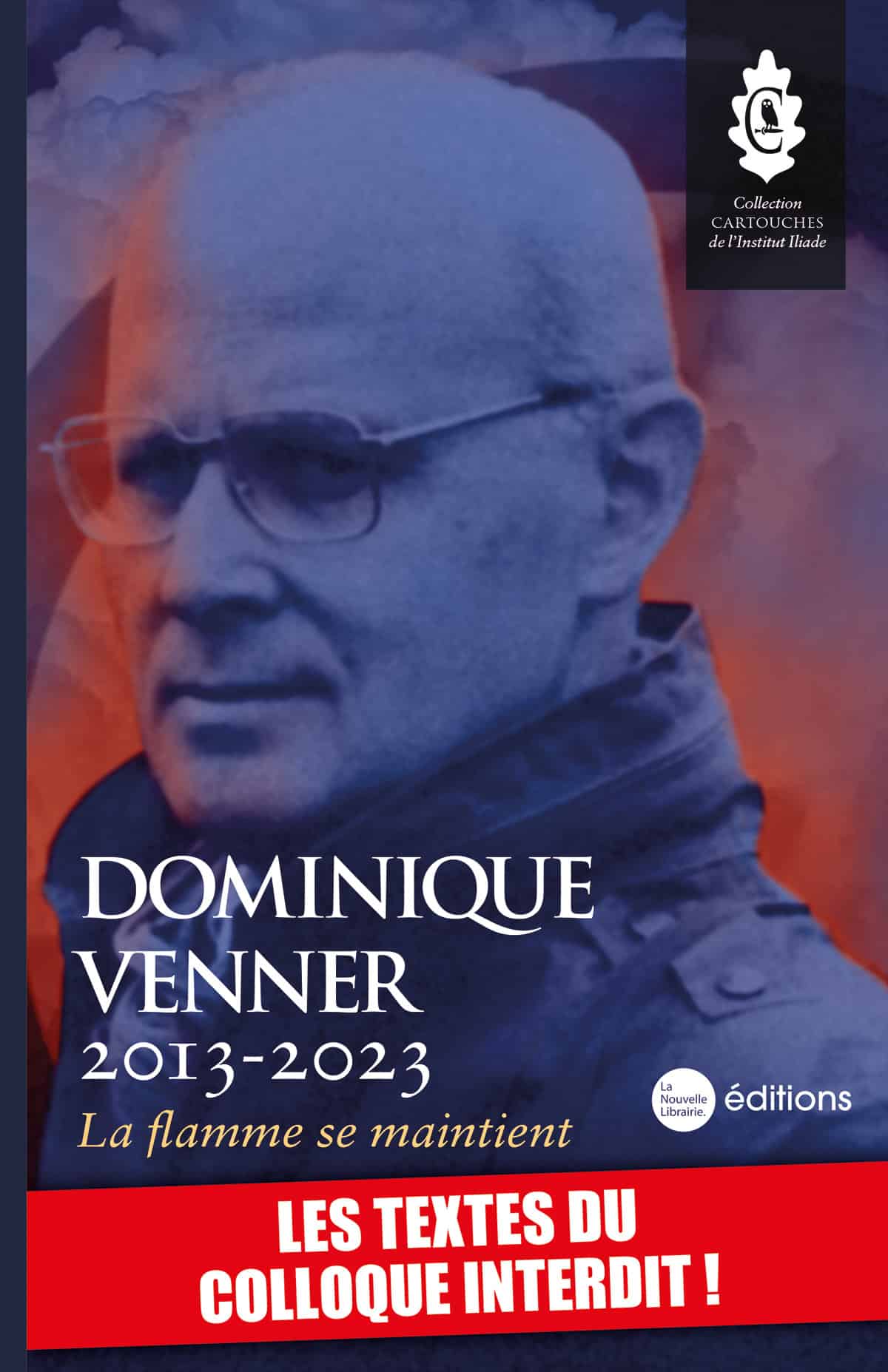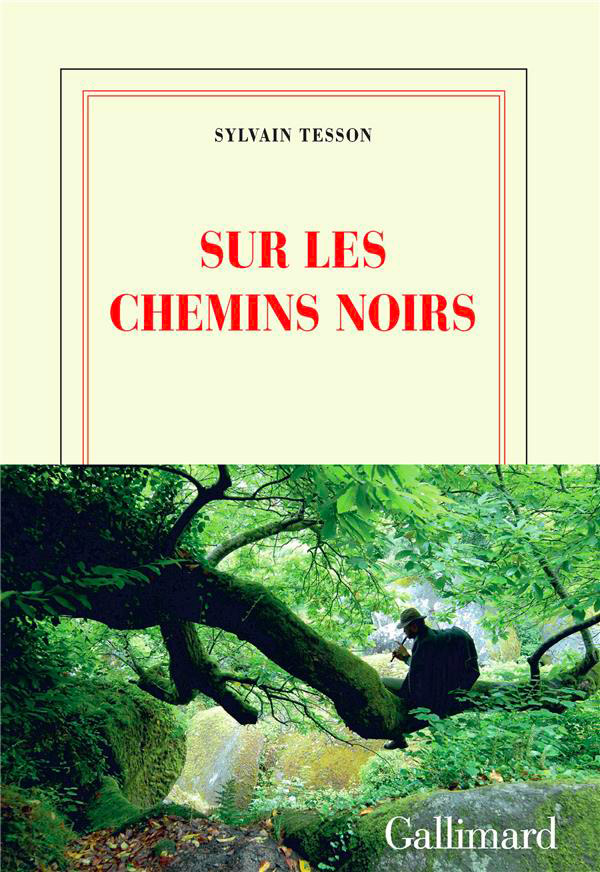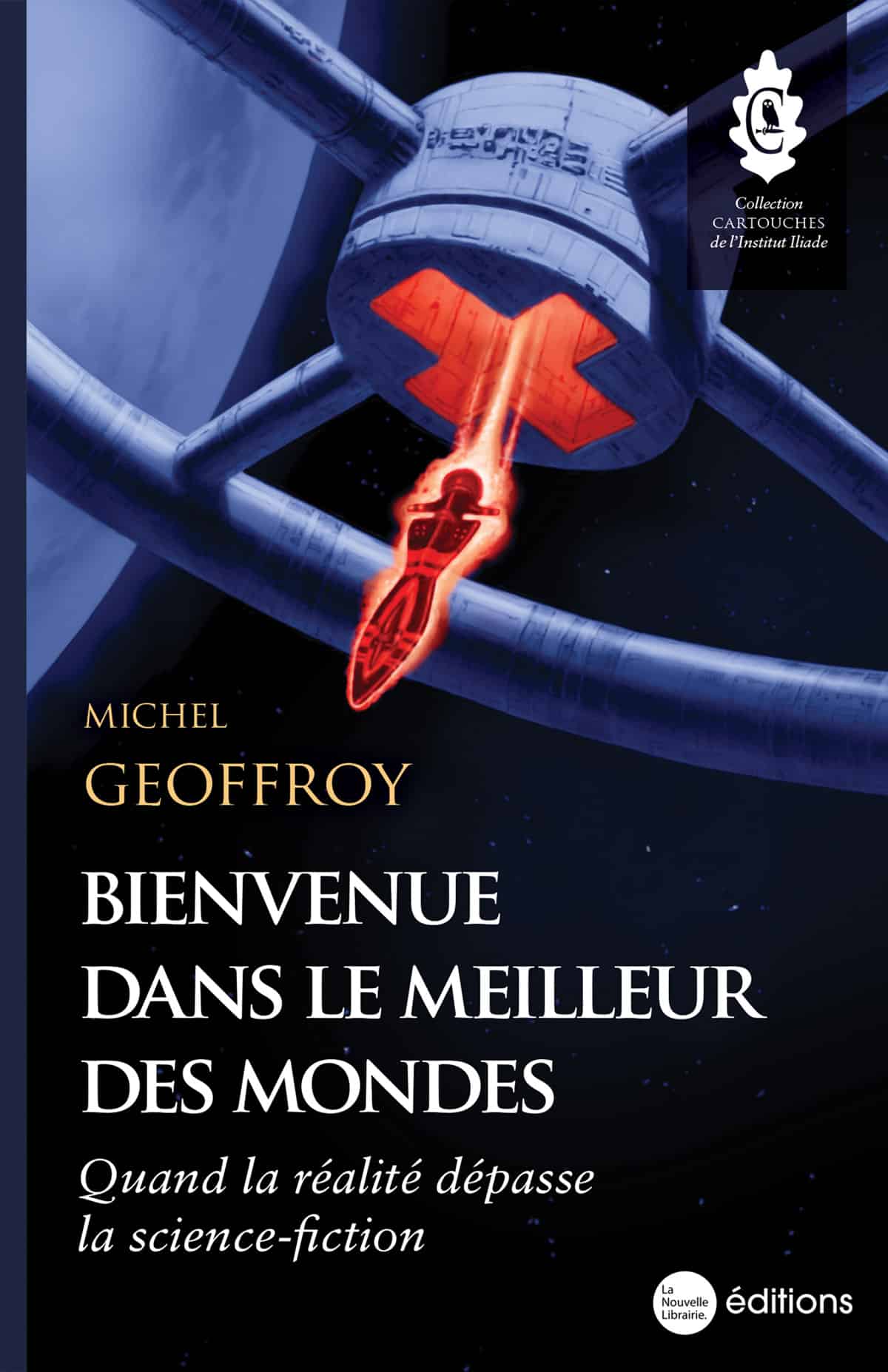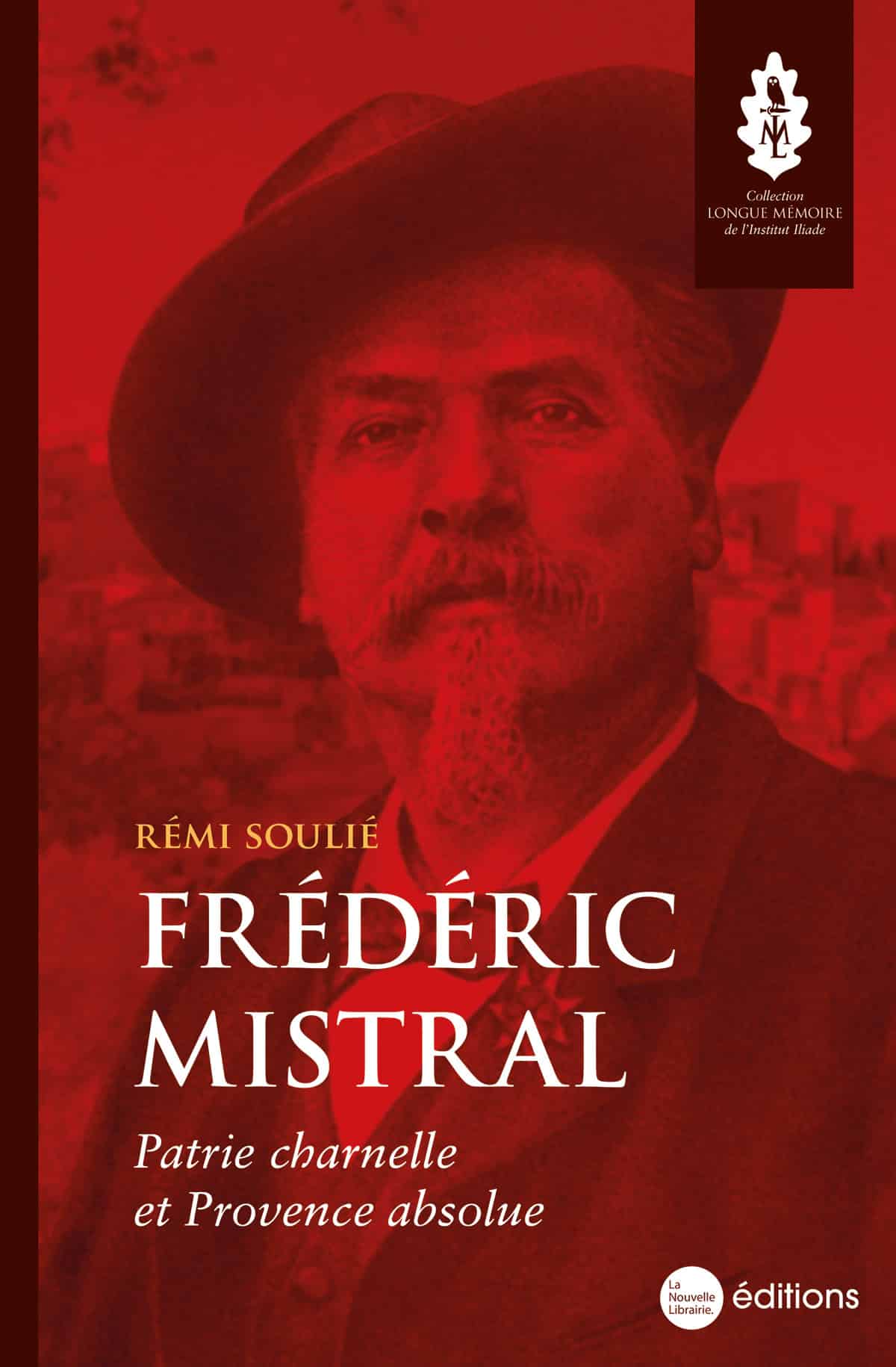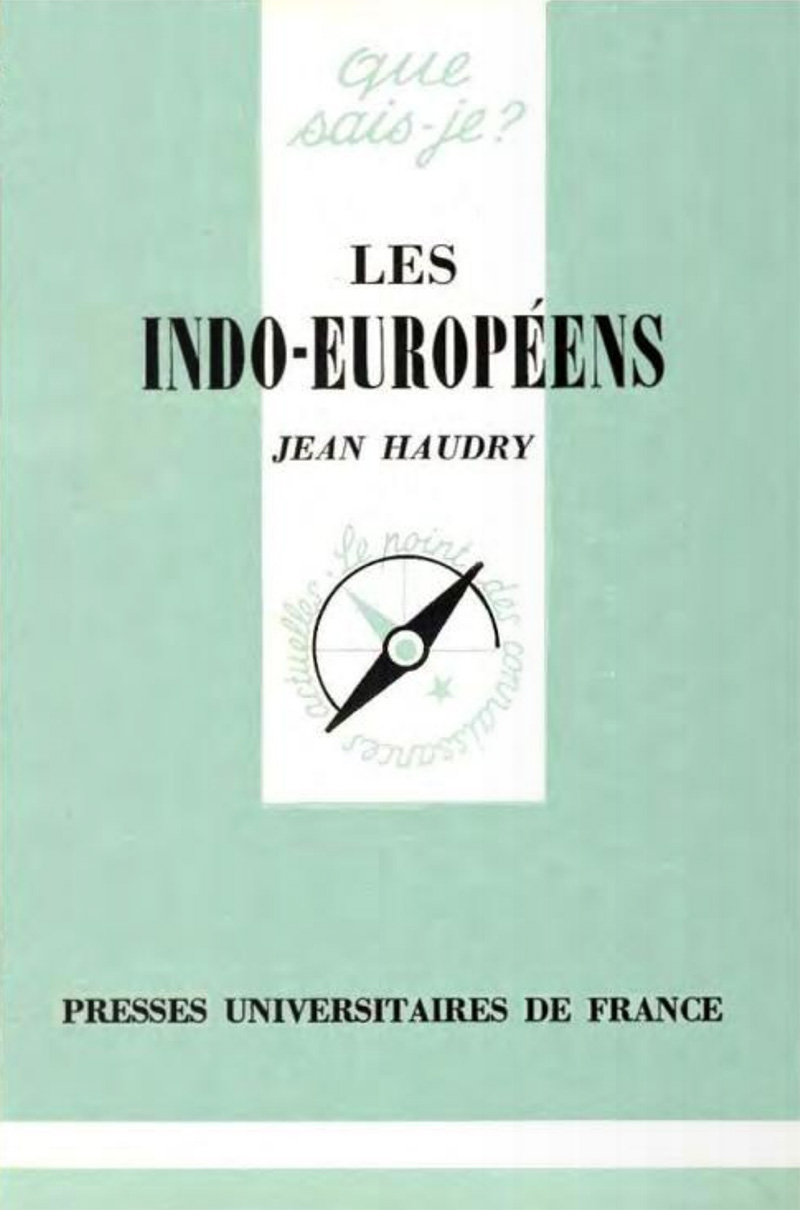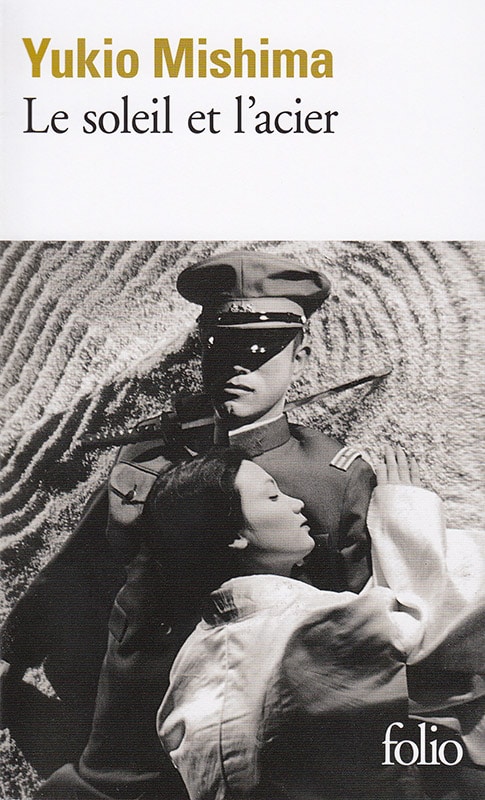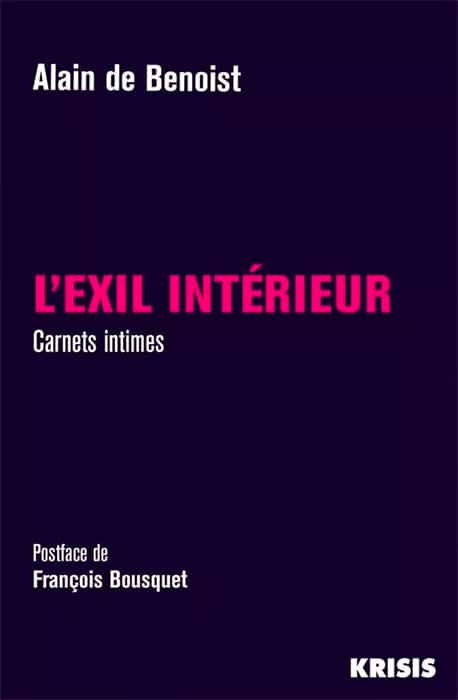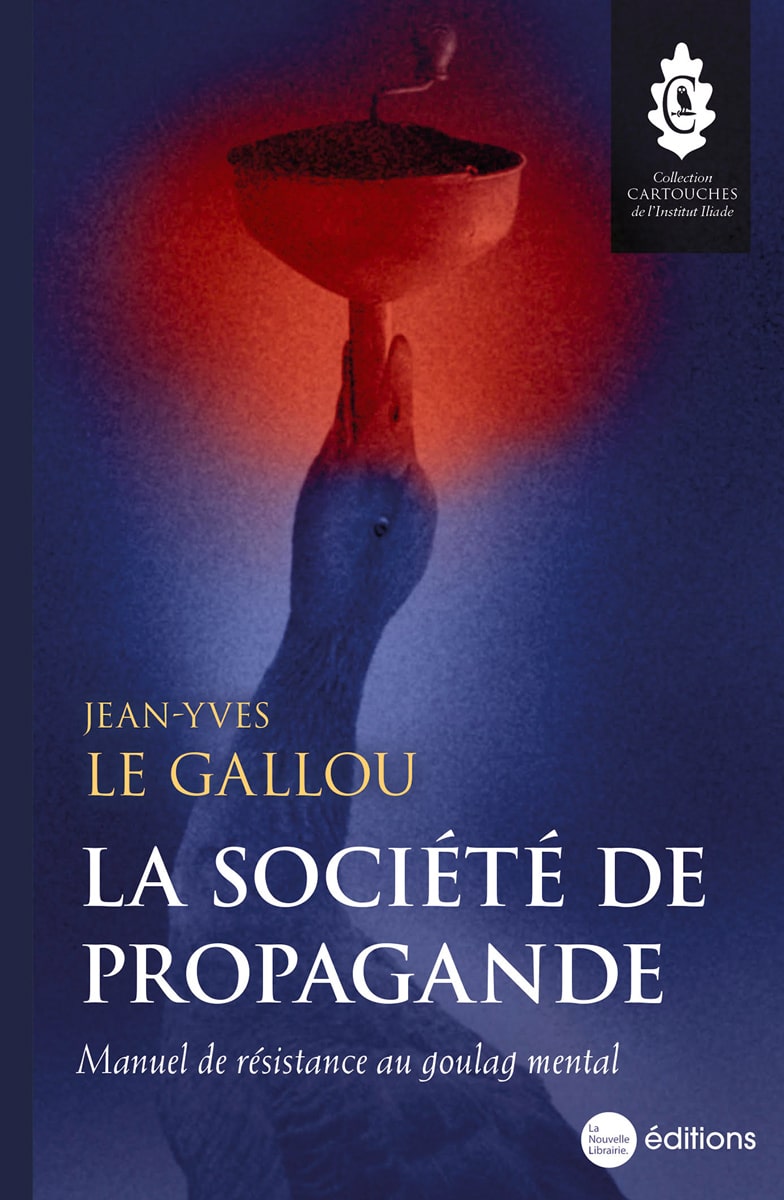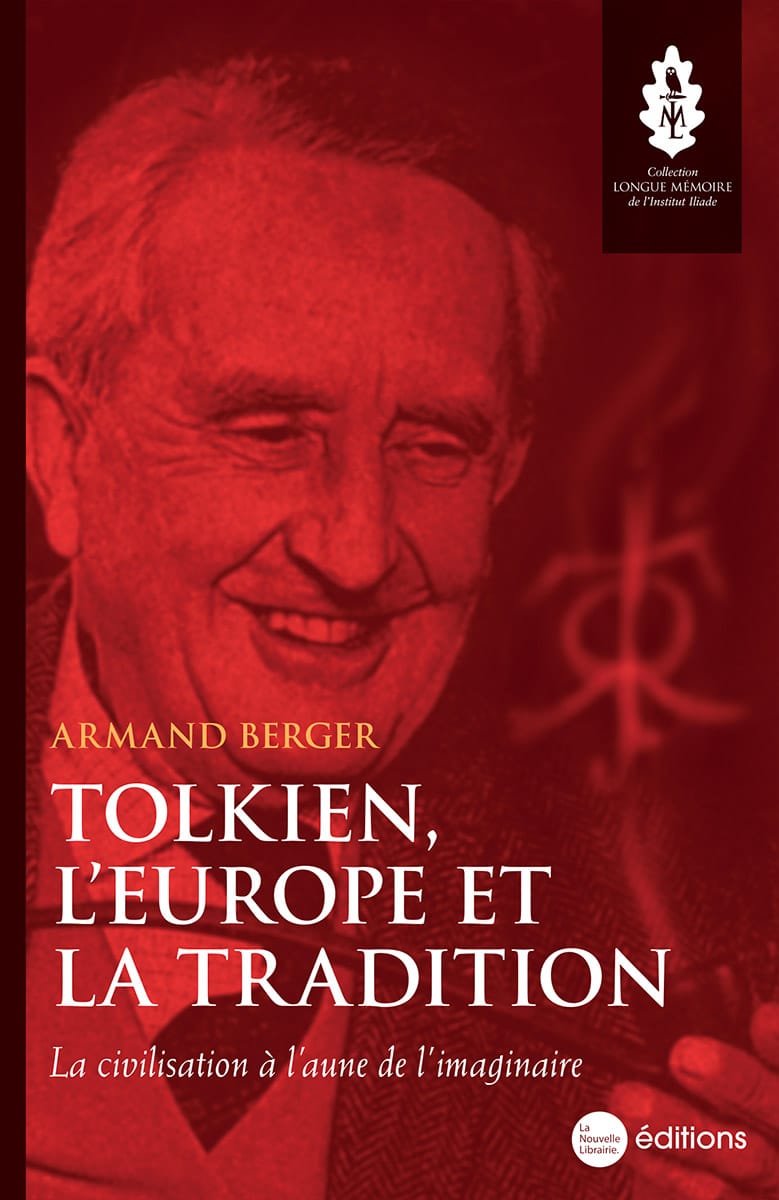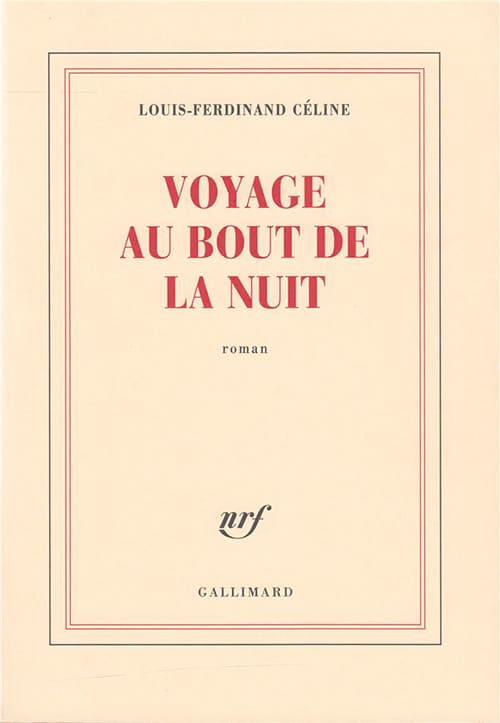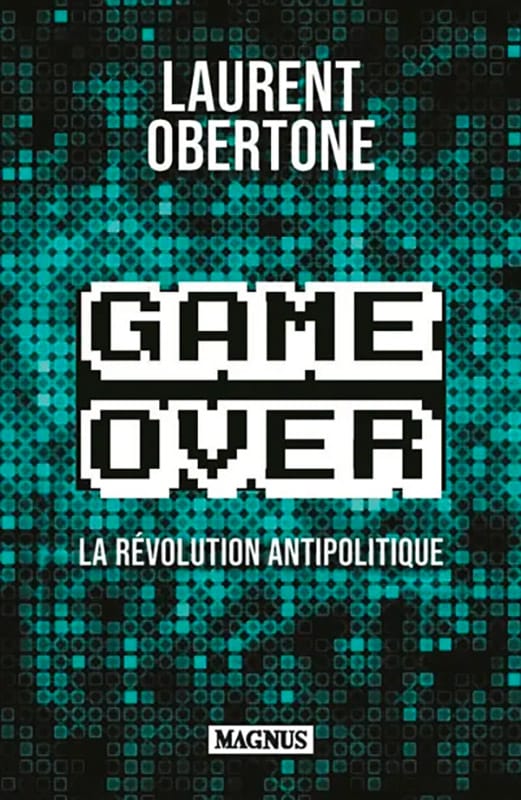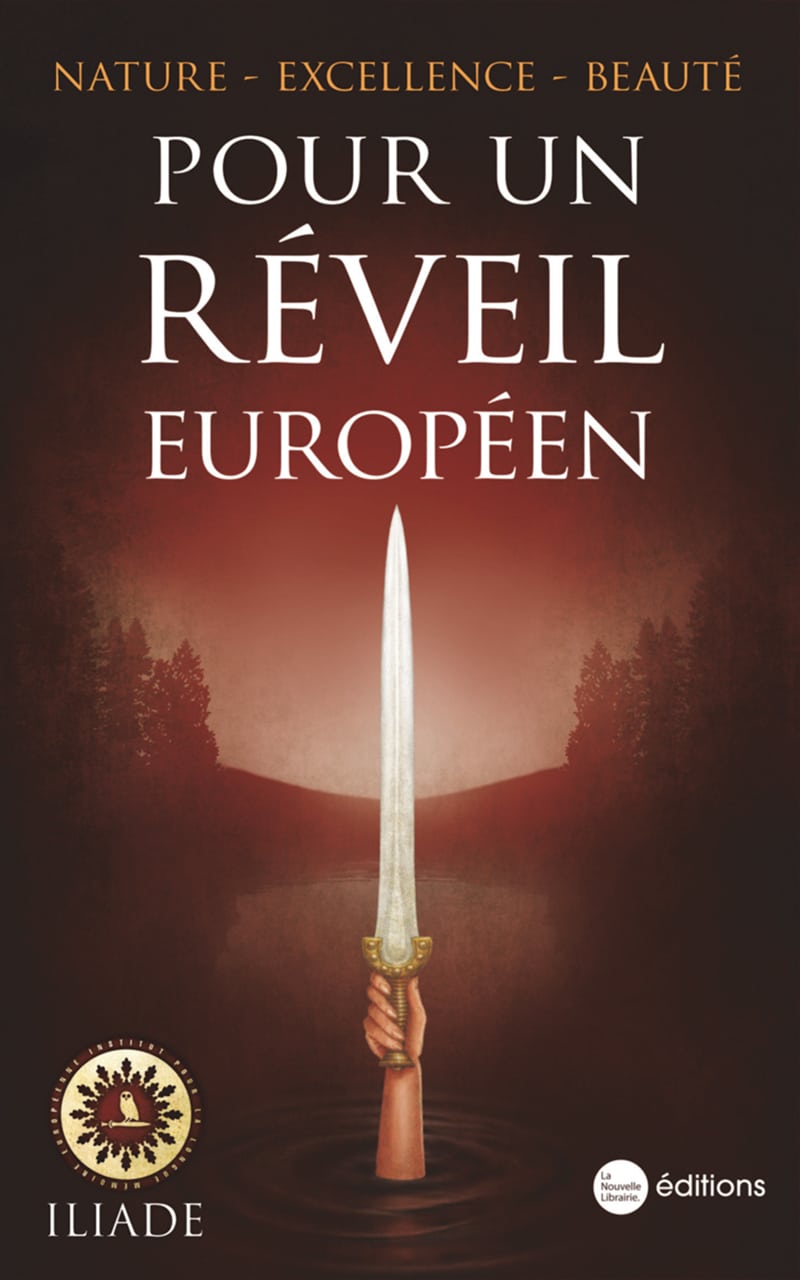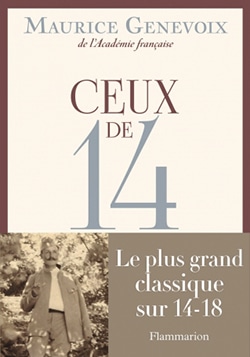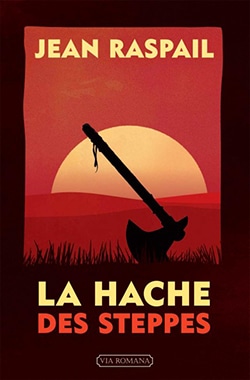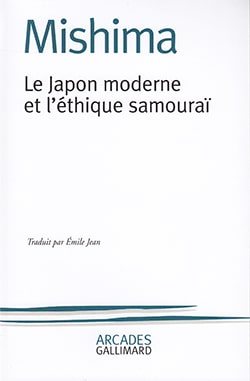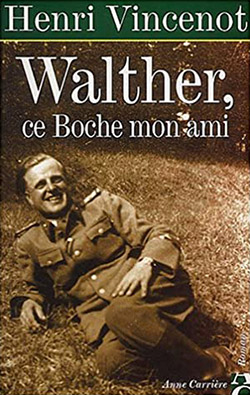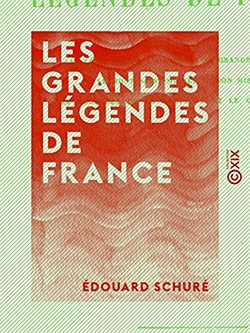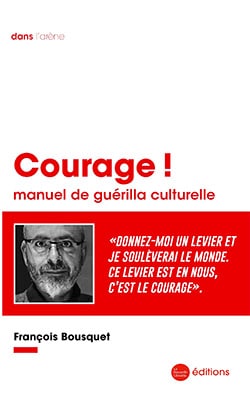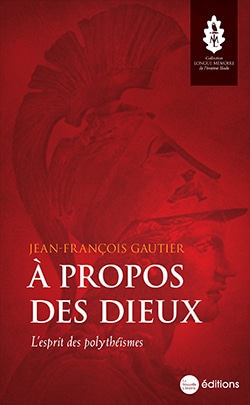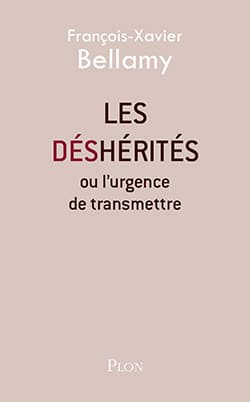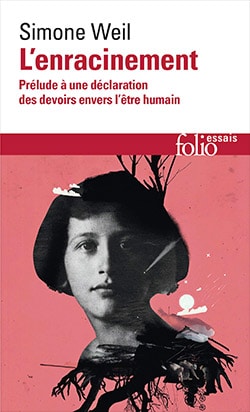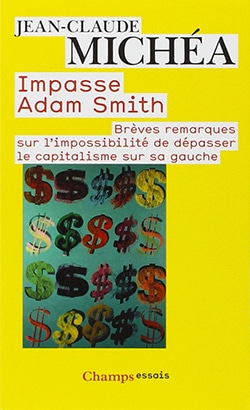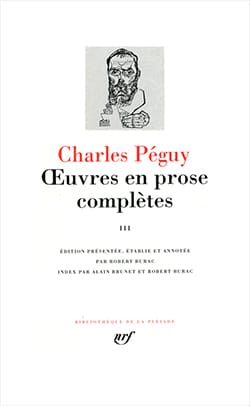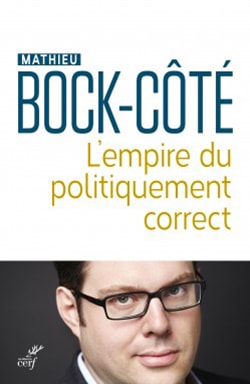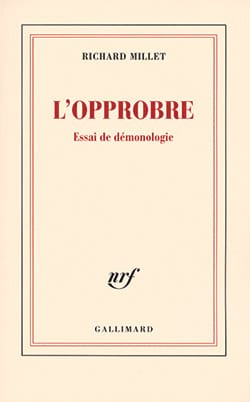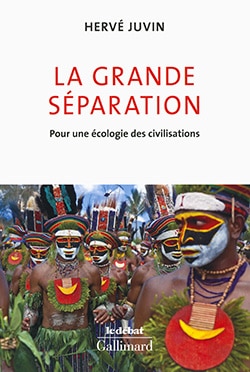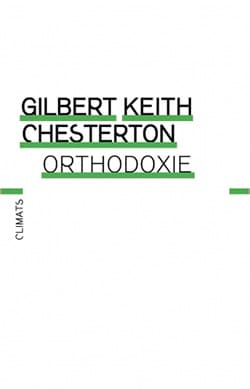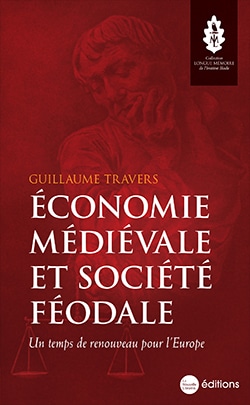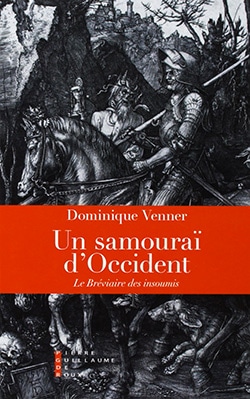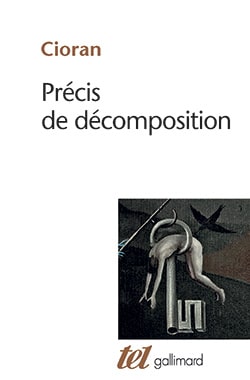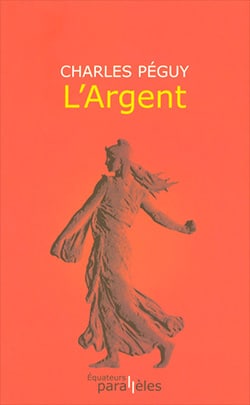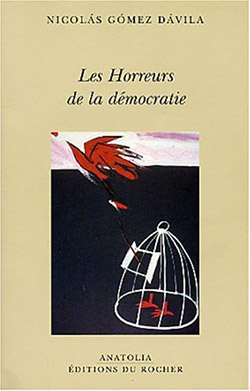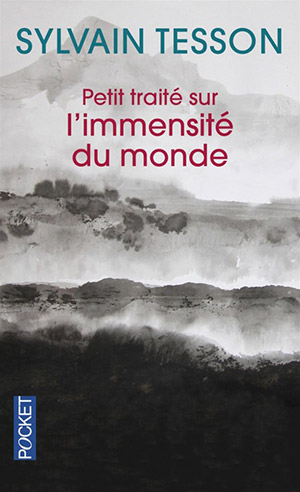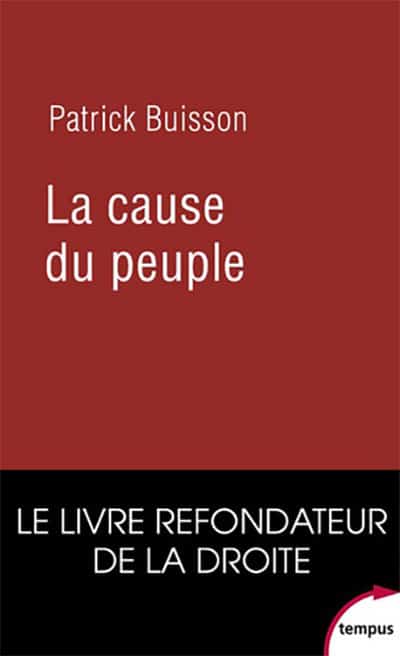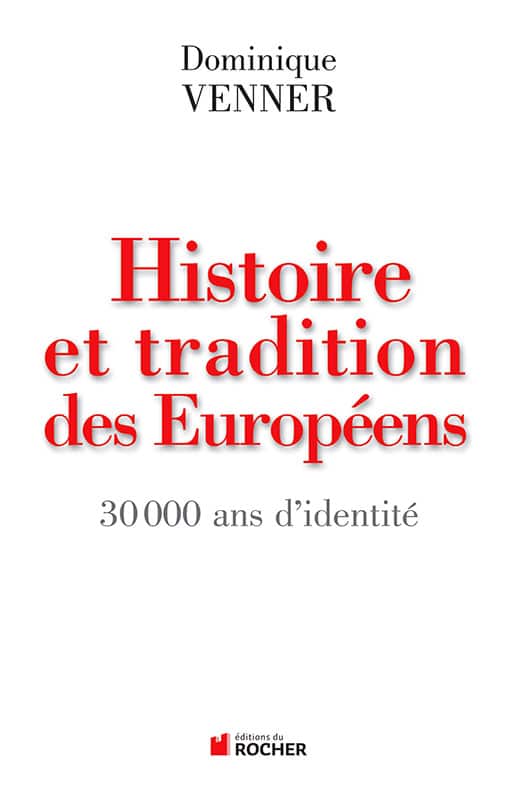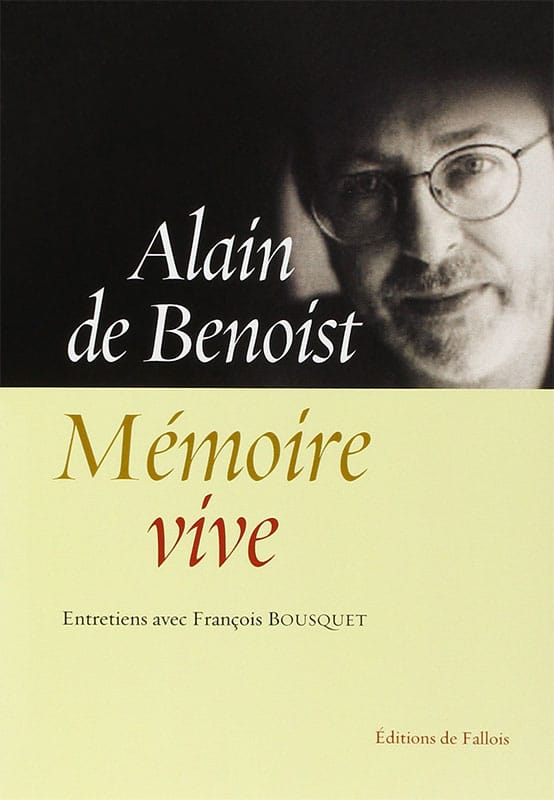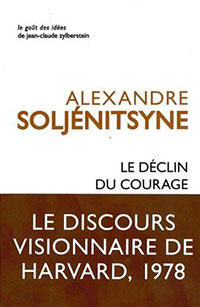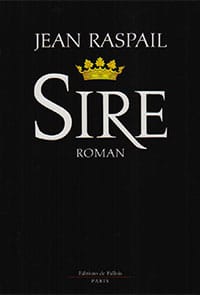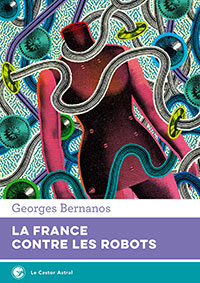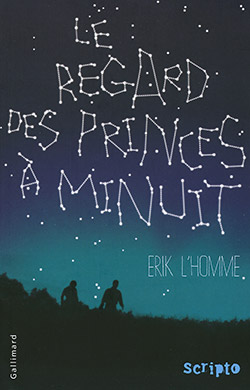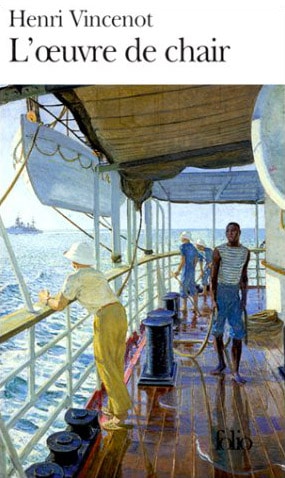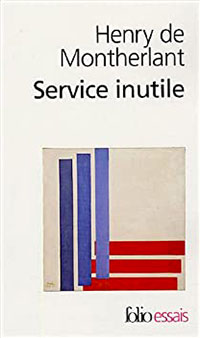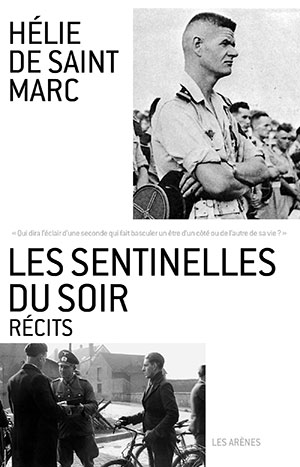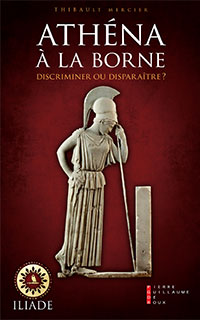« Toute terre, en vérité, est un ensemble où la nature et l’histoire collaborent. Le spectateur d’un paysage est aussi l’héritier d’un passé. Des hommes avant lui ont œuvré pour que tel endroit soit ce qu’il est. Il y a toujours à respecter, à maintenir, à poursuivre et, s’il le faut, à défendre. Quand Barrès écrivait sur Sion et Sainte-Odile, il songeait surtout à l’héritage politique et historique : maintenir la présence française face à l’Allemagne, respecter la romanité comme créatrice de civilisation. Il ne pouvait encore s’agir pour lui de veiller à la préservation d’un héritage naturel qui n’était pas encore menacé. L’écologie est dans cette logique : défendre une nature dont on a hérité et qui a apporté ses preuves et donné ses bénéfices, une nature dont on est redevable. Défendre en somme le capital naturel comme on défend le patrimoine historique et culturel et comme on maintient vivante la mémoire historique. À ce rapport-là à la terre, à cette écologie, Barrès n’aurait pas été étranger de nos jours. »
Yves Chiron
Barrès et la terre, éditions Sang de la terre, Paris 1987