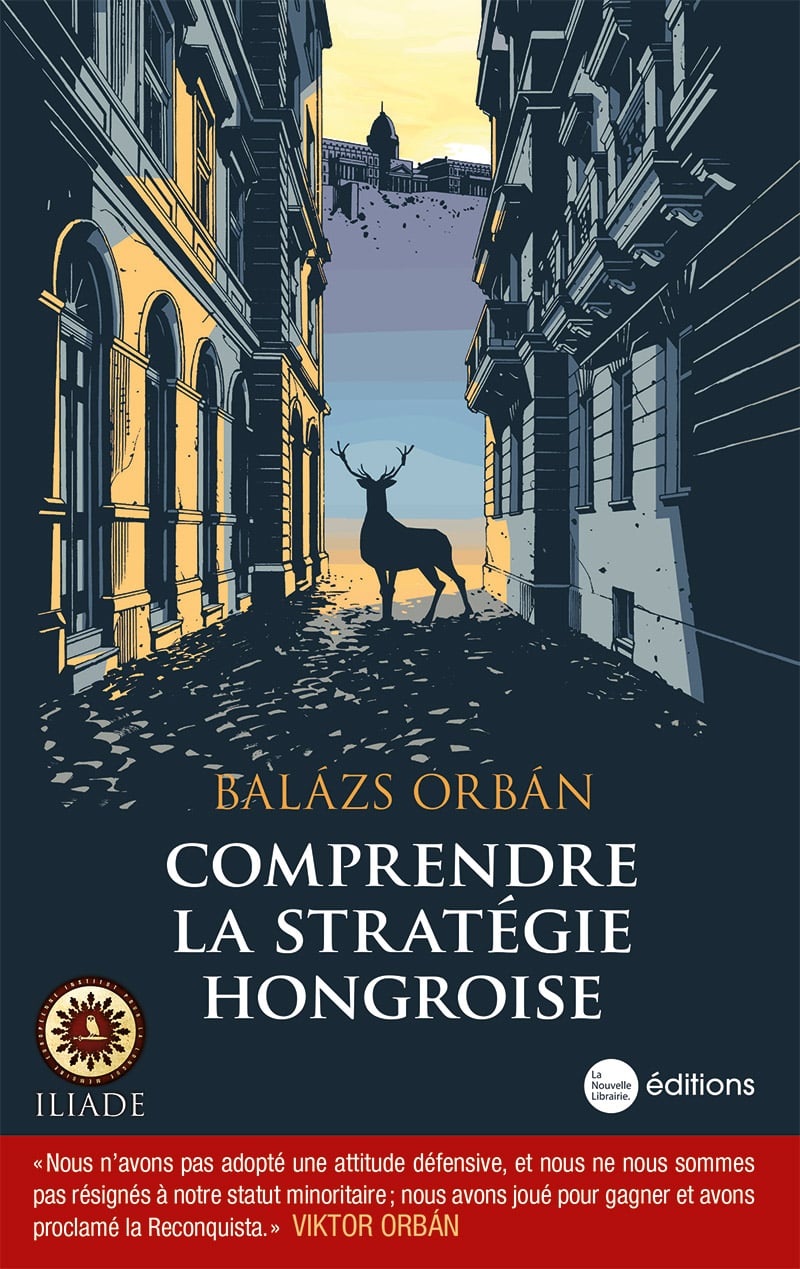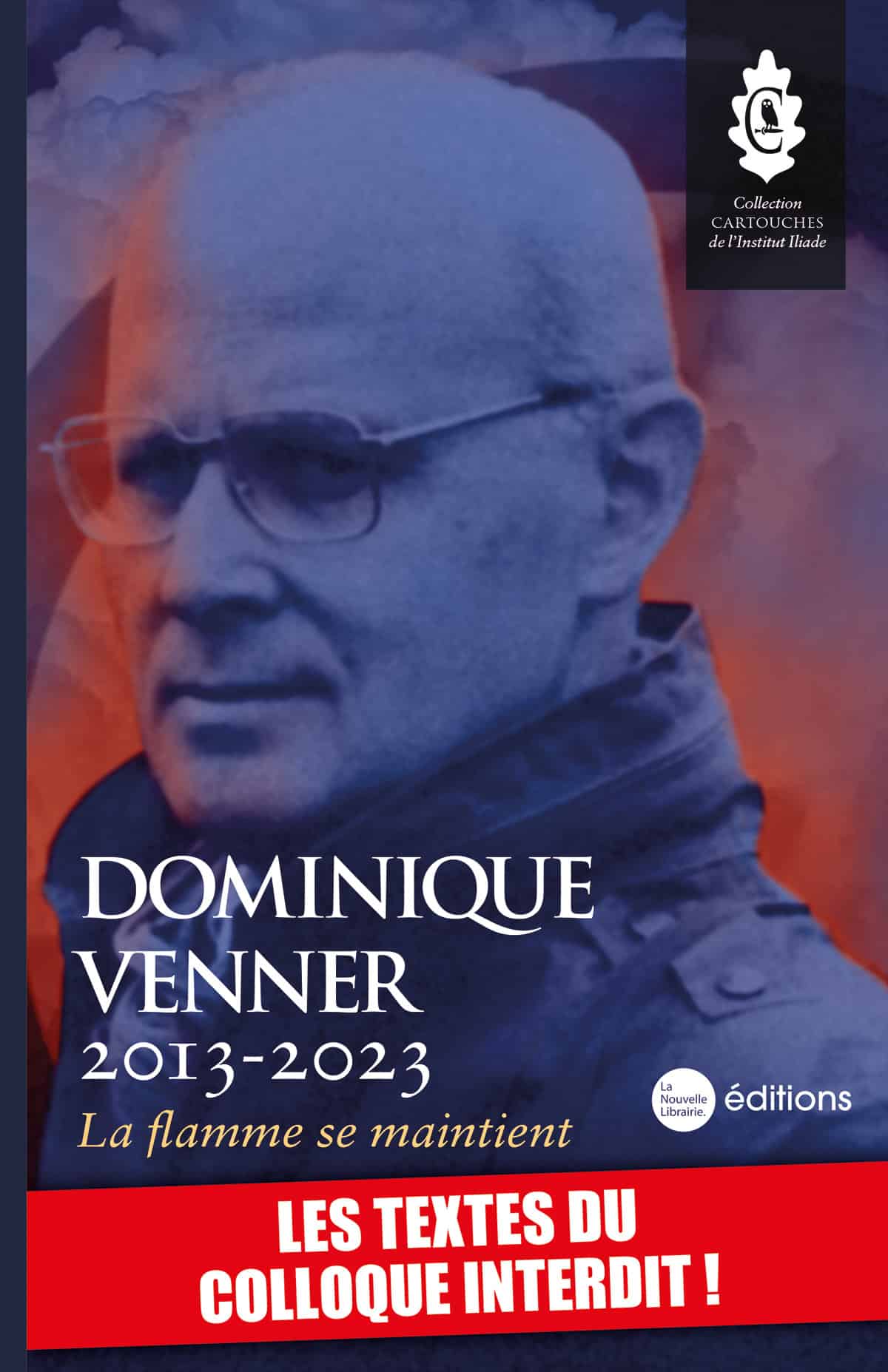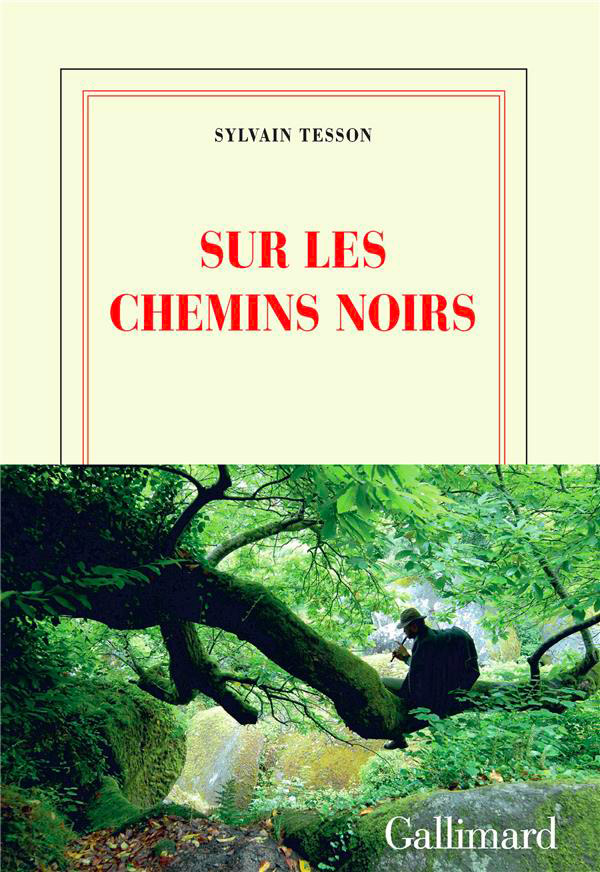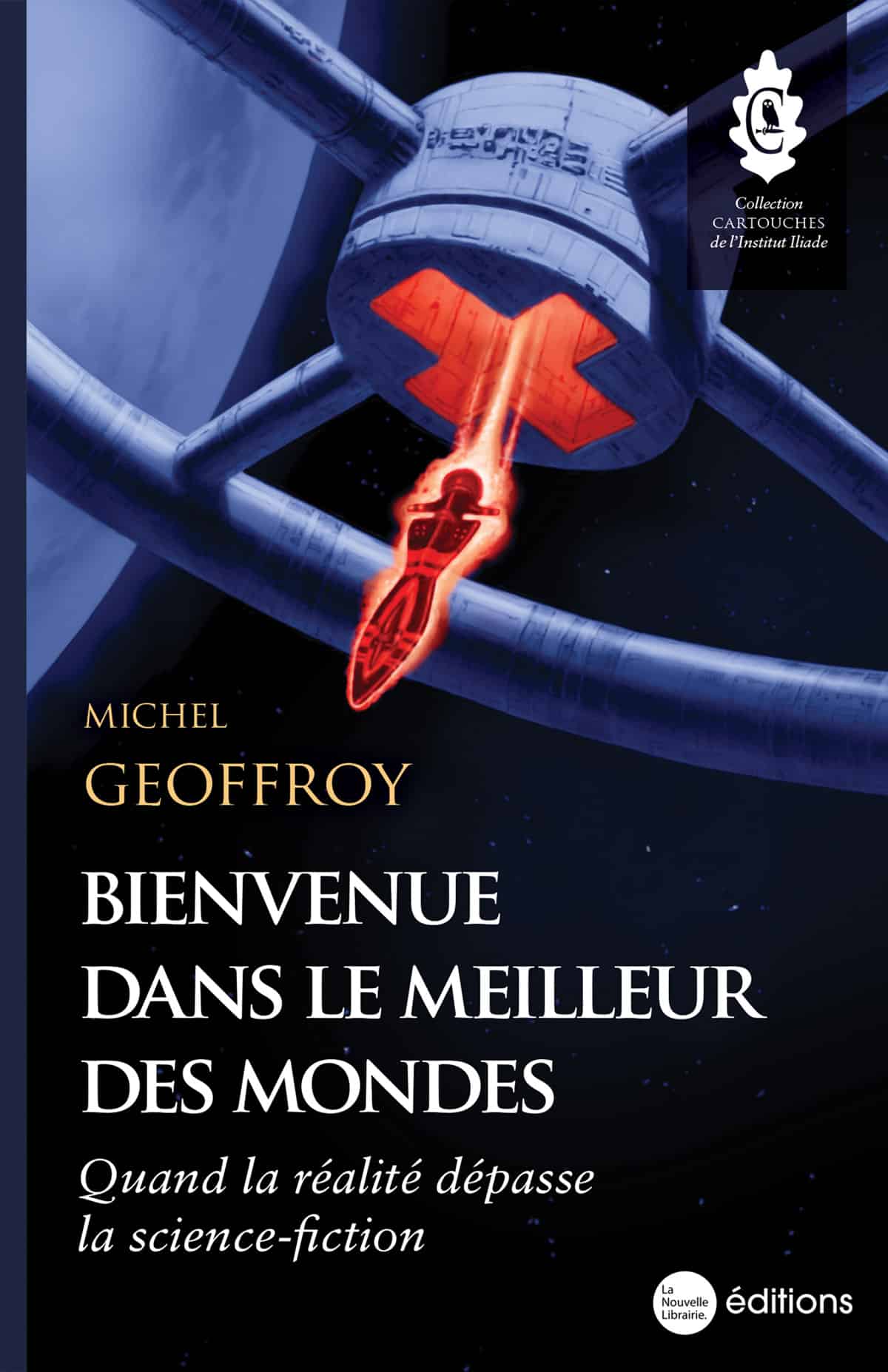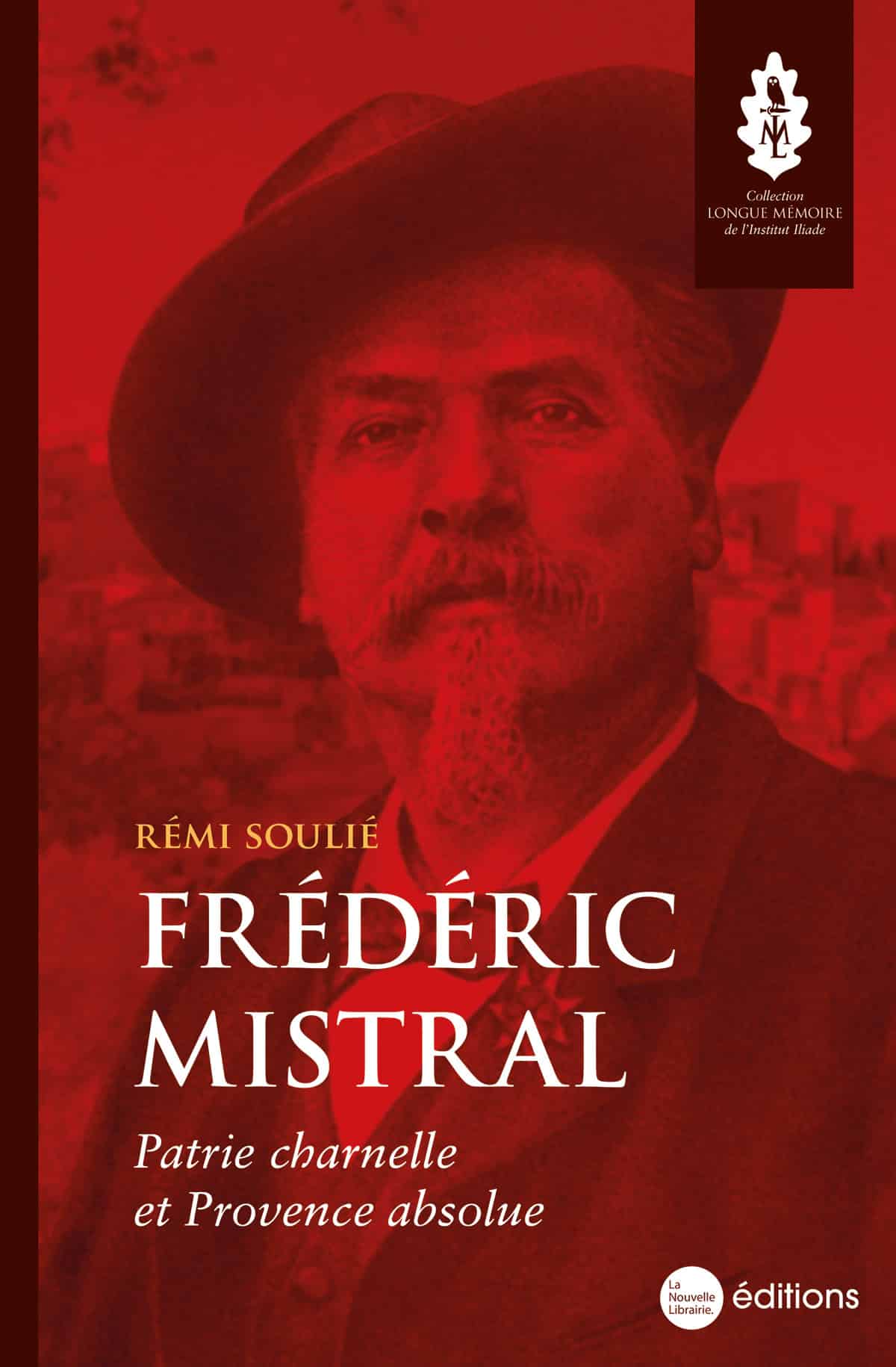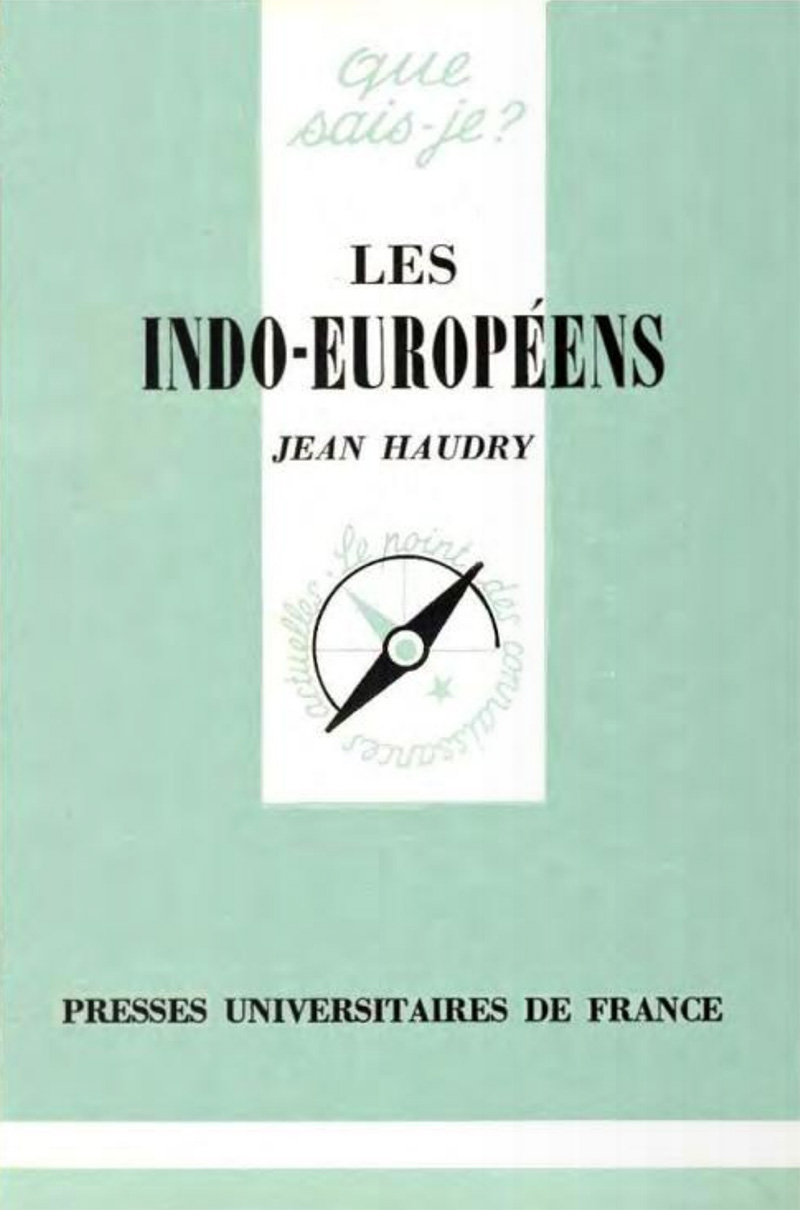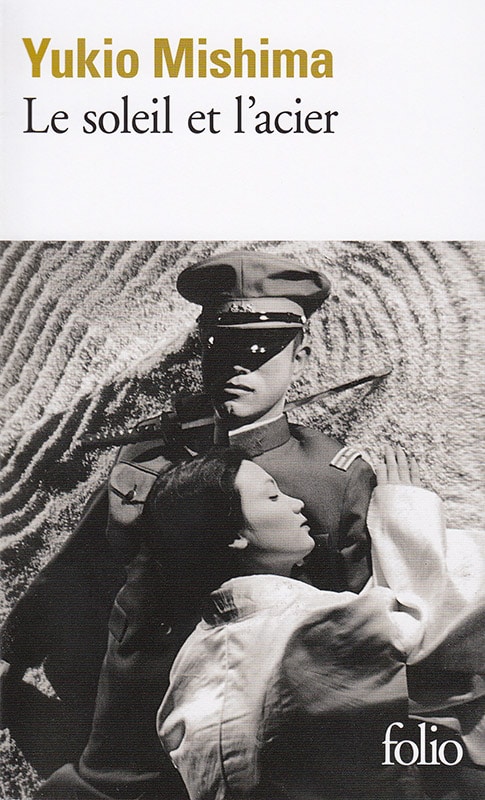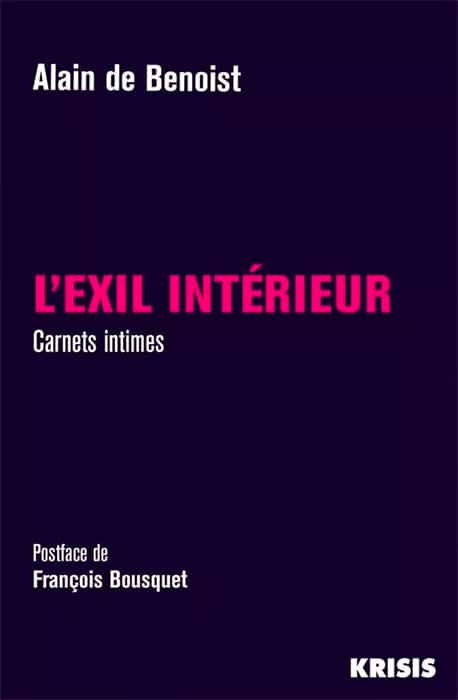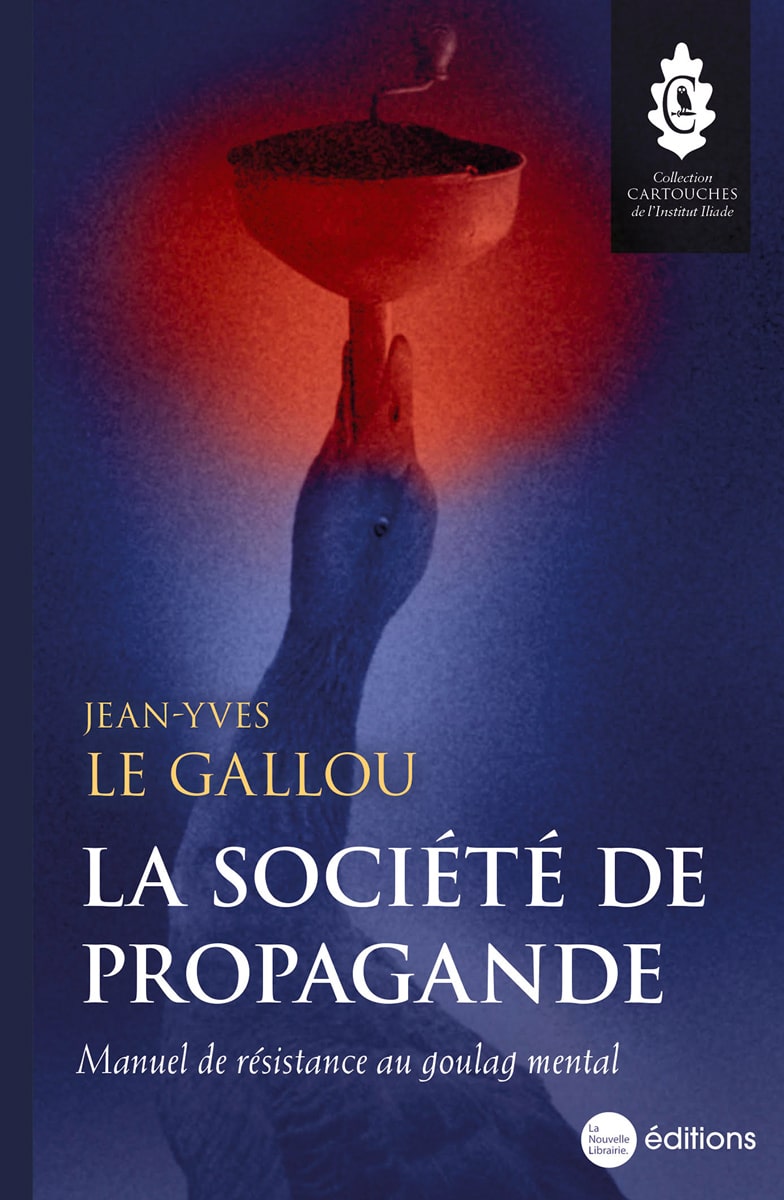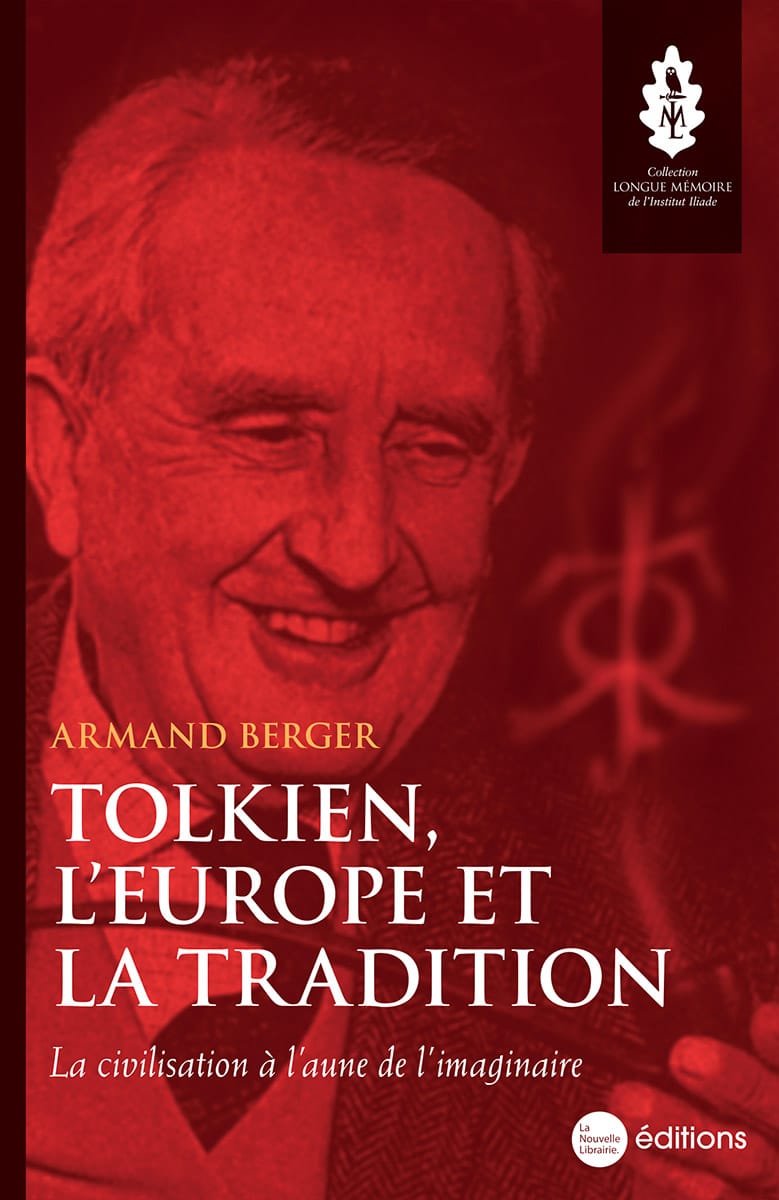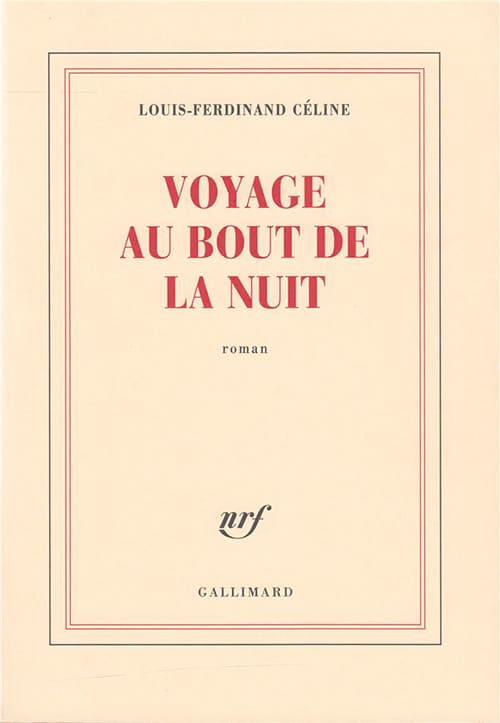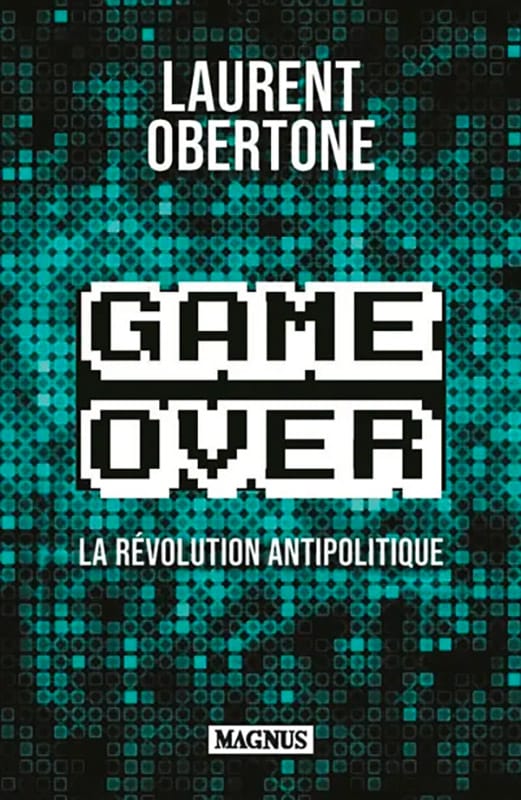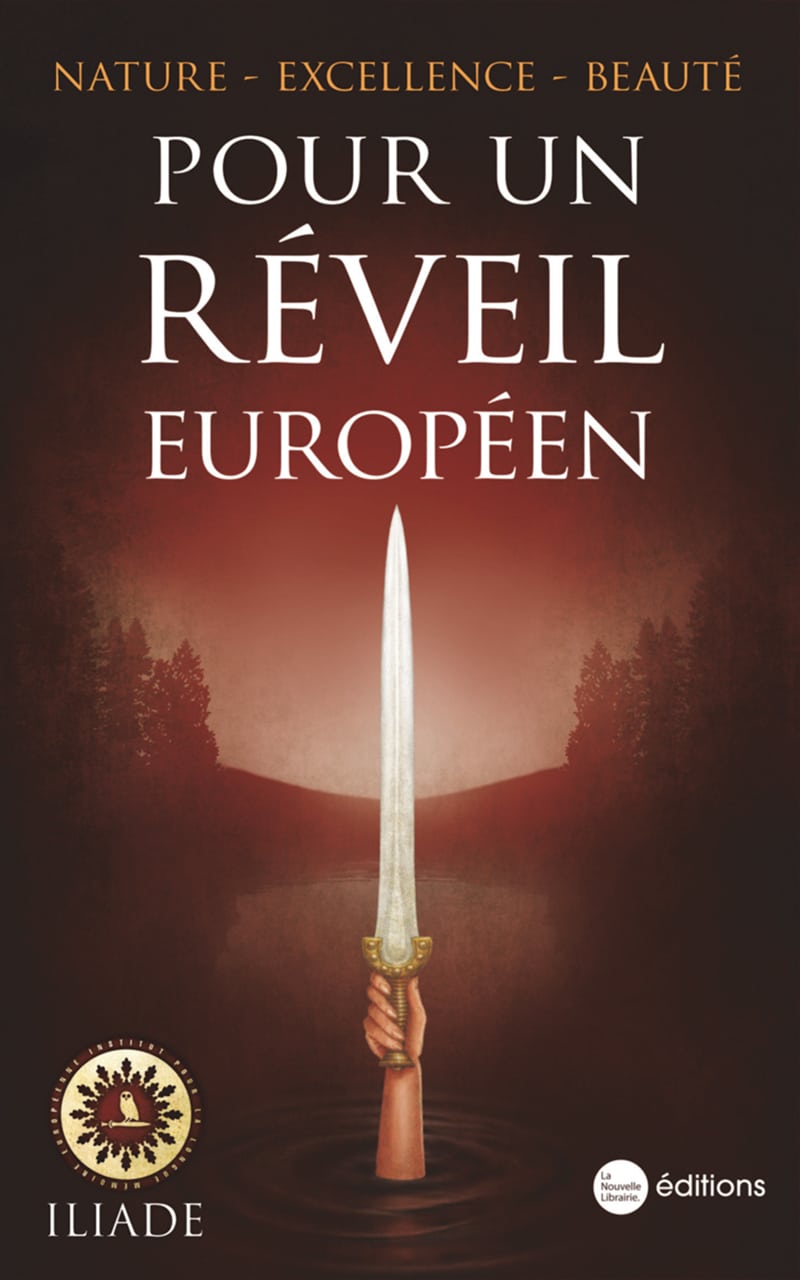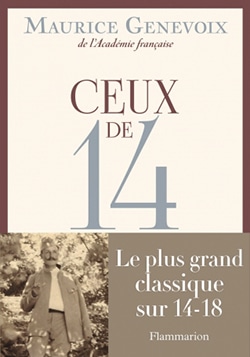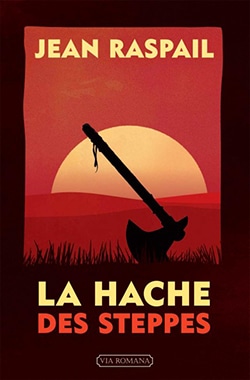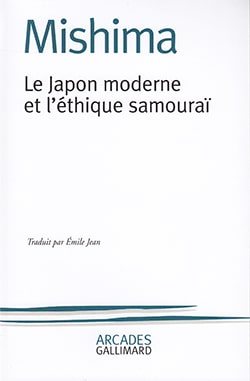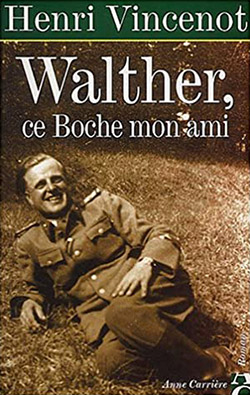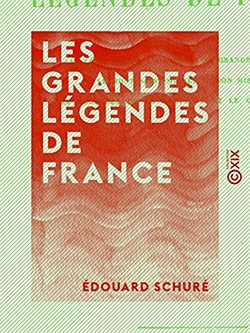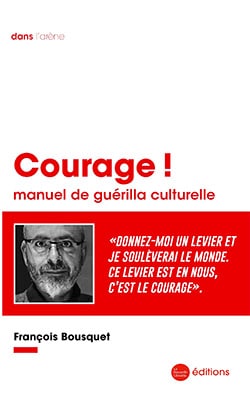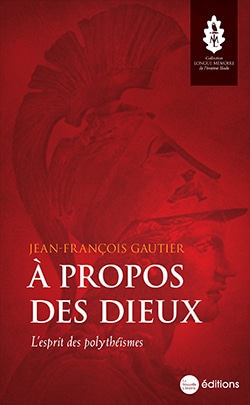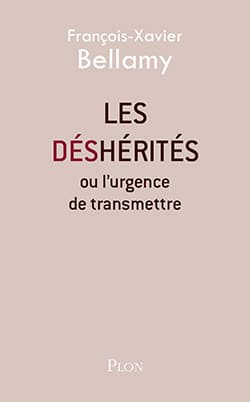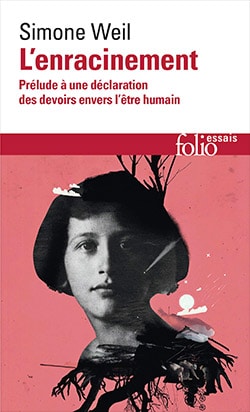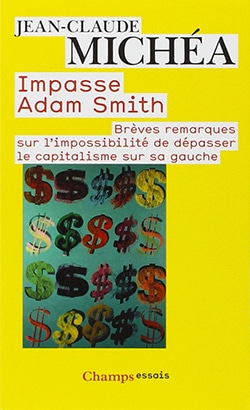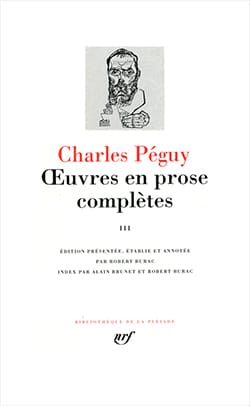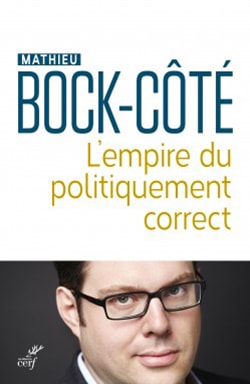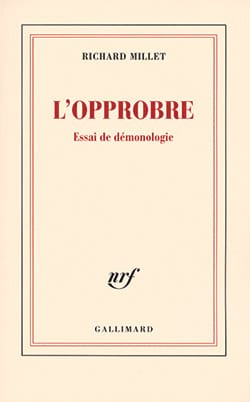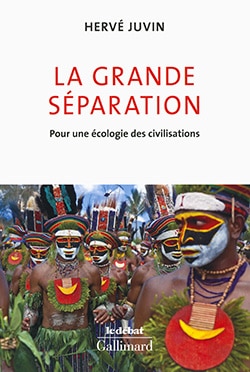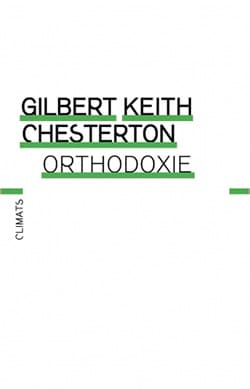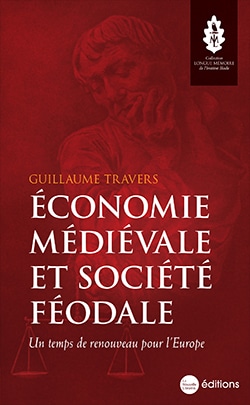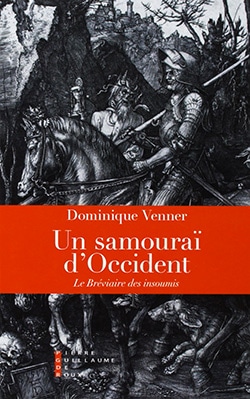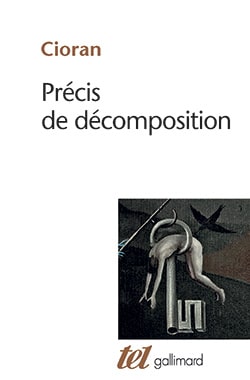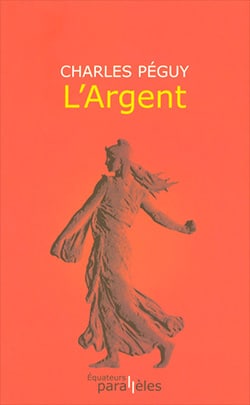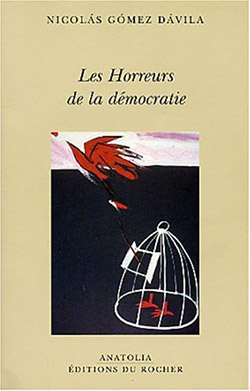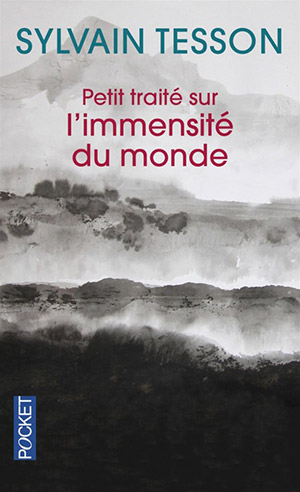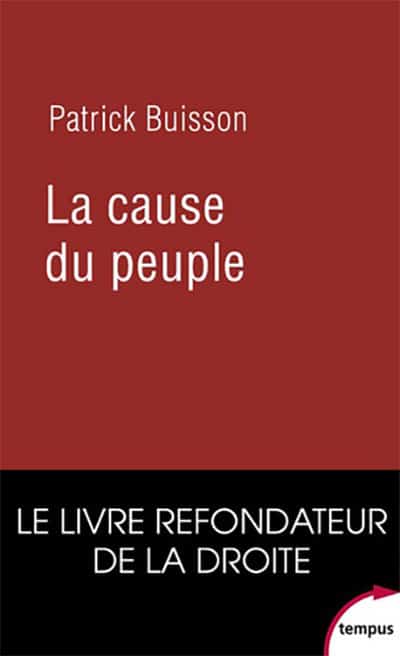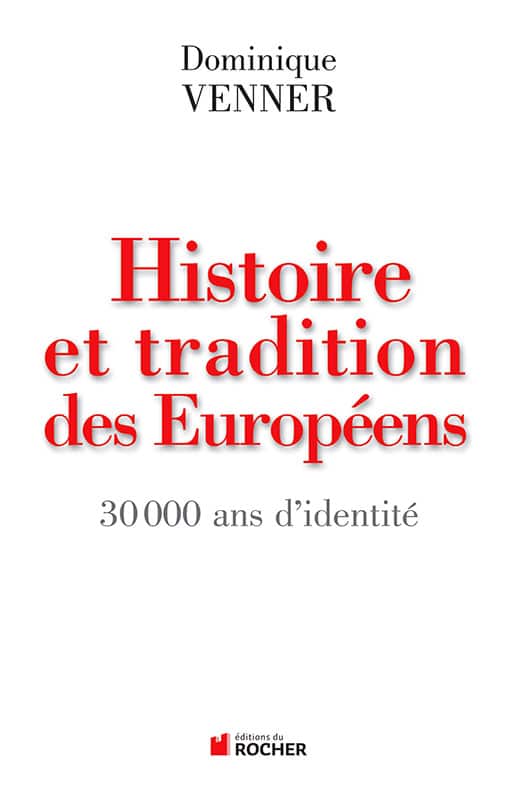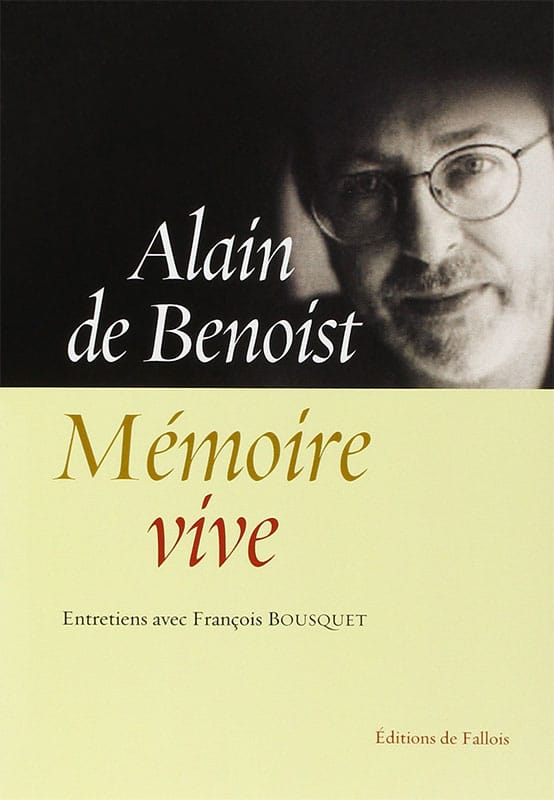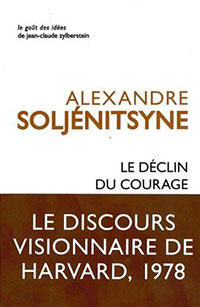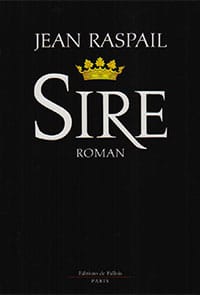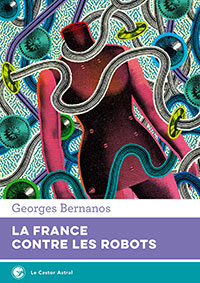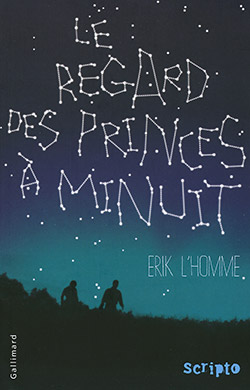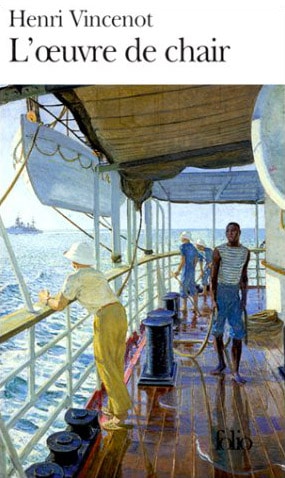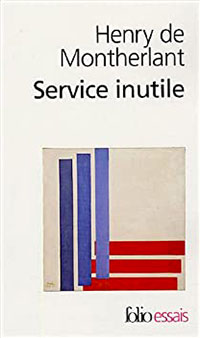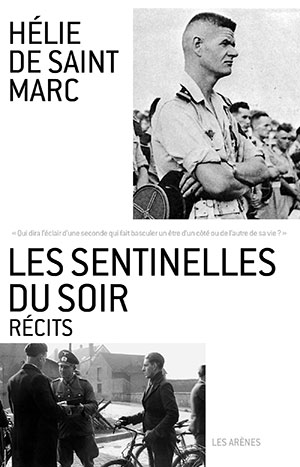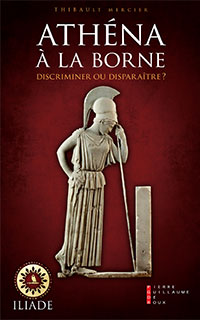« La Flamme.
Ce feu résume une vivante tradition. Non pas une image inconsistante, mais une réalité. Une réalité aussi tangible que la dureté de cette pierre ou ce souffle de vent. Le symbole du solstice est que la vie ne peut pas mourir. Nos ancêtres croyaient que le soleil n’abandonne pas les hommes et qu’il revient chaque année au rendez-vous du printemps.
Nous croyons avec eux, que la vie ne meurt pas et que par-delà la mort des individus, la vie collective continue.
Qu’importe ce que sera demain. C’est en nous dressant aujourd’hui, en affirmant que nous voulons rester ce que nous sommes, que demain pourra venir.
Nous portons en nous la flamme. La flamme pure de ce feu de foi. Non pas un feu de souvenir. Non pas un feu de piété filiale. Mais un feu de joie et de gravité qu’il convient d’allumer sur notre terre. Là nous voulons vivre et remplir notre devoir d’hommes sans renier aucune des particularités de notre sang, notre histoire, notre foi entremêlés dans nos souvenirs et dans nos veines…
Ce n’est pas la résurrection d’un rite aboli. C’est la continuation d’une grande tradition. D’une tradition qui plonge ses racines au plus profond des âges et ne veut pas disparaître. Une tradition dont chaque modification ne doit que renforcer le sens symbolique. Une tradition qui peu à peu revit. »
Jean Mabire
Les Solstices, Histoire et actualité, éditions Le Flambeau, 1991