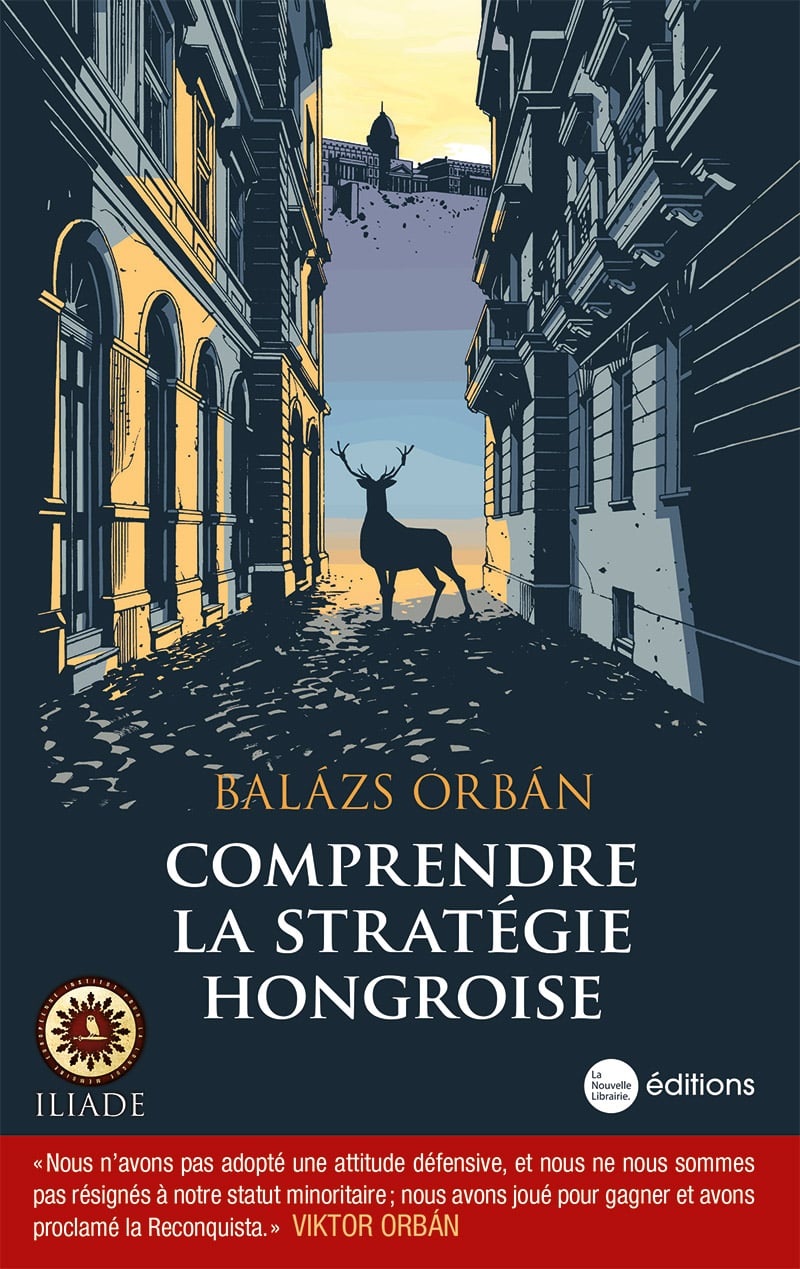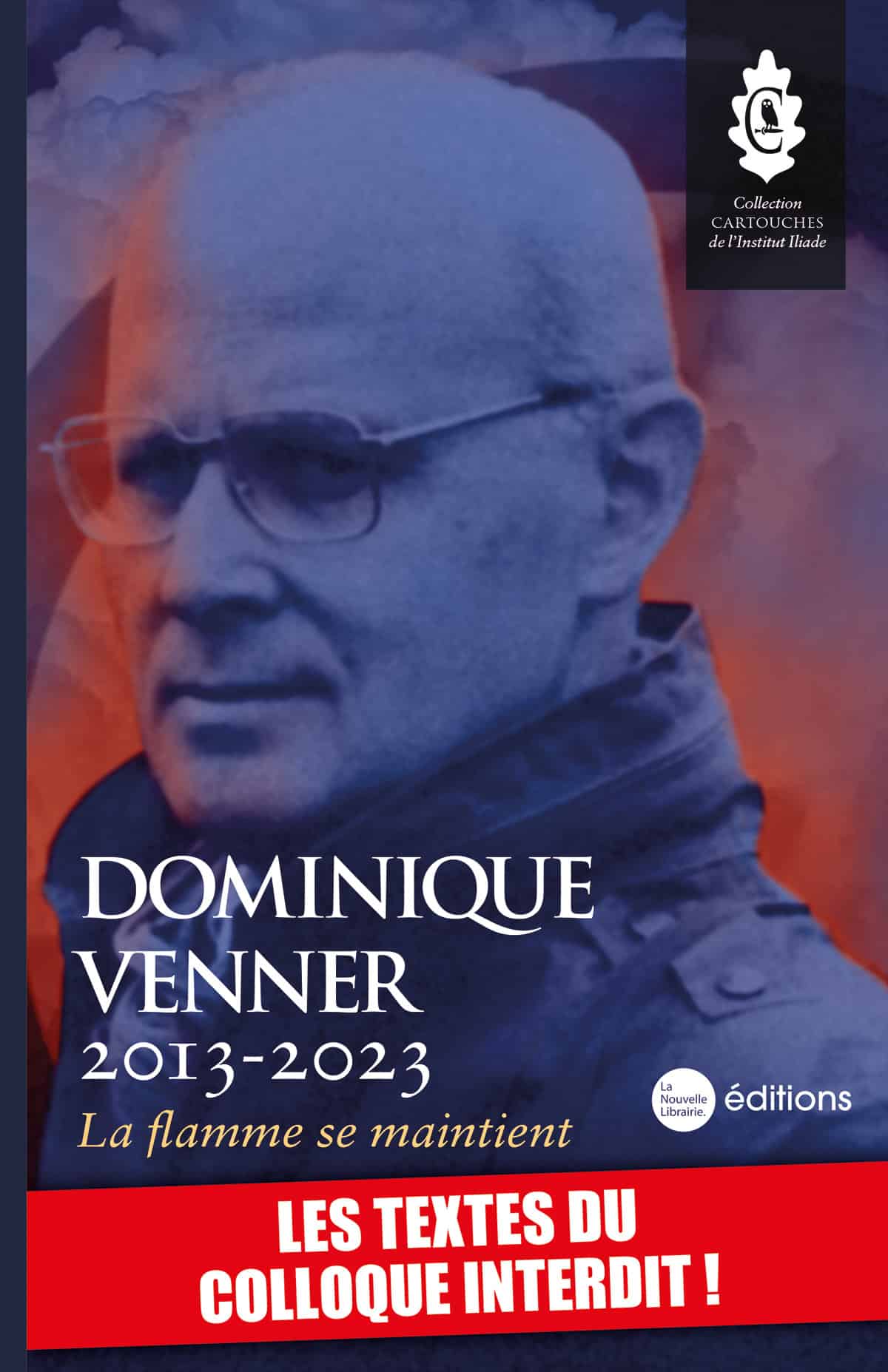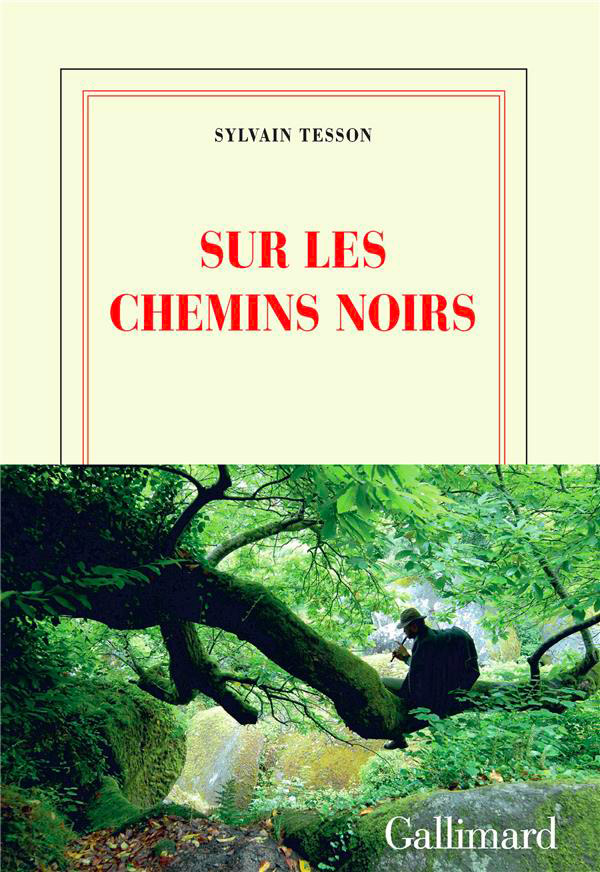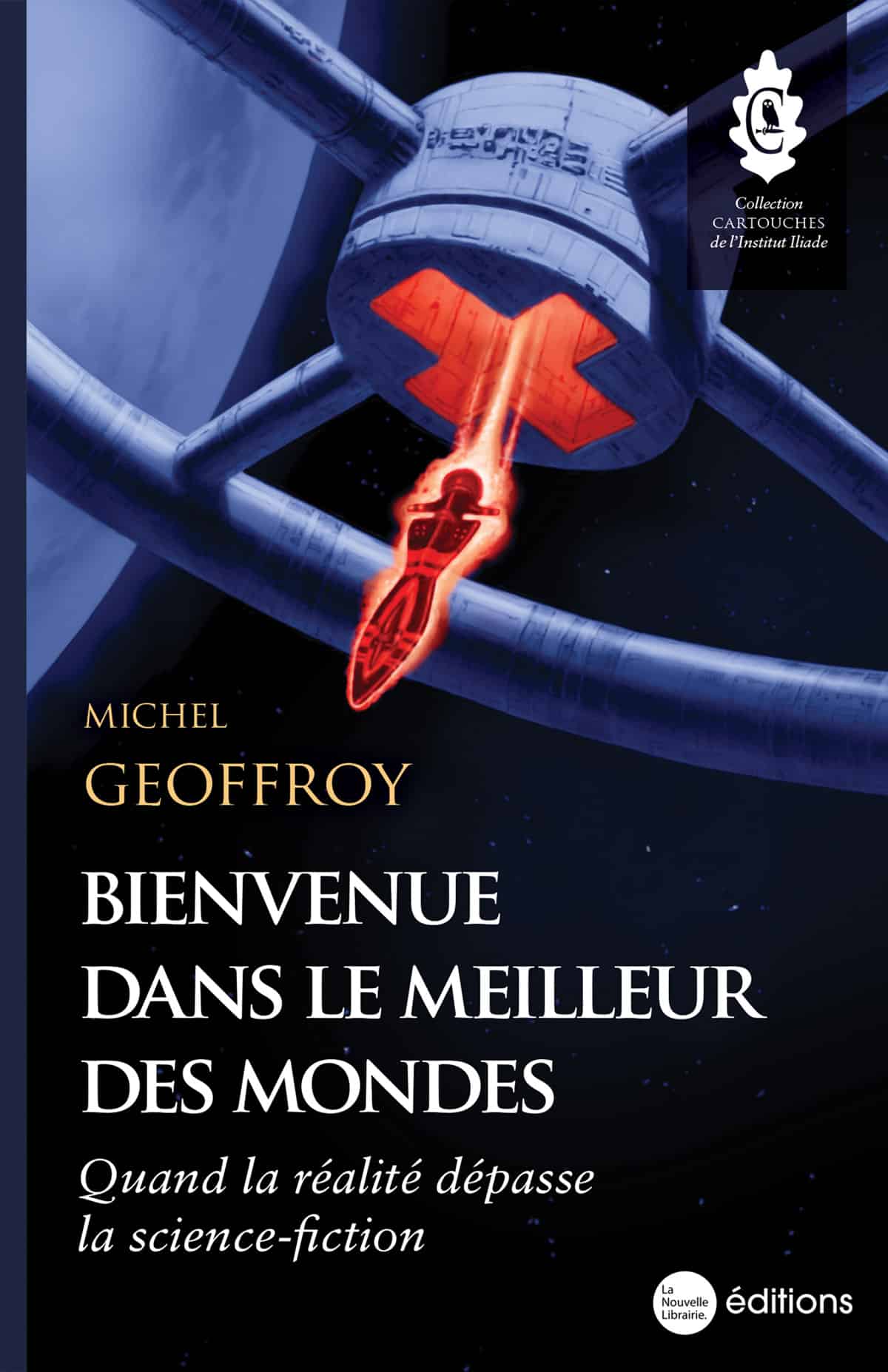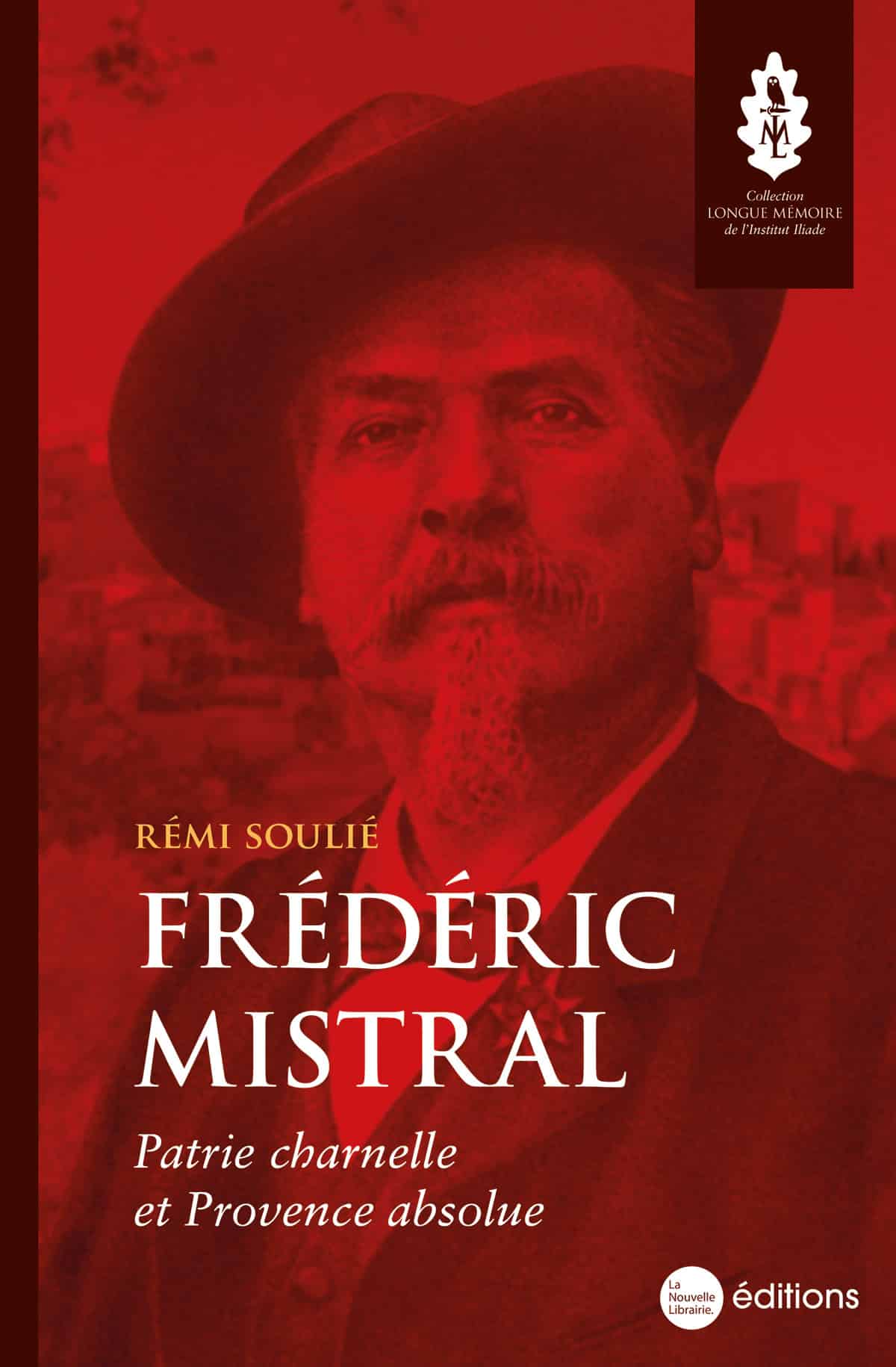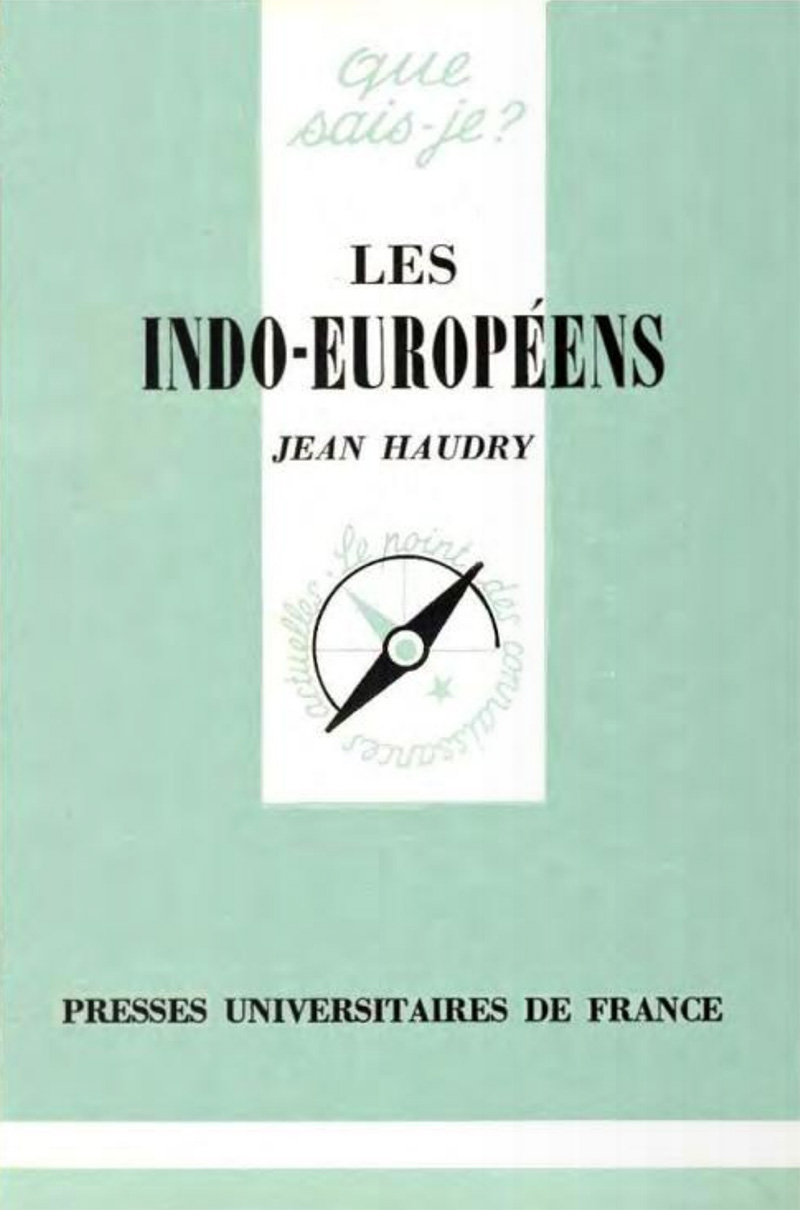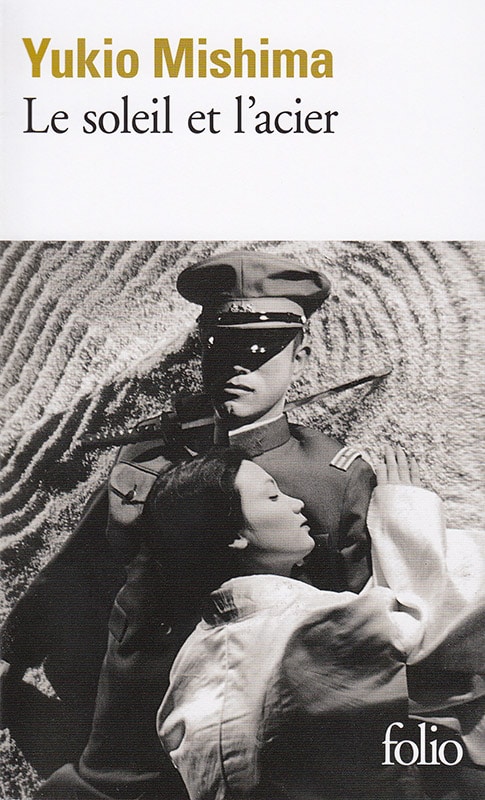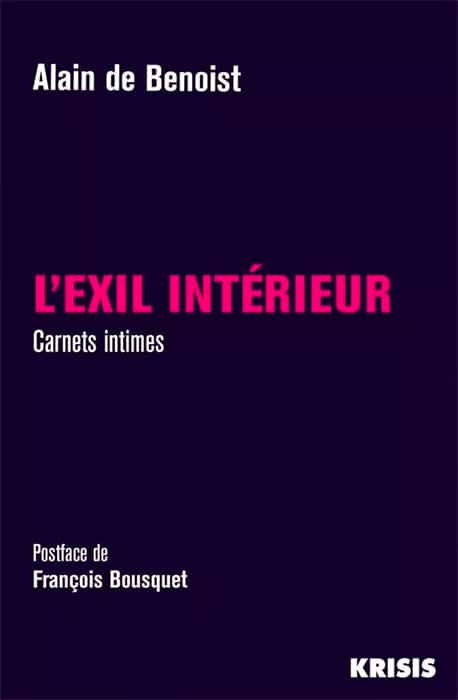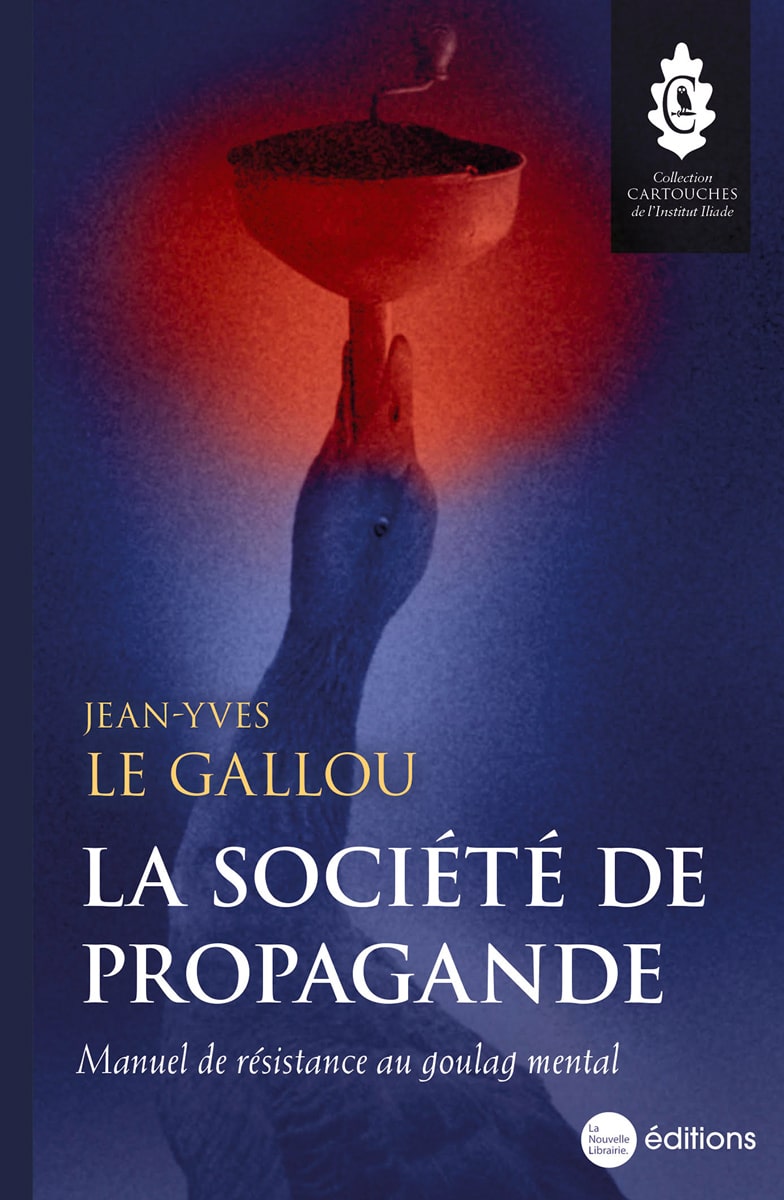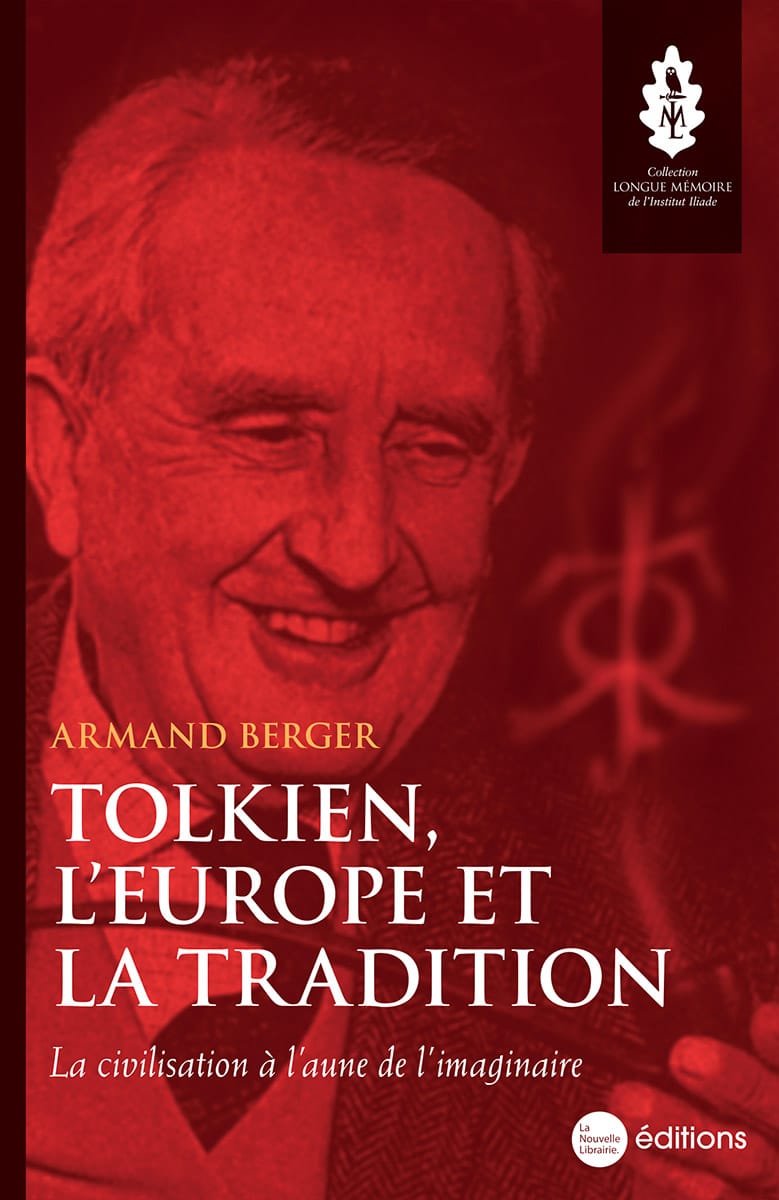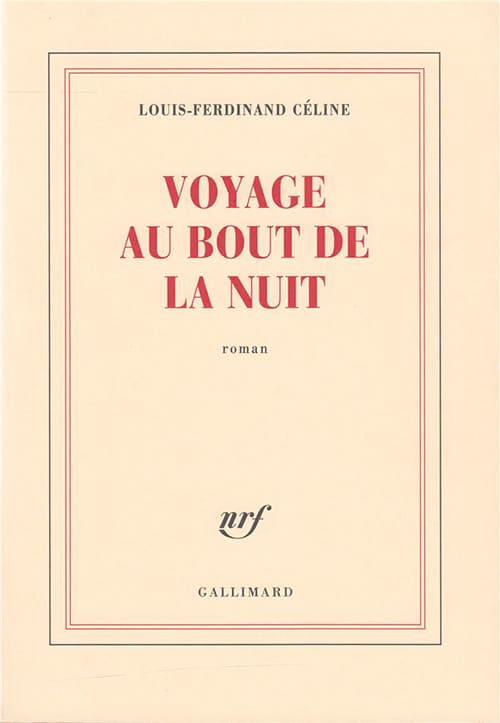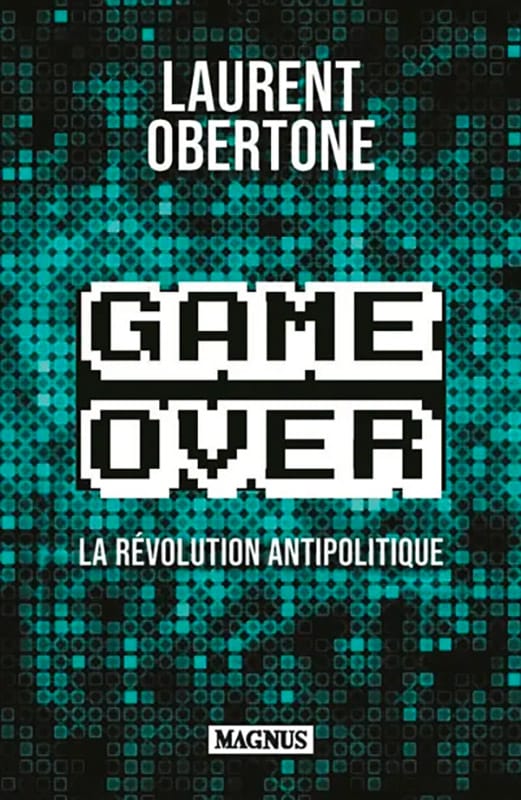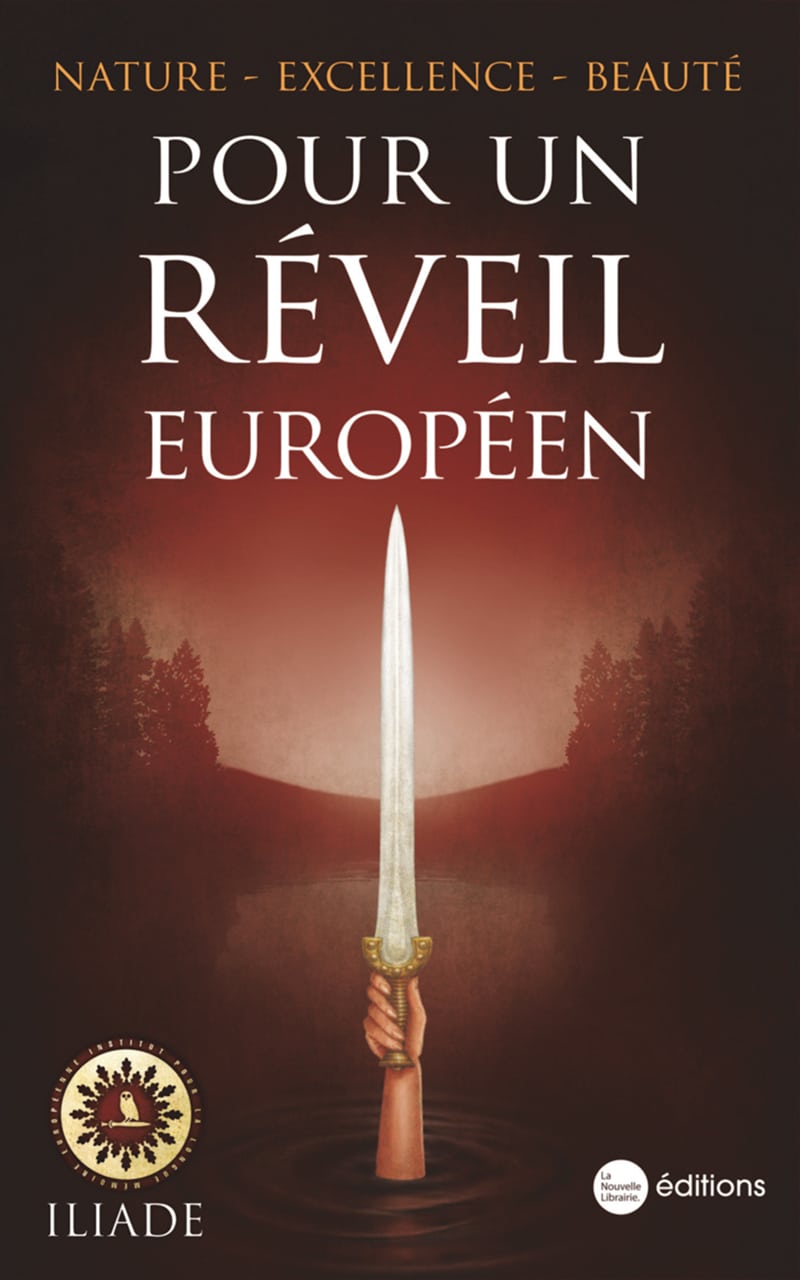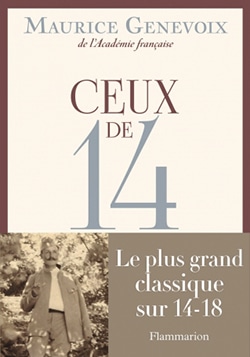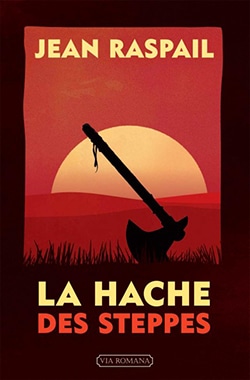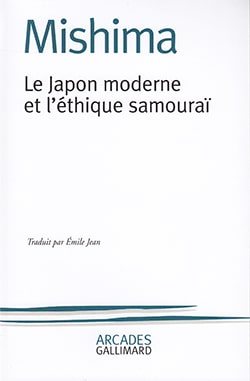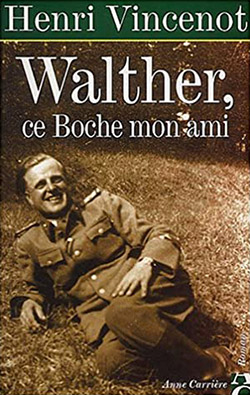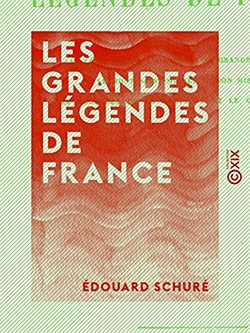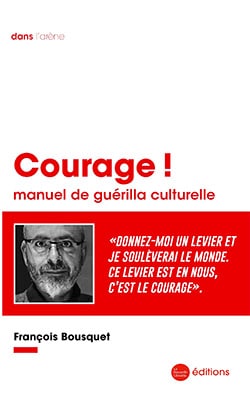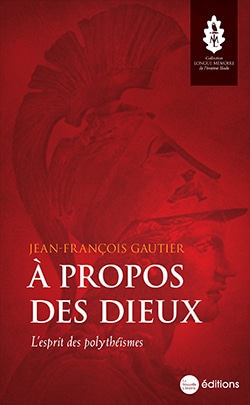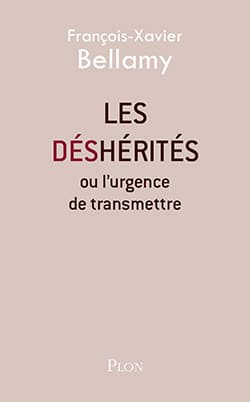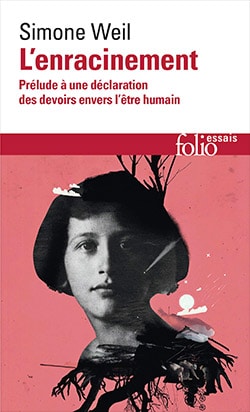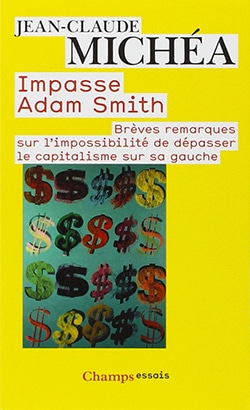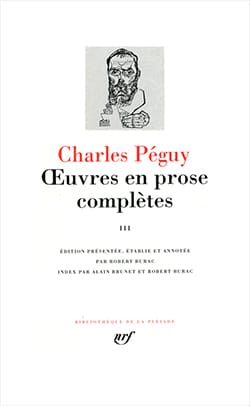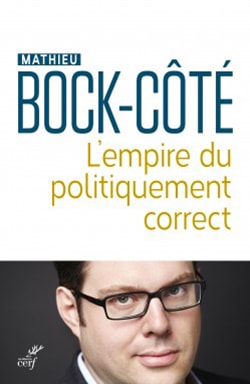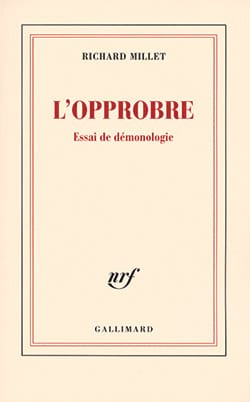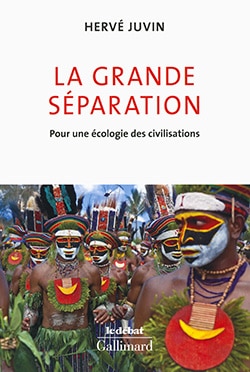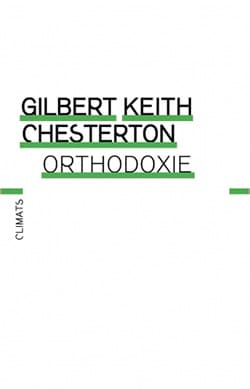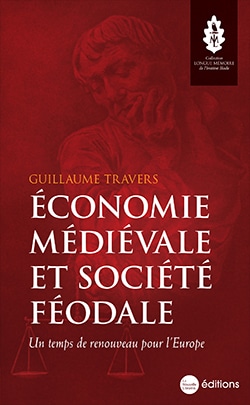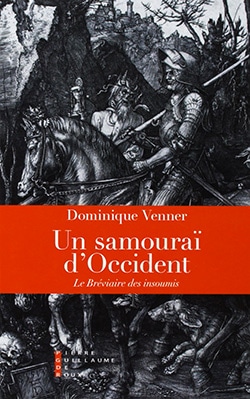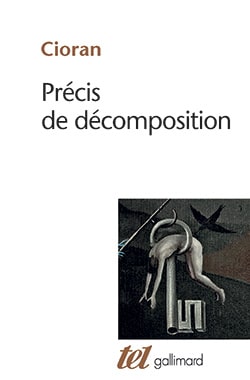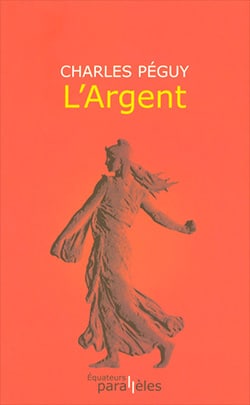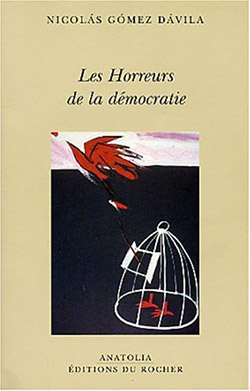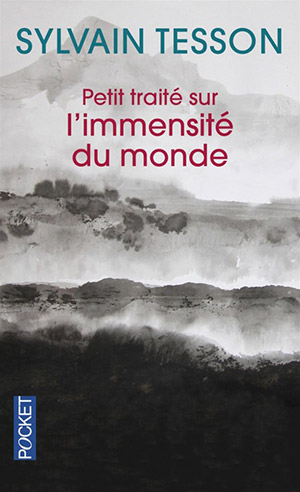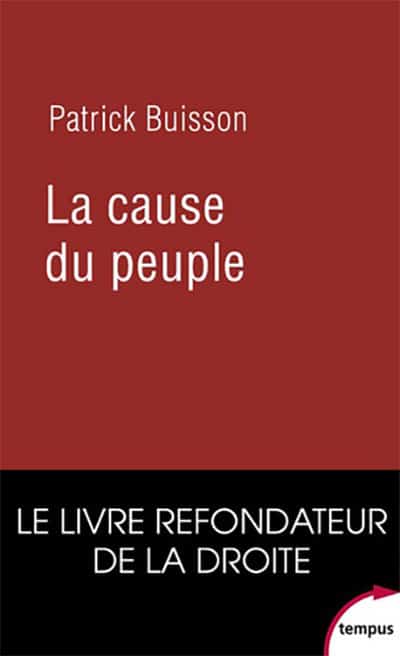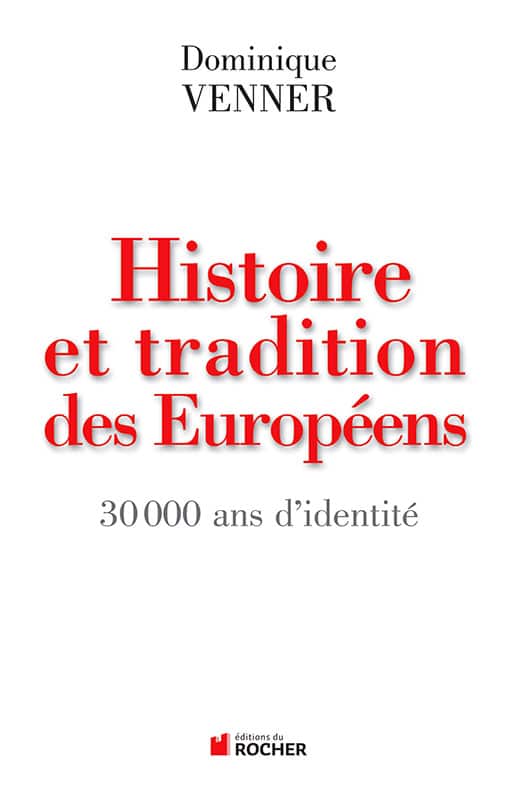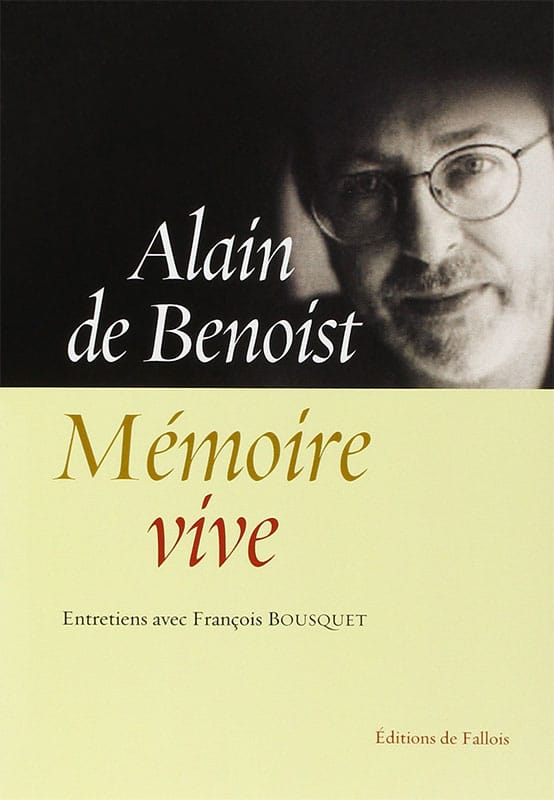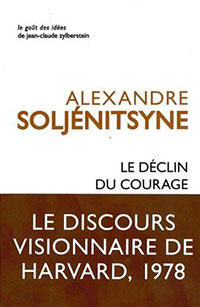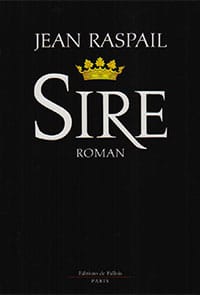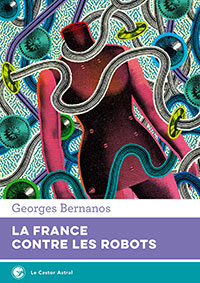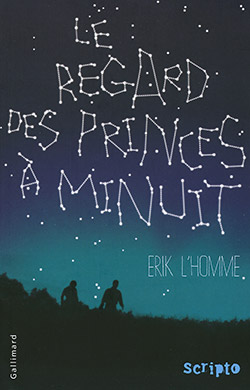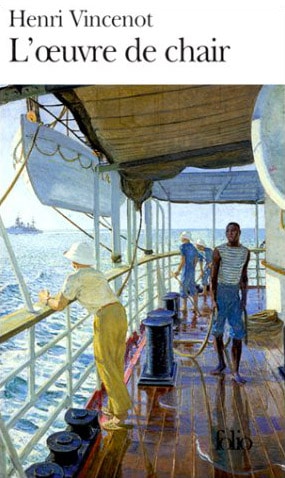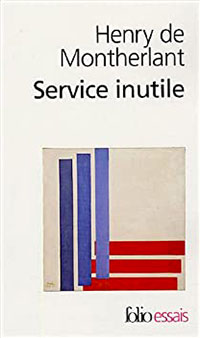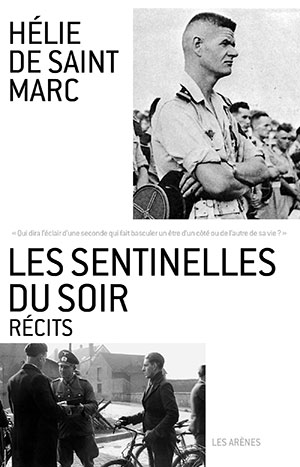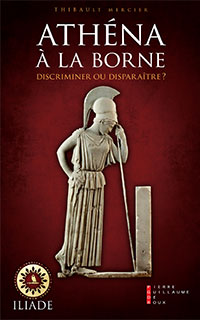« Une baie démesurée s’étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes ; et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d’or et de clarté, s’élevait sombre et pointu un mont étrange, au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître, et sur l’horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument.
(…) Après plusieurs heures de marche, j’atteignis l’énorme bloc de pierres qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j’entrai dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J’entrai dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu’une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus, et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses, et reliés l’un à l’autre par de fines arches ouvragées. »
Guy de Maupassant
Le Horla, 1886, éditions Albin Michel, coll. Le Livre de Poche, 1967