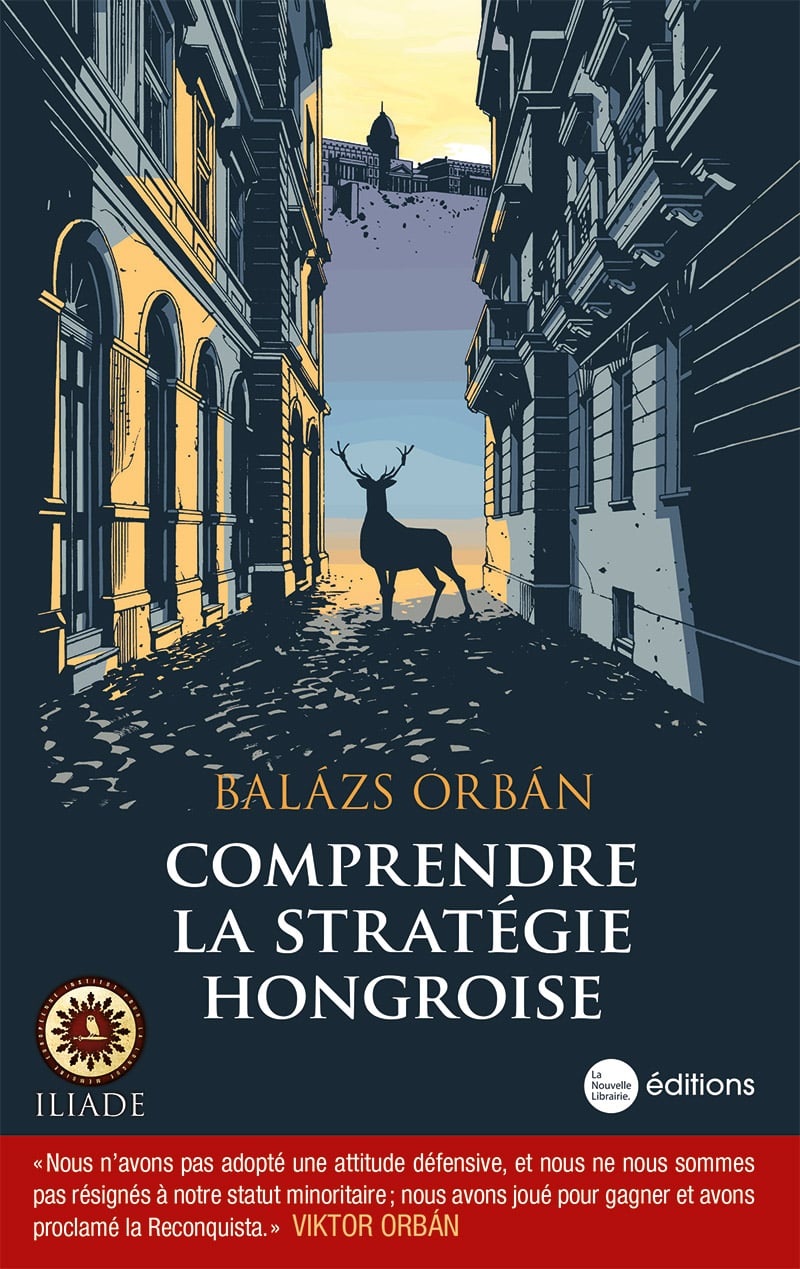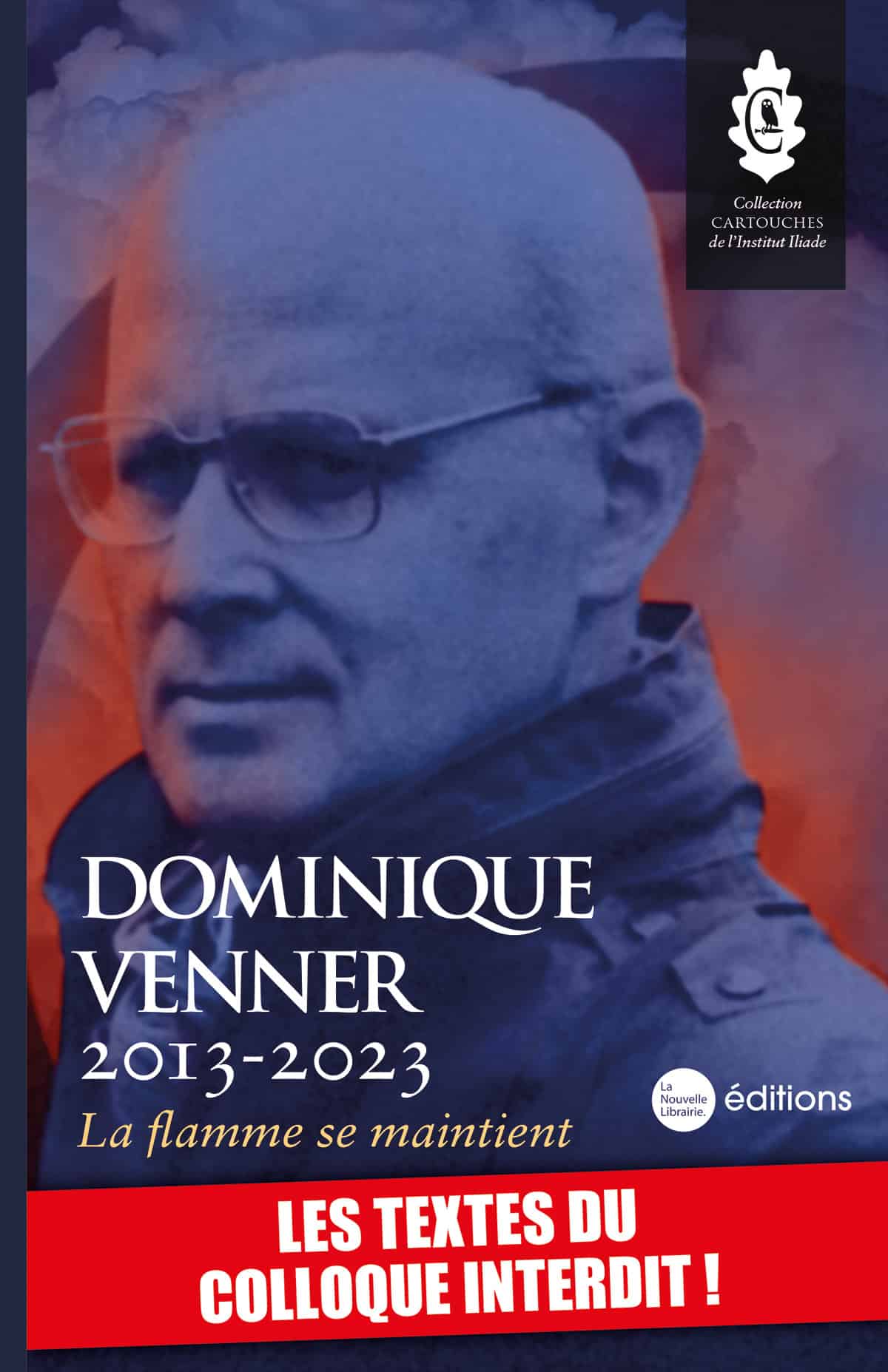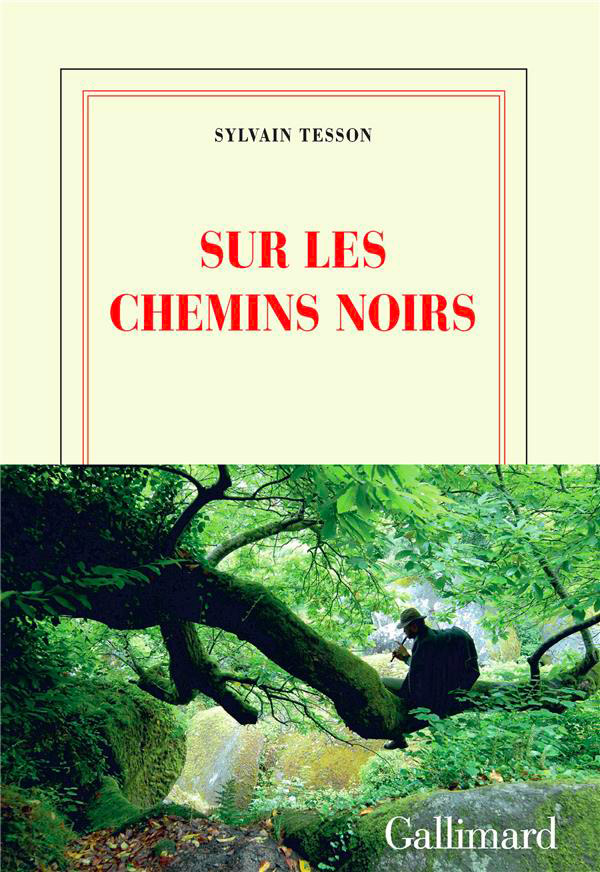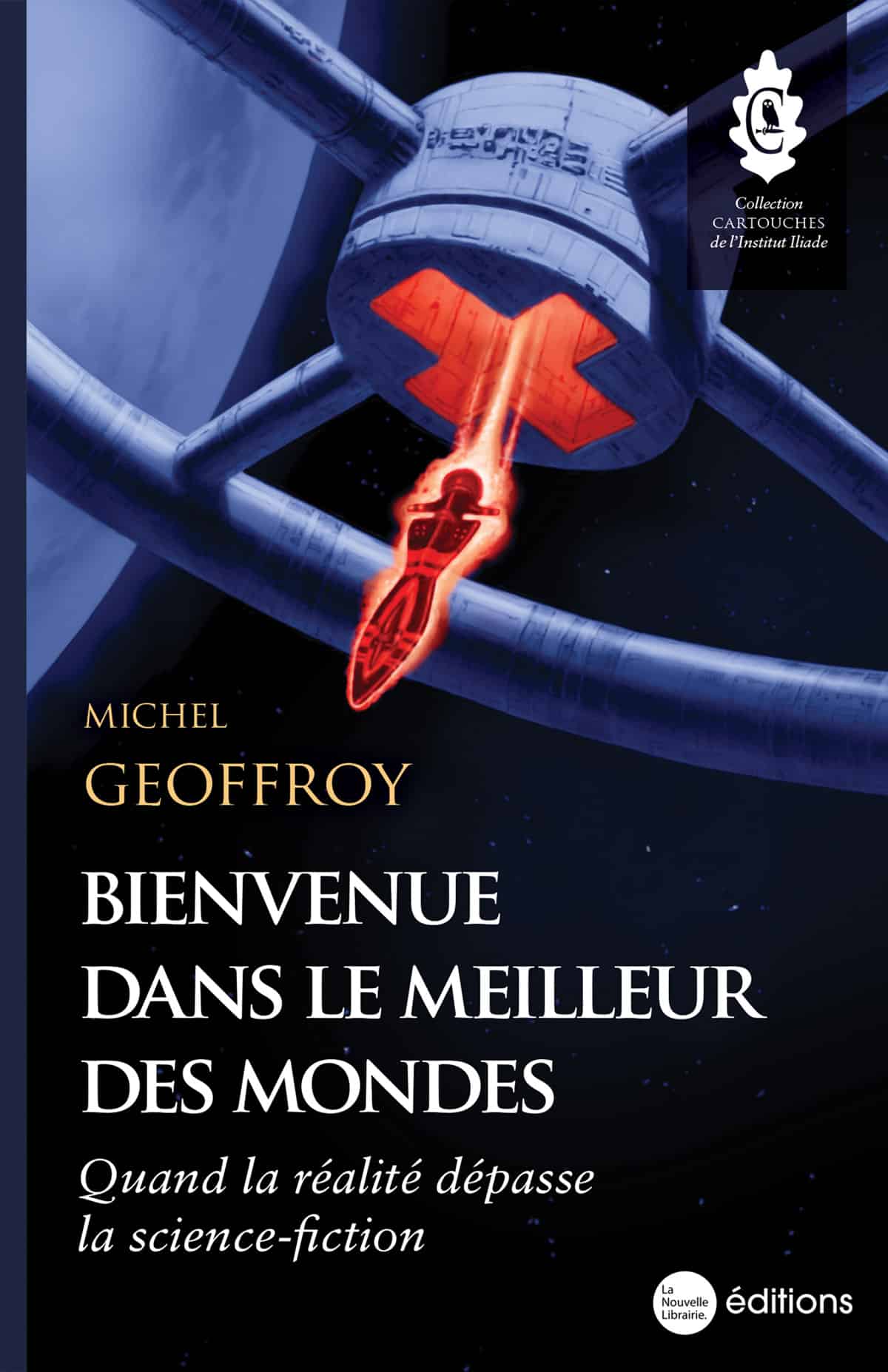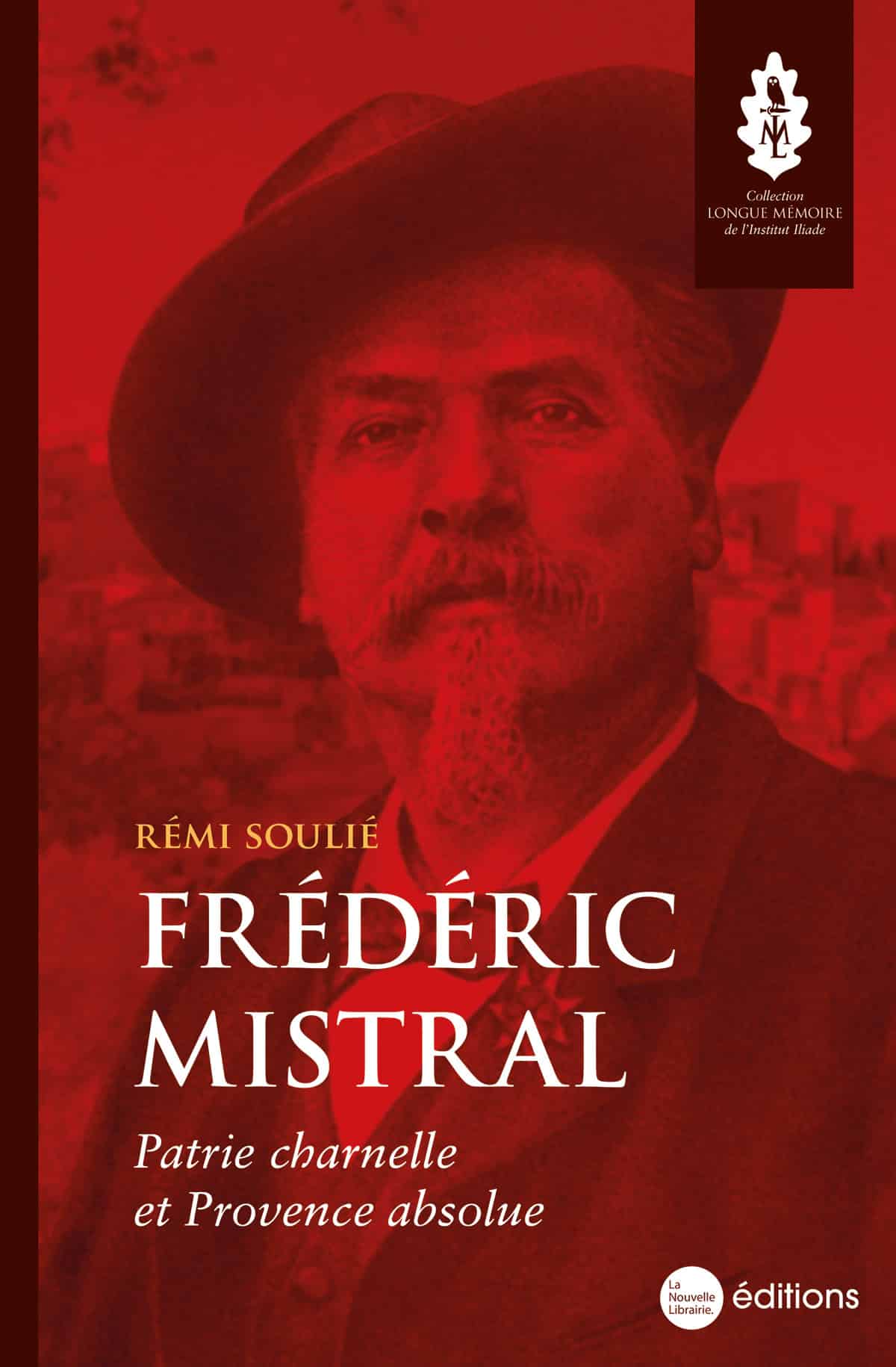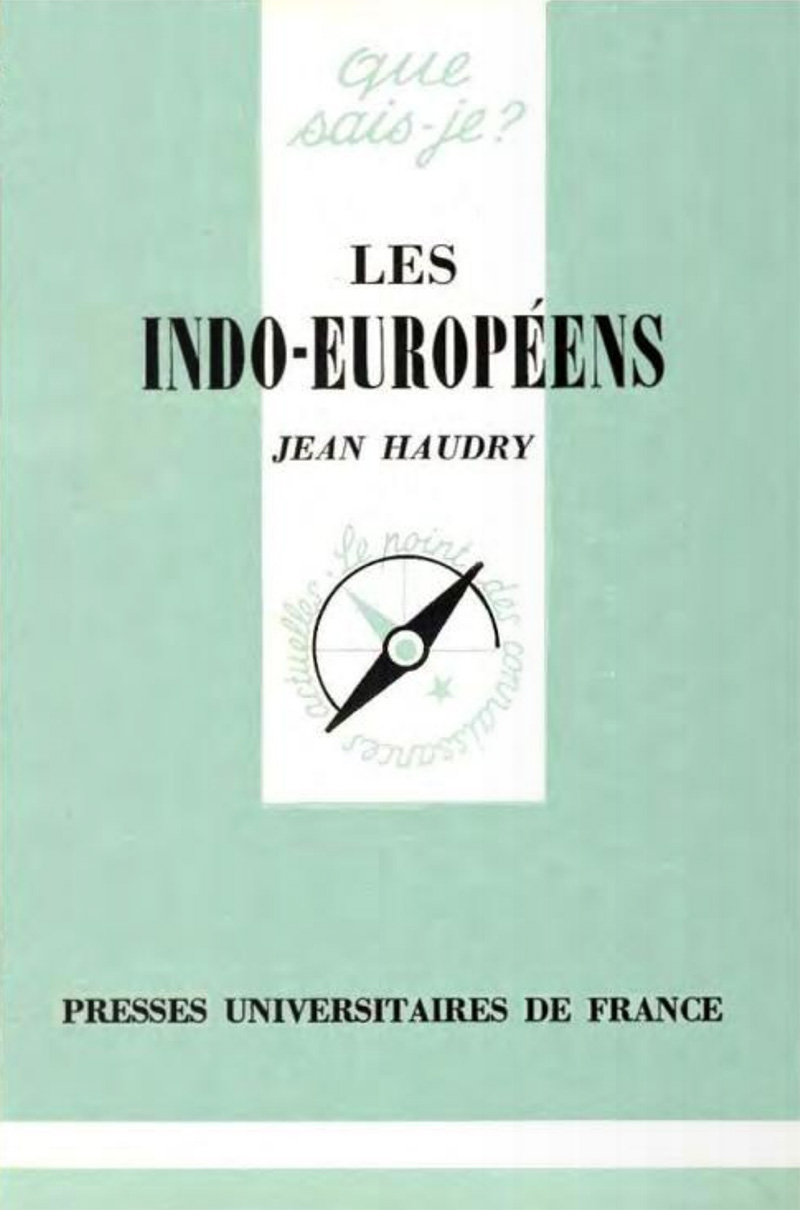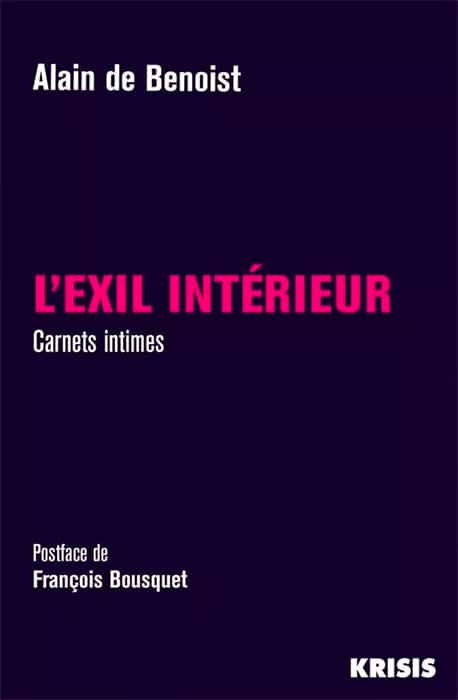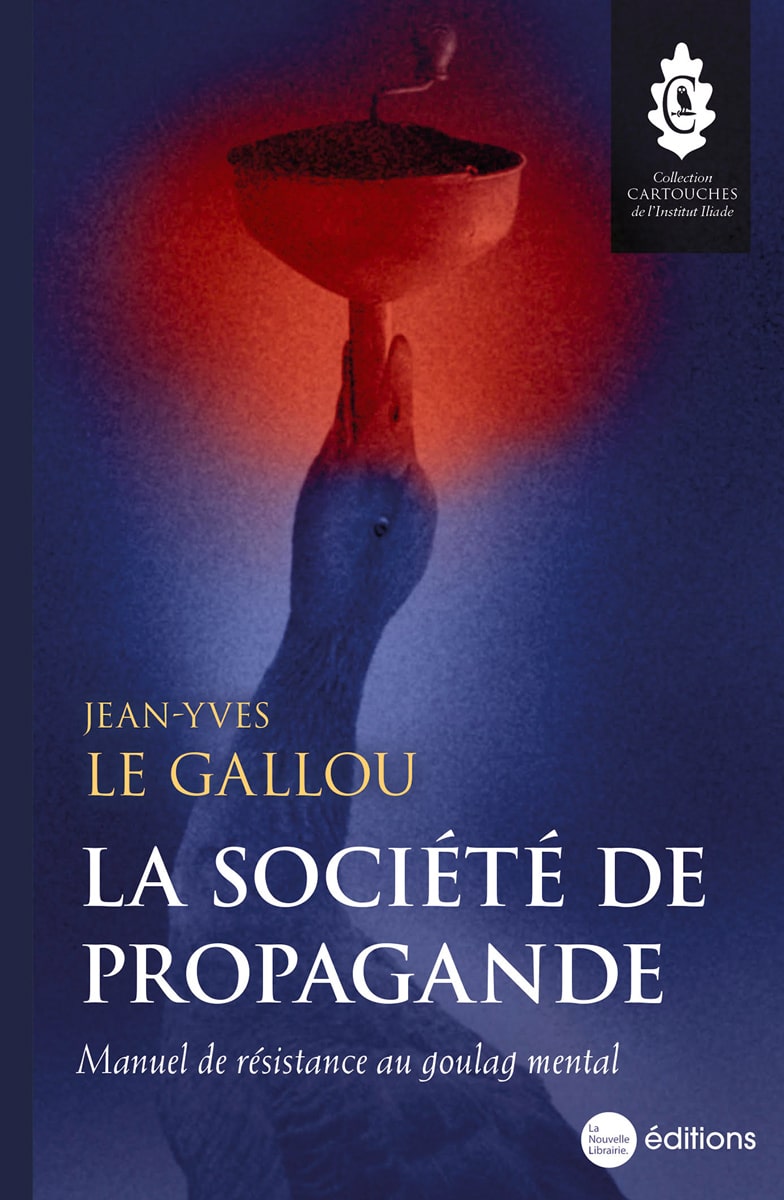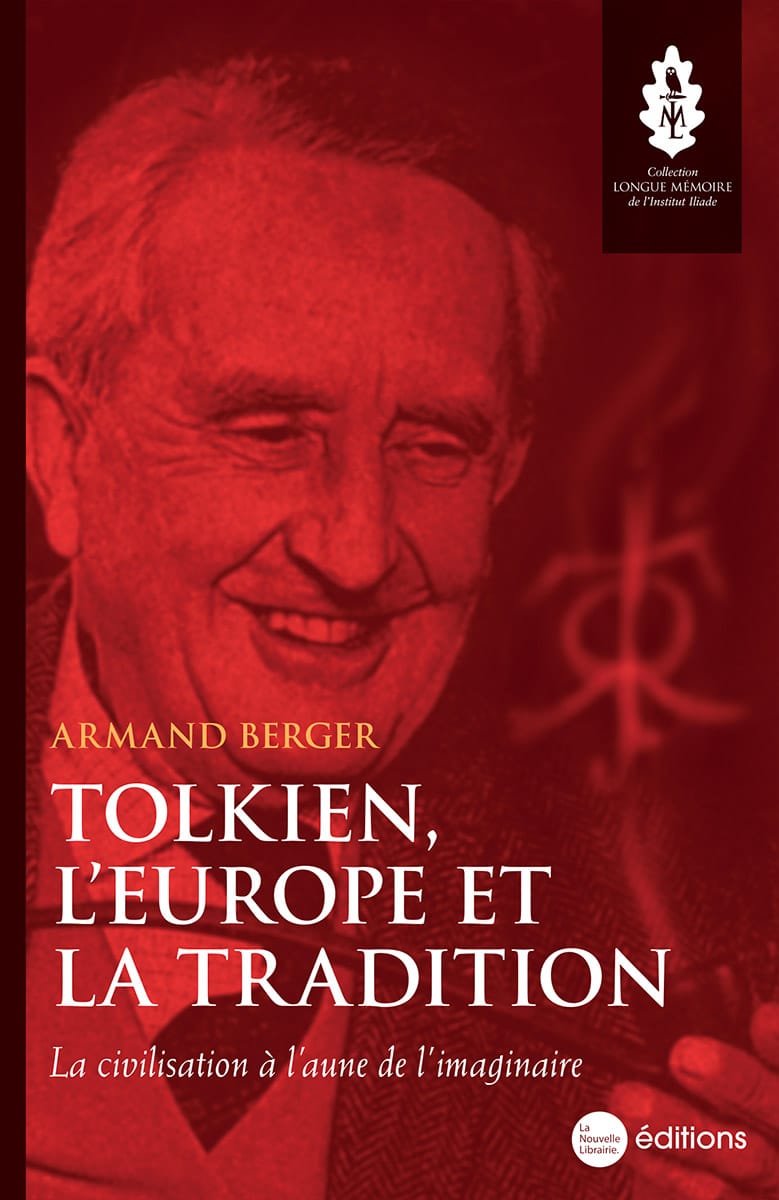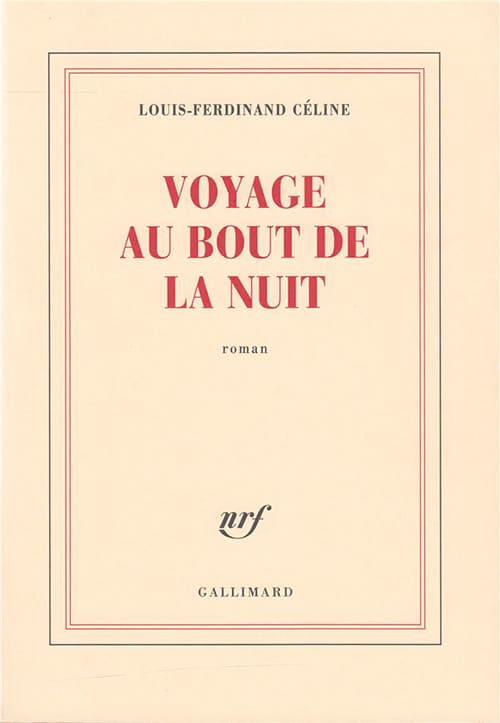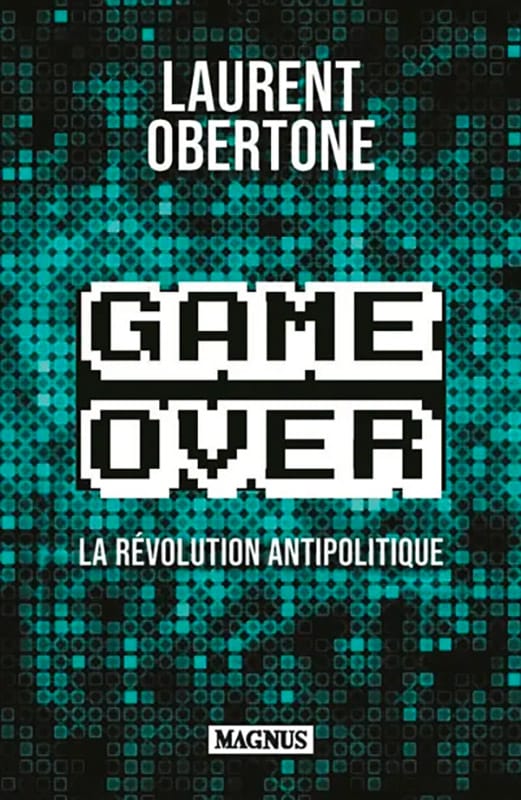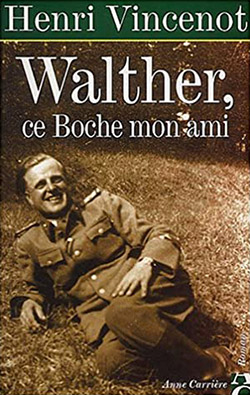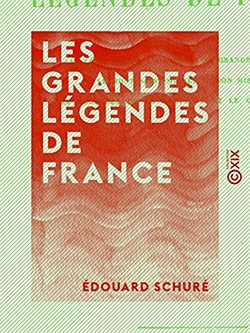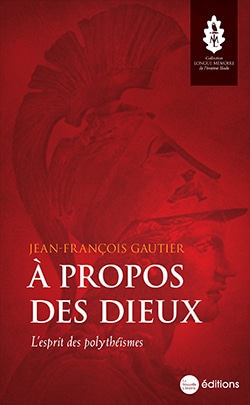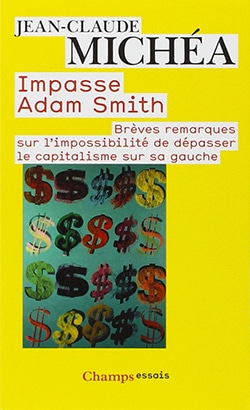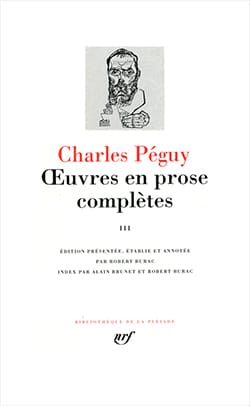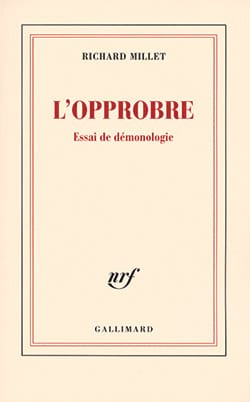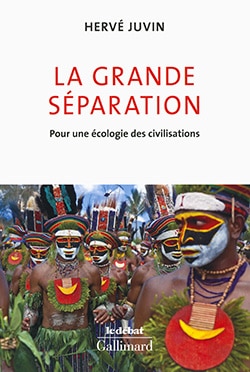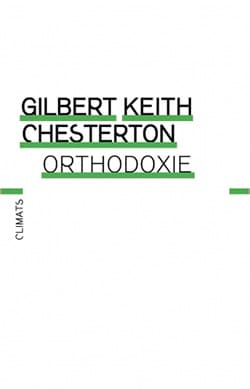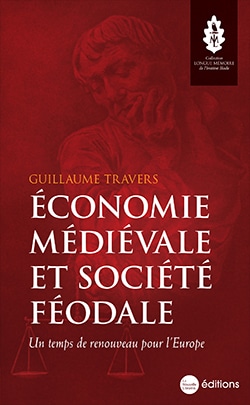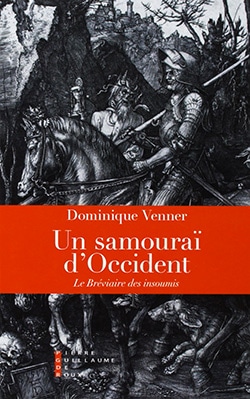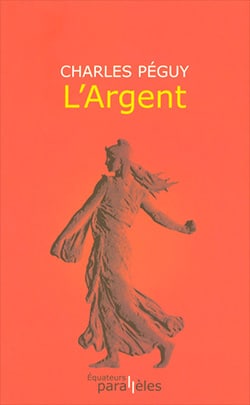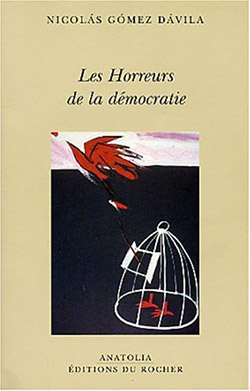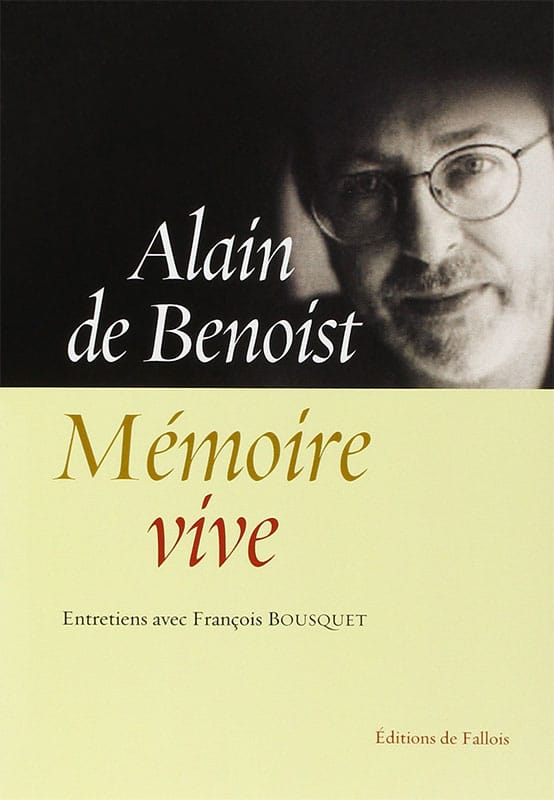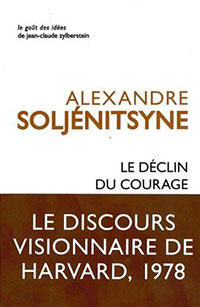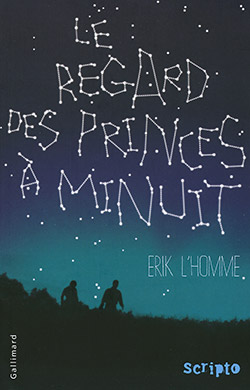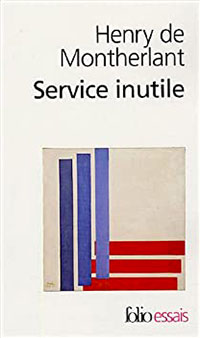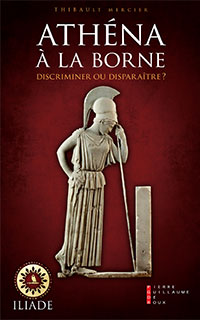« Les années qui ont débouché sur la crise financière de 2008 furent l’âge d’or de la confiance grisante dans le marché et de la dérégulation qu’elle a entraînée – on pourrait les qualifier d’ère du triomphalisme du marché. Cette ère a commencé au début des années 1980, décennie où Ronald Reagan et Margaret Thatcher se sont dits certains que le marché, et non les États, était la clé de la prospérité et de la liberté ; puis ce mouvement s’est poursuivi dans les années 1990, période où s’est épanoui le libéralisme favorable au marché de Bill Clinton et de Tony Blair, lesquels ont en même temps tempéré et consolidé la conviction que le bien public repose surtout sur le marché.
À l’heure actuelle, cette confiance est battue en brèche. L’ère du triomphalisme mercantile s’est achevée. La crise financière a fait plus qu’amener à douter de l’aptitude du marché à répartir efficacement les risques : on s’accorde en outre à reconnaître depuis que celui-ci s’est tellement détaché de la morale qu’il est devenu indispensable de l’en rapprocher à nouveau d’une manière ou d’une autre. Mais, ce qui n’est pas évident, c’est ce qu’il faudrait entendre par là, ou comment il conviendrait de procéder.
Pour certains, un même défaut moral était au cœur du triomphalisme du marché : la cupidité, qui poussa à prendre des risques inconsidérés. Dans cette optique, la solution consisterait à juguler ce travers en exigeant que les banquiers et les décideurs de Wall Street fassent preuve de davantage d’intégrité et de responsabilité et en promulguant des réglementations assez intelligentes pour prévenir la répétition d’une crise similaire.
C’est un diagnostic partiel, au mieux, car, même si la cupidité a indéniablement concouru à déclencher la crise financière, quelque chose de plus important est en jeu. Le plus funeste de tous les changements propres aux trois dernières décennies n’a pas résidé dans cette avidité accrue : il tient à ce que le marché et les valeurs marchandes ont envahi des sphères de la vie où ils n’ont pas leur place. […] L’immixtion du marché, et des raisonnements qu’il induit, dans les aspects de la vie traditionnellement régis par des normes non marchandes est l’une des évolutions les plus significatives de notre temps. »
Michael Sandel
Ce que l’argent ne saurait acheter (What Money Can’t Buy : The Moral Limits of Markets), éditions du Seuil, 2014