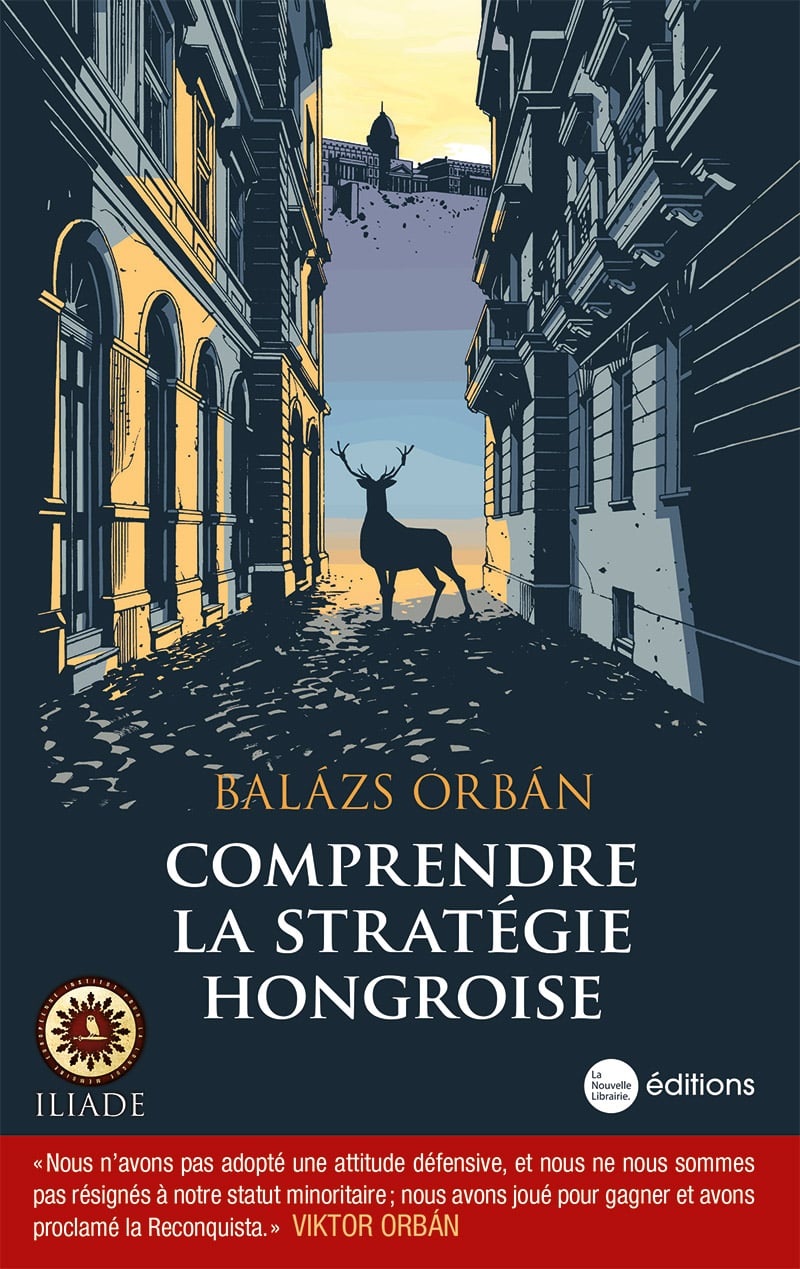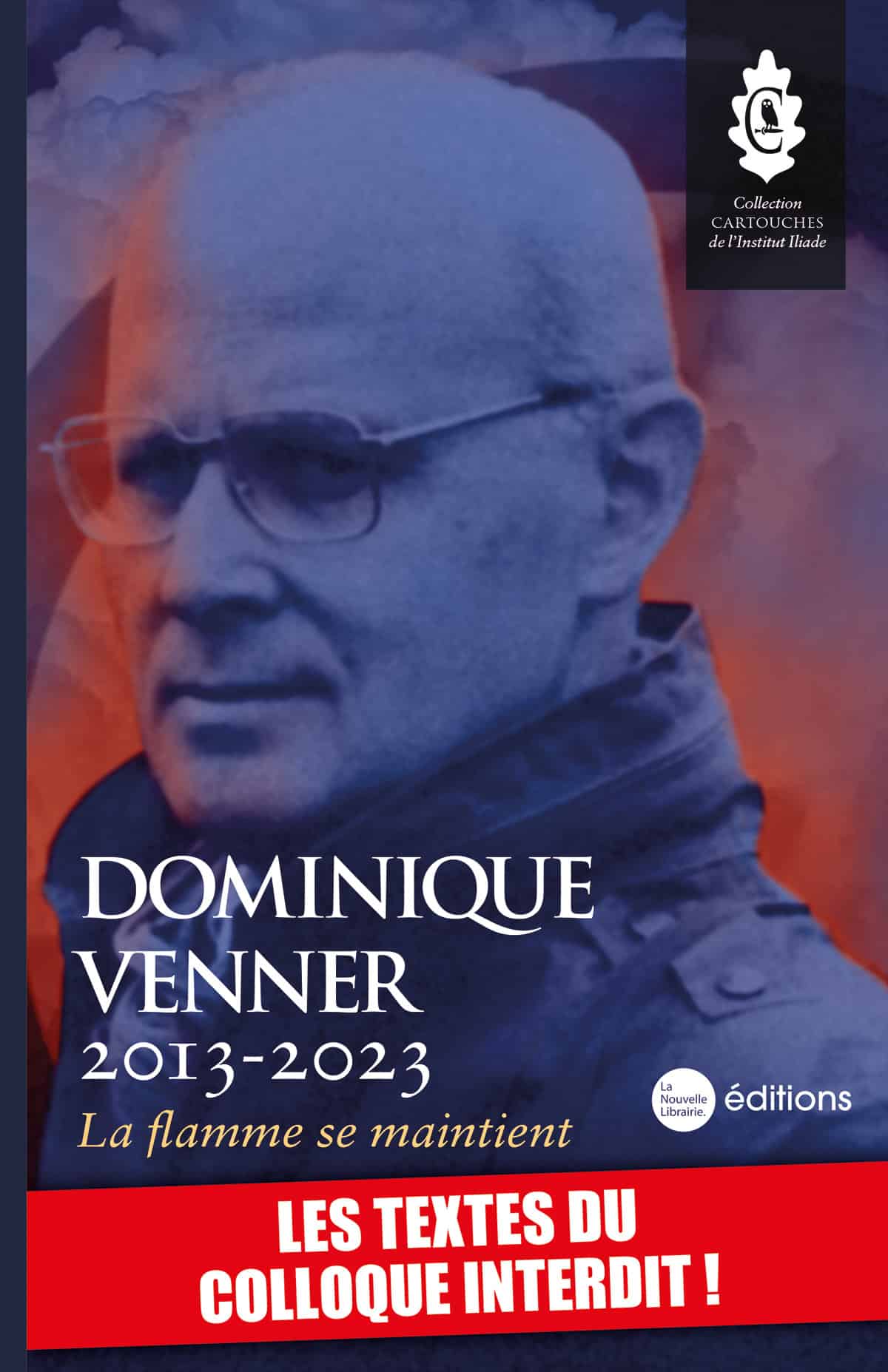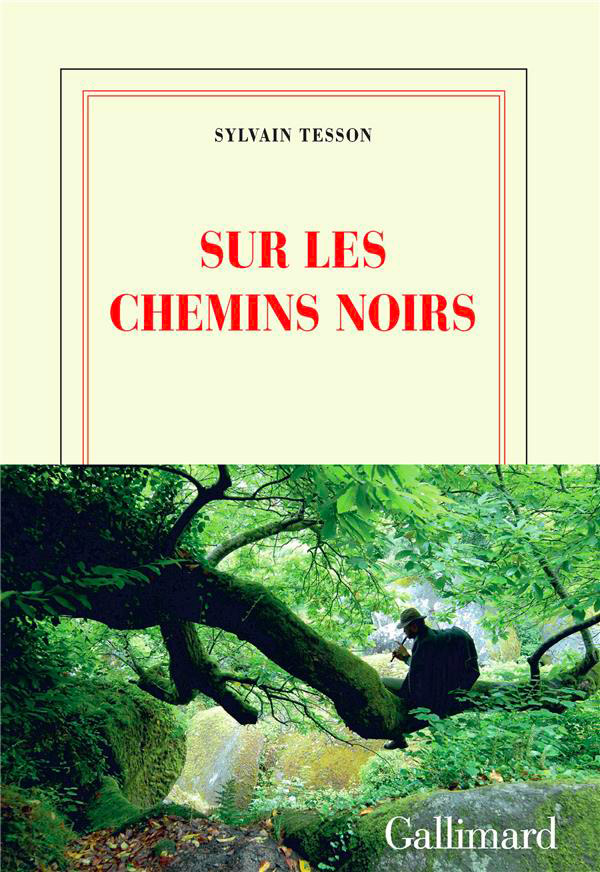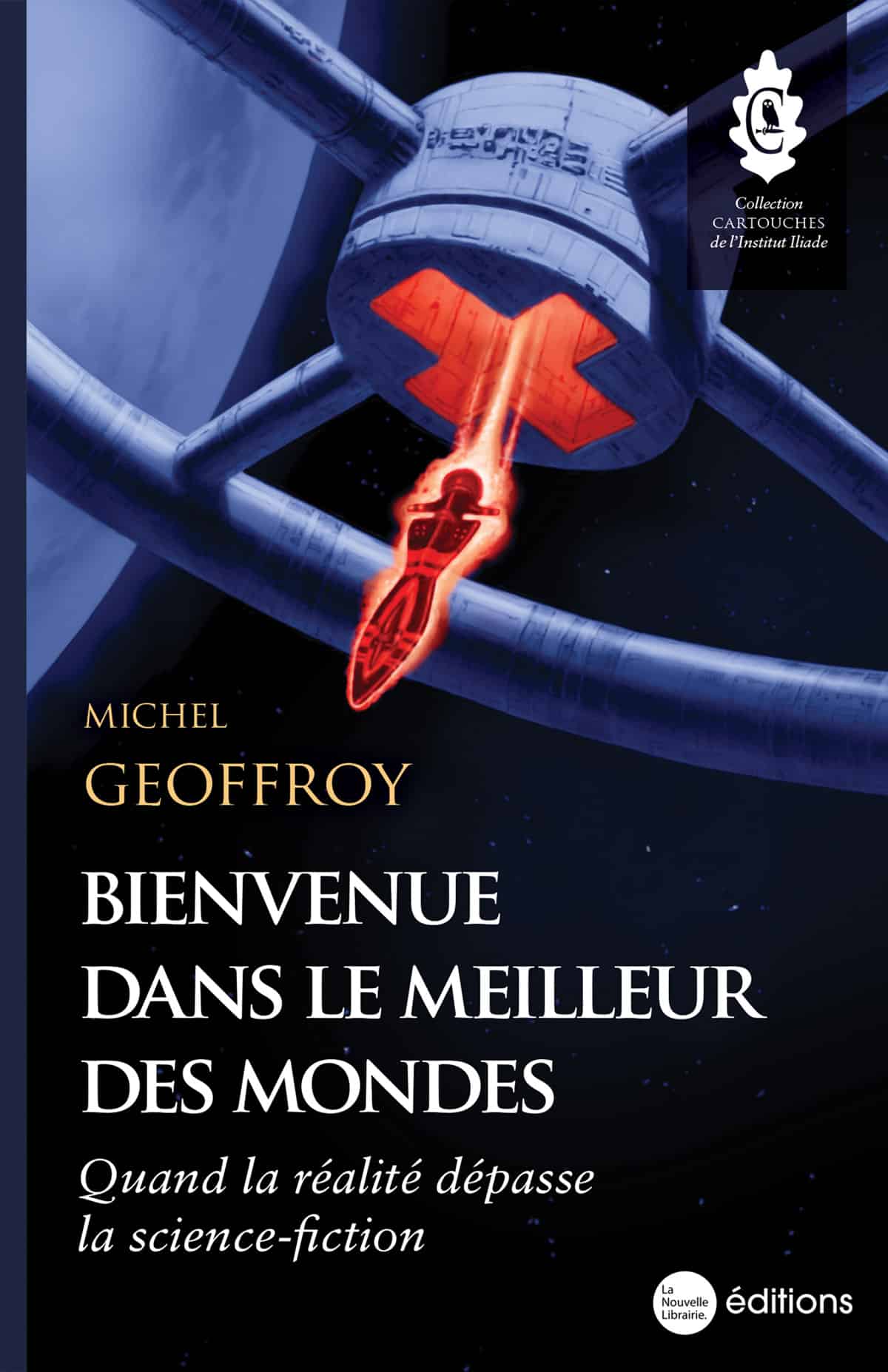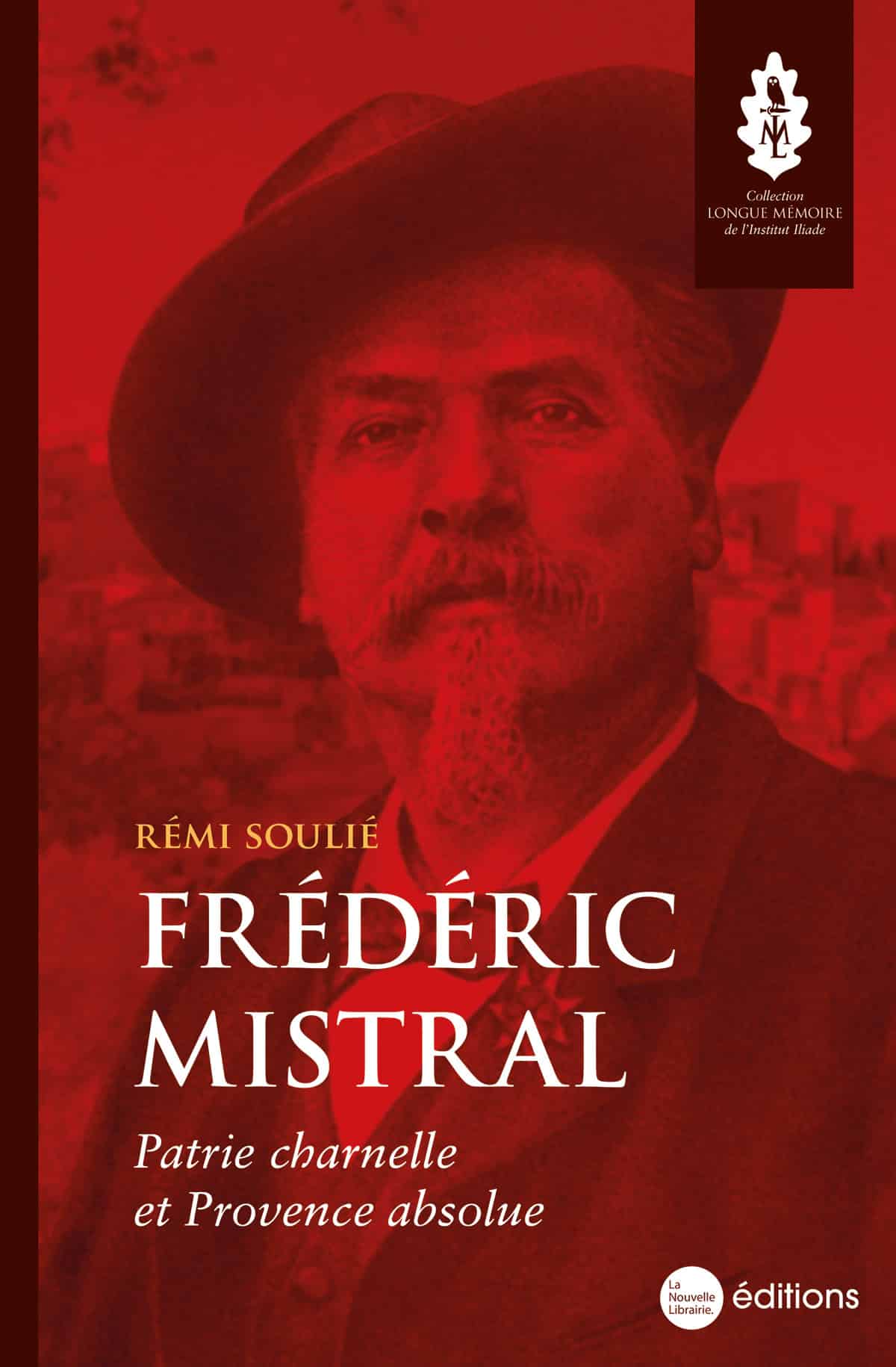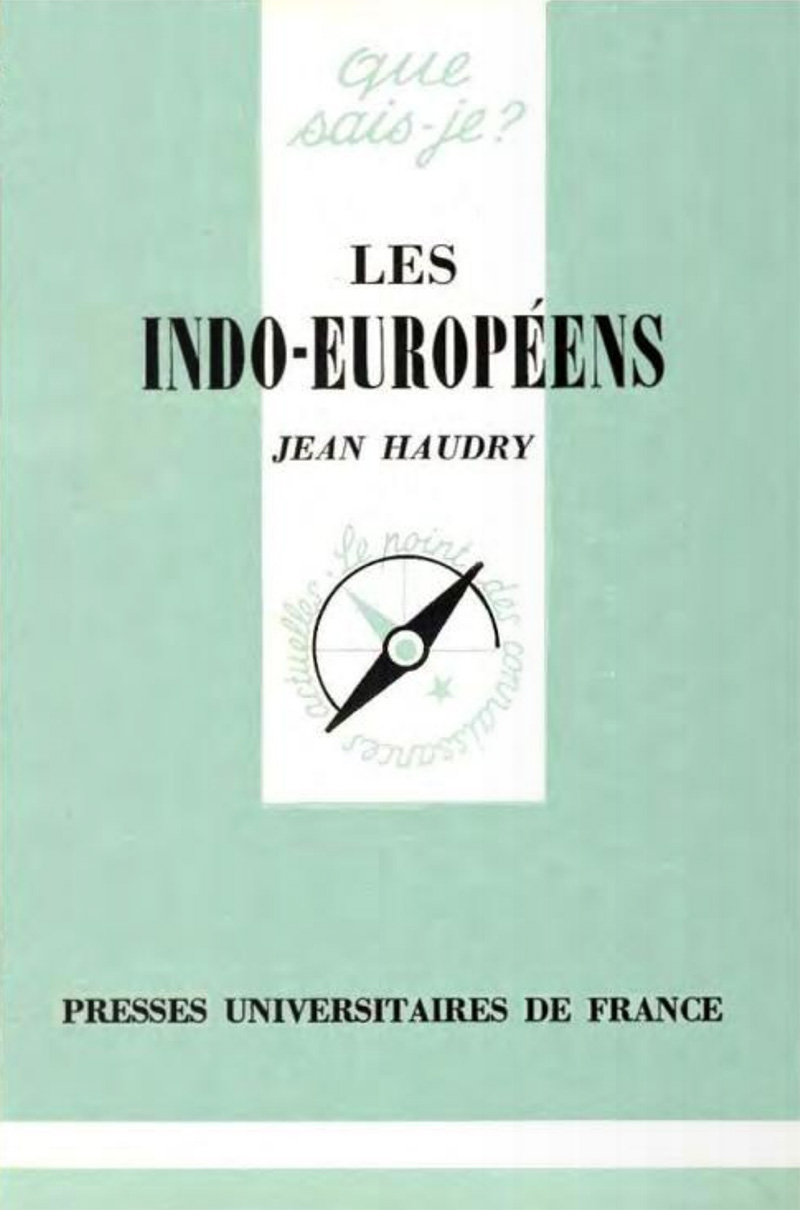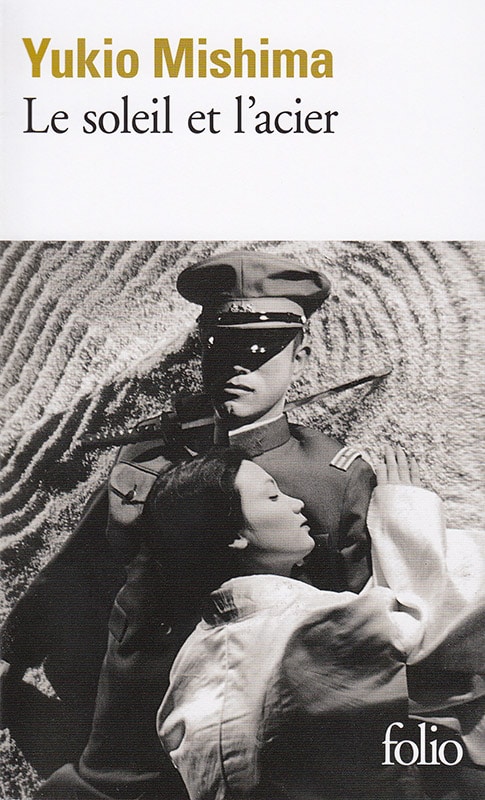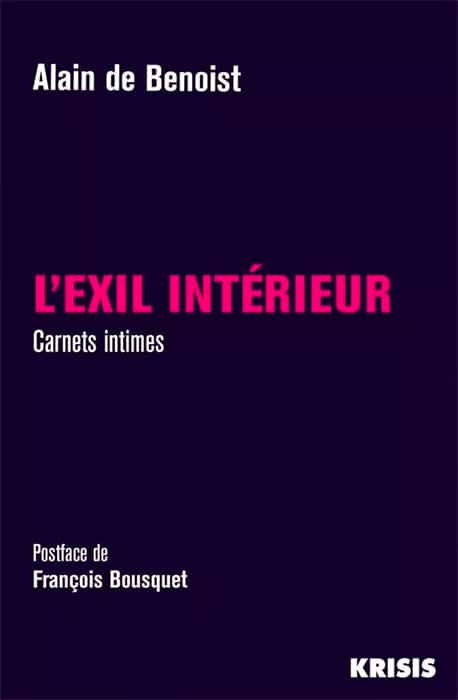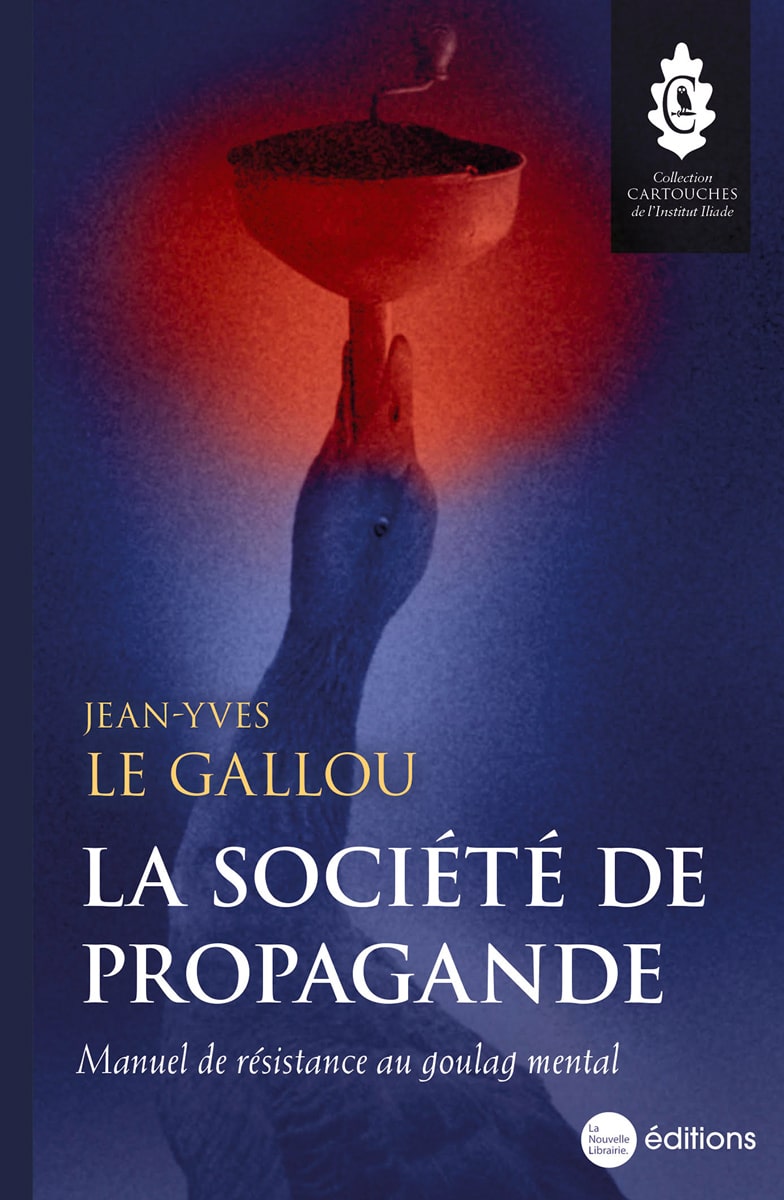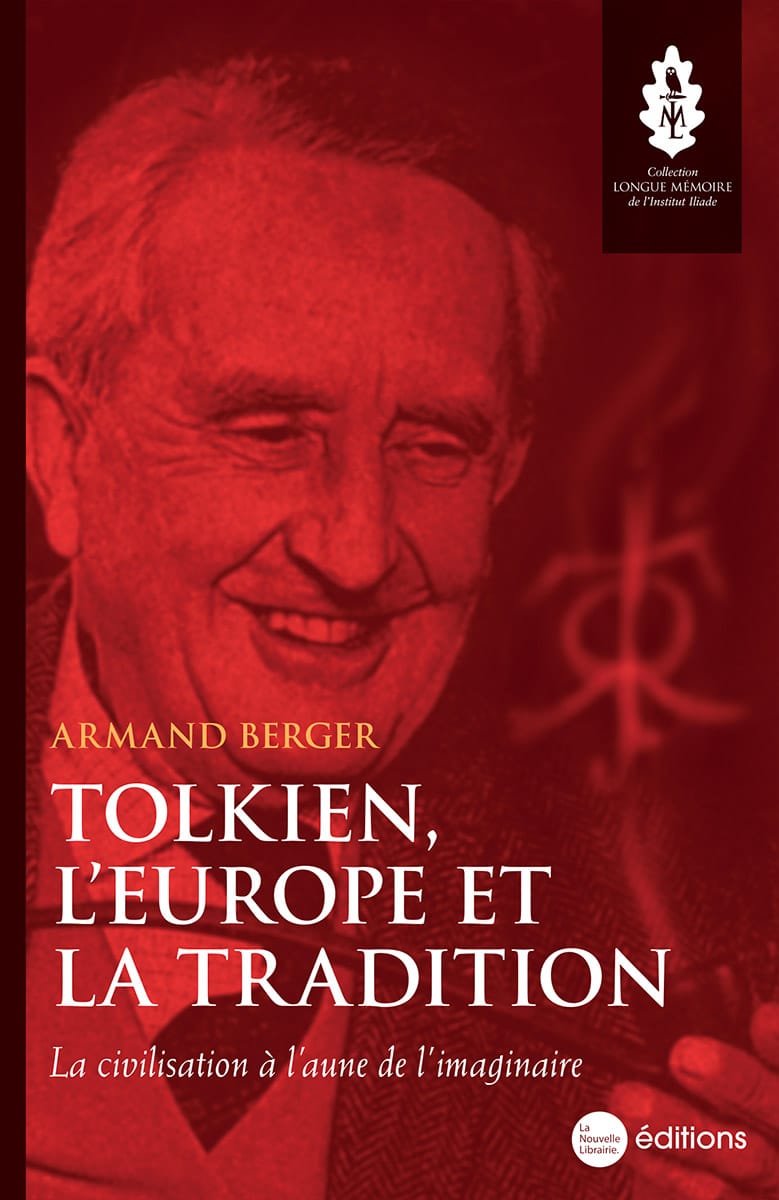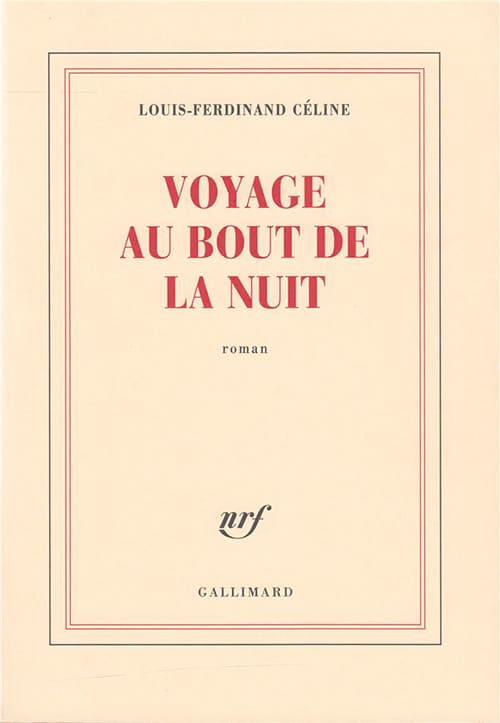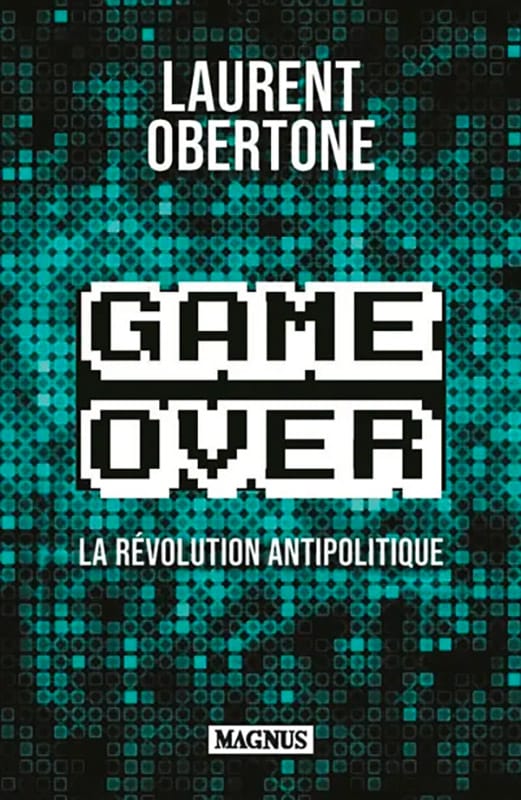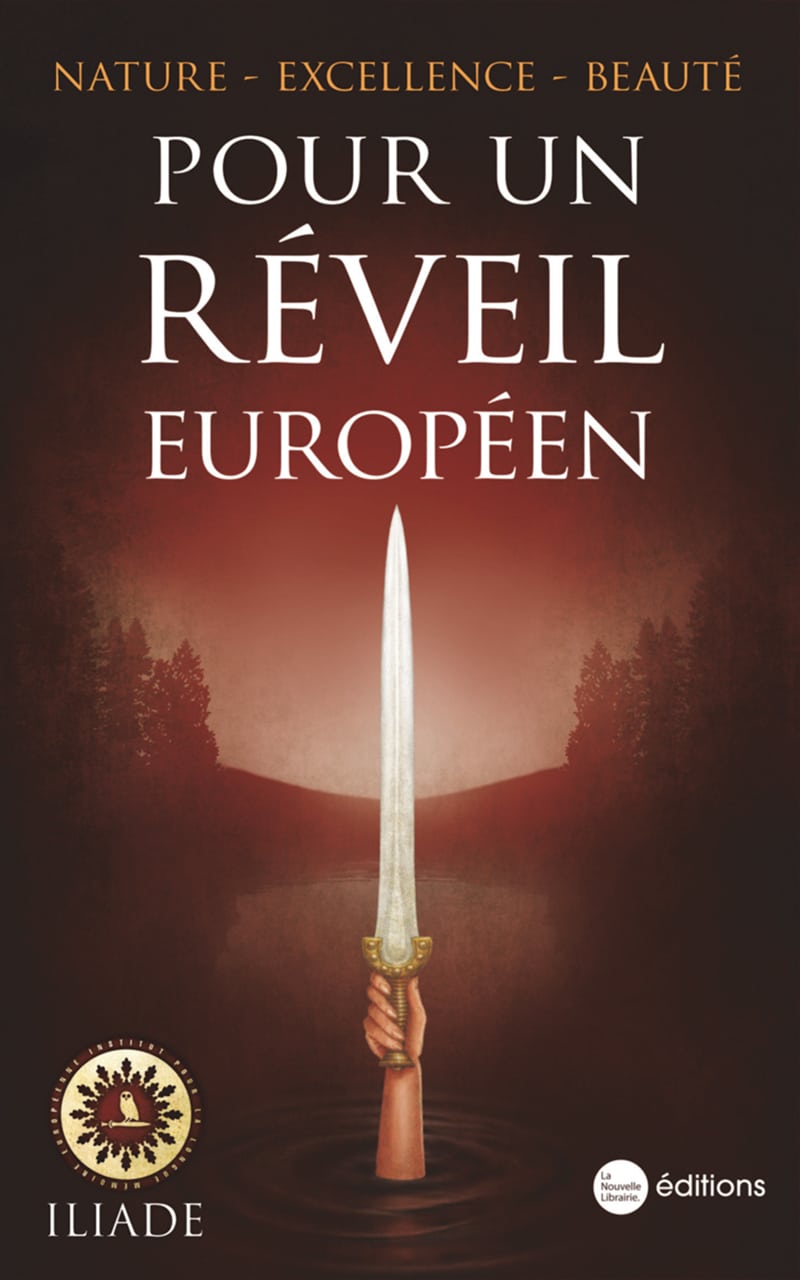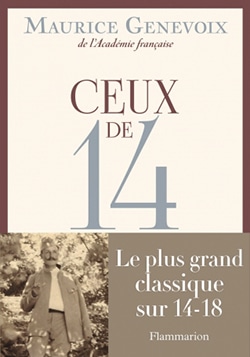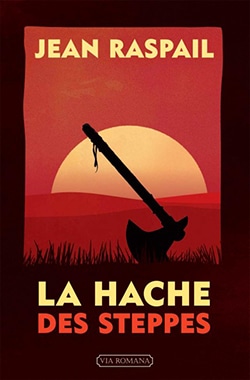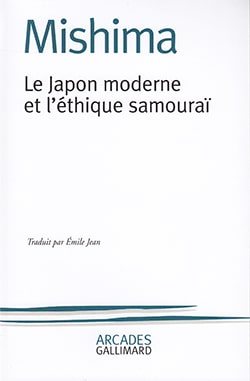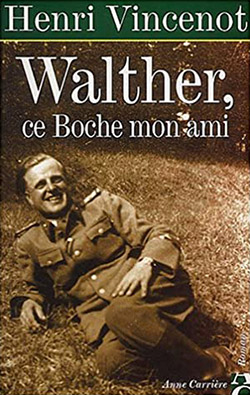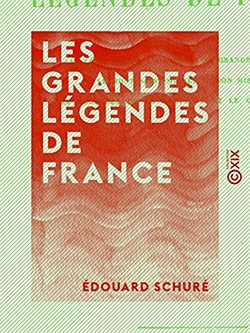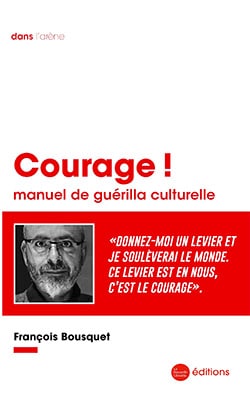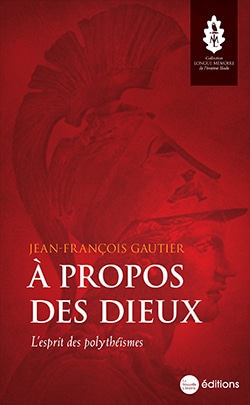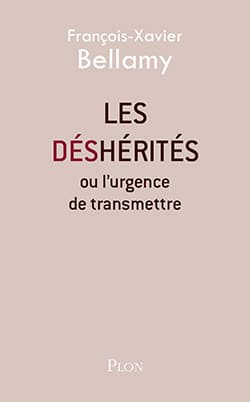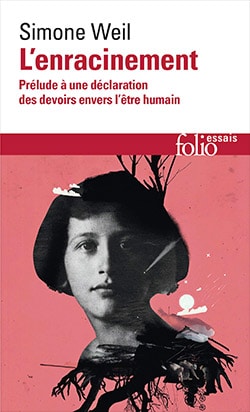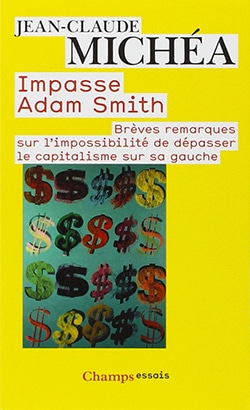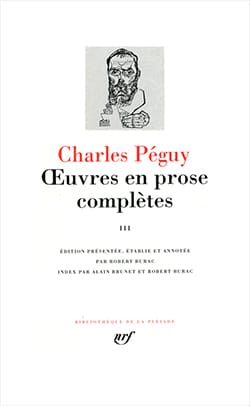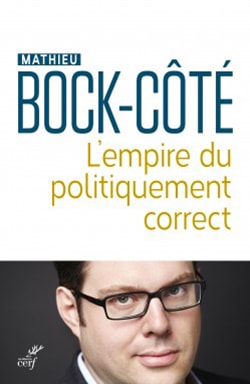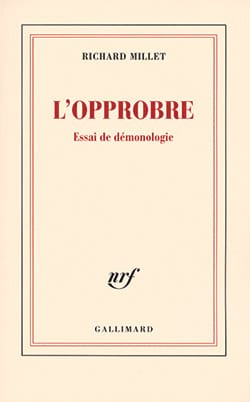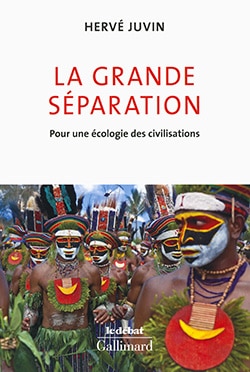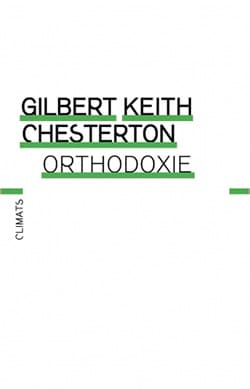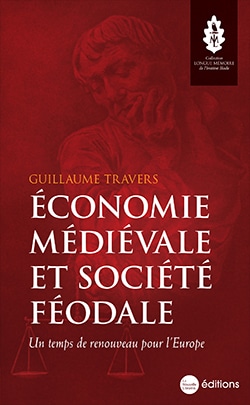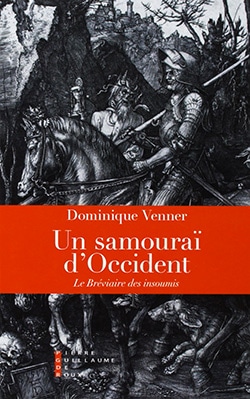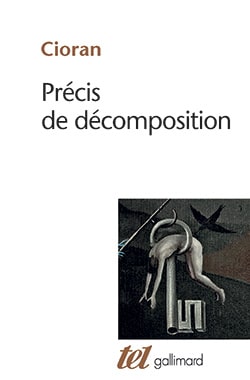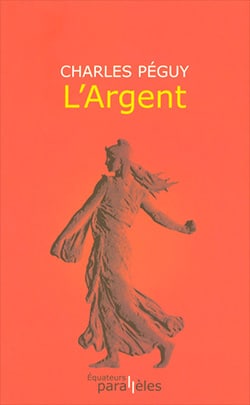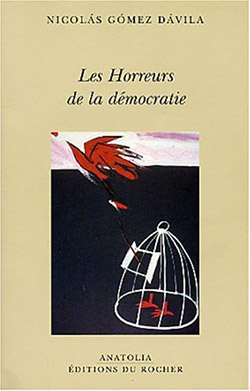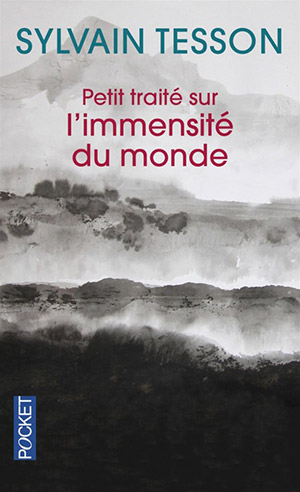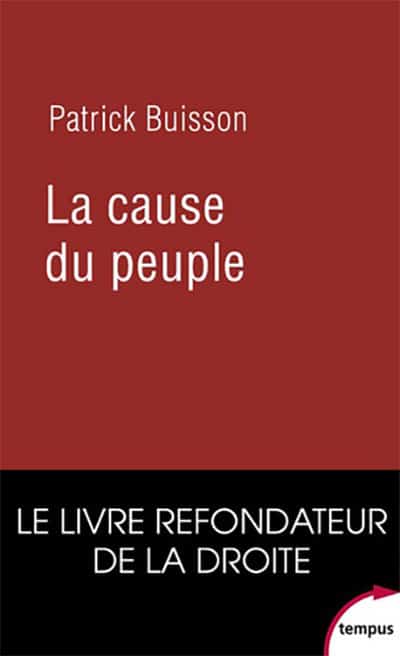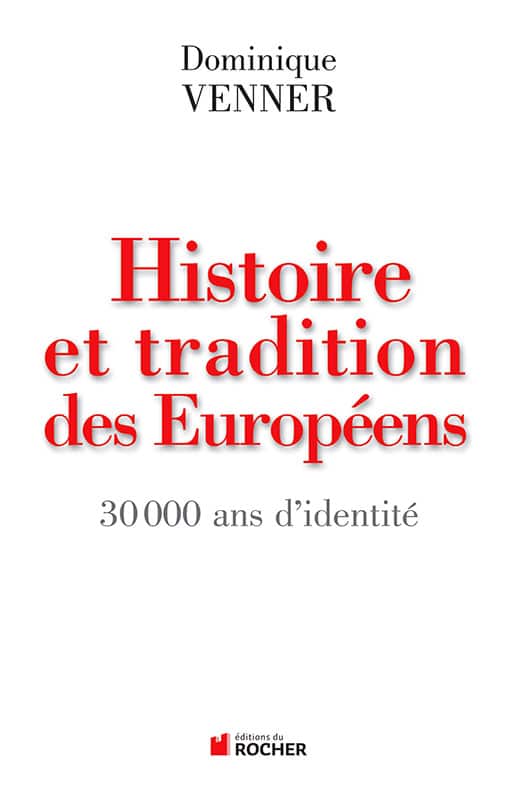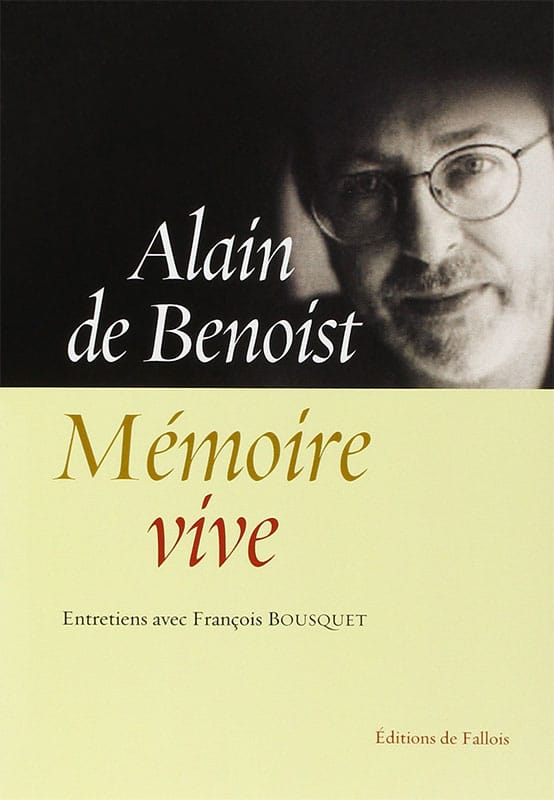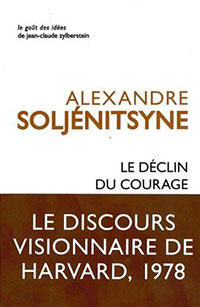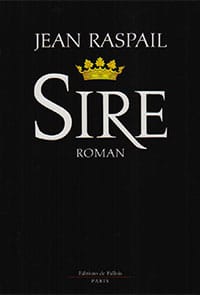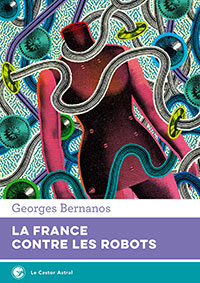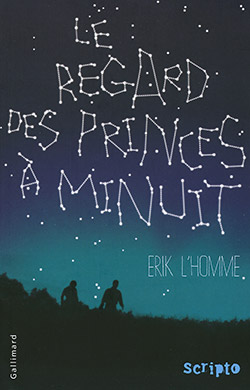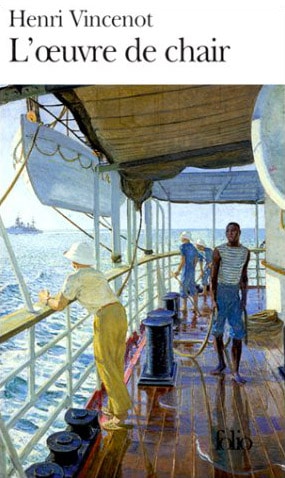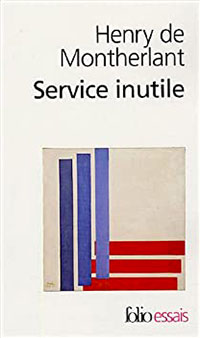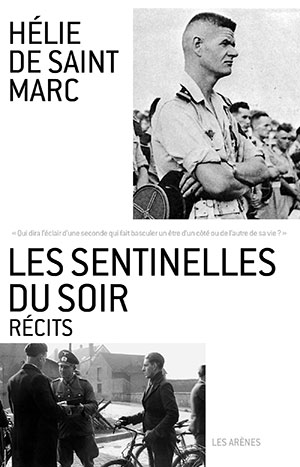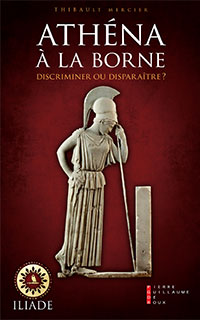« L’Europe est le nom de notre tradition, un murmure des temps anciens et du futur. Notre tradition est une façon de se conduire et de conduire notre vie qui n’appartient qu’à nous. Elle nous est révélée par les poèmes d’Homère et par nos grandes légendes, celles de la Table Ronde ou des Nibelungen. Elle nous est révélée aussi par le trésor des contes. Sous des apparences différentes, nos contes tissent la trame d’un même héritage de part et d’autre du Rhin, des Alpes et des Pyrénées. Retrouvés en Allemagne par les frères Grimm et en France par Charles Perrault, sans avoir l’air de rien, ils sont l’un de nos biens les plus précieux. Ils ne se voilent d’obscurité que si l’on ne fait pas l’effort de les découvrir. Jadis, leur transmission se faisait à la veillée, par le récit des Anciens. Se jouant du temps qui passe, ils continuent de dire le retrait salvateur dans la forêt, les forces de la nature, la solitude et la communauté, les rites de passage de l’enfance à l’âge adulte, la rencontre de la jeune fille et du chevalier, l’ordre du monde. Les contes sont le grand livre de notre tradition. Leur fonction est de léguer la sagesse ancestrale de la communauté. Même quand on y rencontre des elfes ou des fées auprès des sources et au coin des bois, ils sont le contraire des « contes de fées ». Sous l’apparence du divertissement, ils enseignent des leçons de vie. Ils disent les secrets qui feront que les demoiselles deviendront femmes et les garçons des hommes. Les contes disent les menaces à surmonter (le Chat botté), les limites à ne pas franchir (Barbe bleue), la ruse terrassant la force brutale (le Petit Poucet), la rançon de l’étourderie (le Petit Chaperon Rouge), le prix du serment (Grisélidis), l’effort soutenu triomphant d’une nature ingrate (Riquet à la houppe), les périls courus par la jeune fille et la virilité dévoyée (Peau d’âne). Les contes disent encore le courage, l’espoir et la constance des jeunes filles triomphant des épreuves (Cendrillon). Ils disent aussi la vigueur, l’audace, la vaillance et les ruptures par quoi les garçons sont ce qu’ils sont (Perceval). Les contes montrent qu’en s’appuyant sur les forces de la nature, la femme maintient ou restaure l’ordre du monde et de la communauté (Blanche Neige). Ces secrets sont nôtres, on pourrait parfois les croire perdus alors qu’ils ne sont qu’assoupis. Comme dans le conte de la Belle au bois dormant, ils se réveilleront. Ils se réveilleront sous l’ardeur de l’amour que nous leur porterons. »
Dominique Venner
Histoire et tradition des Européens, Éditions du Rocher, 2002